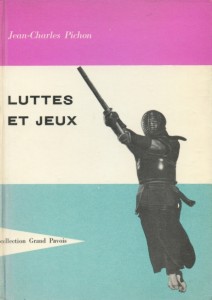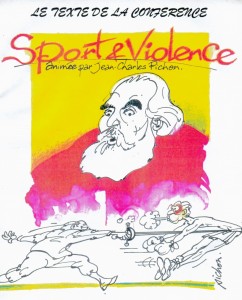En 1959, Jean-Charles Pichon publiait chez Gedalge un ouvrage intitulé « Luttes et Jeux ». En 1992, il donnait à Nantes une conférence sur le thème « Sport et violence ». Voici des extraits de ses réflexions, à près de 25 ans de distance.
LUTTES ET JEUX
1959
[Document audio : extrait d’une conférence à l’IUT de Nantes.
Pour l’écouter, cliquez sur ‘LES JEUX ».]
INTRODUCTION
J’avais réuni déjà une partie importante de la documentation nécessaire à l’étude que je projetais des « luttes et combats à travers l’histoire », lorsque je pris conscience qu’insensiblement je me laissais entraîner fort loin de mon projet initial.
Il m’apparaissait en effet qu’il n’était pas une forme de combat qui n’eût, à quelque moment de l’histoire d’une race ou d’un peuple, dégénéré en un jeu.
Prenant le problème à rebours, je me demandais alors combien, parmi nos jeux modernes, ne sont pas la survivance, l’adoucissement d’un combat primitivement meurtrier ou sanguinaire. Considéré sous cet angle, un spectacle aussi banal qu’une fête foraine pourrait être décrit comme la dernière expression de la volonté agressive de l’homme, qu’il s’agisse du cirque et de sa ménagerie, ultime évolution des anciens duels des bestiaires contre les fauves ou qu’il s’agisse de ce compétitions de tir, de billard chinois, de machines à sous, survivances de combats certes plus redoutables. Il n’est pas jusqu’aux loteries qui ne puissent être considérées comme la forme évoluée d’une compétition non plus des hommes entre eux mais de l’homme contre le destin.
Ces dangers forains, sans doute, ne sont que des faux-semblants. A la loterie, on ne risque pas de se ruiner; au stand de tir, la carabine peut-être est chargée à vraies balles, mais la cible proposée n’est qu’une silhouette de bois, un disque de carton. Les lions que le dompteur expose dans sa baraque sont vrais animaux sauvages, mais vieillis, affaiblis par la captivité, bien nourris au surplus. Le lutteur et le faiseur de tours possèdent une force, une adresse véritable; mais, très souvent, ils font appel à des compères qui rendent plus évidentes (et moins réelles) leur force, leur habileté.
Mais le joueur sincèrement participe au simulacre. Ce public d’enfants frémit au rugissement du lion. Le tireur s’applique de son mieux à toucher la silhouette qu’on lui propose; il y met une passion égale à celle qu’il éprouverait si, dans un pays hostile, il se trouvait en présence d’un ennemi. Ce jeune homme conduit sa voiture électrique comme si sa vie en dépendait et cette jeune fille, qui mise cinquante francs sur l’as de coeur, attend que la roue de la chance ait fini de tourner avec la même impatience que si, à la place d’un nougat, elle pouvait gagner une fortune.
Dire que tout combat tend à s’adoucir au point de devenir unjeu ne signifie pas que tout jeu fût d’abord un combat. La notion de vertige (qui explique aussi bien le « rotor » ou « La grande roue » que la corde à sauter de la petite fille ou la danse hystérique du sorcier noir) n’a rien à voir avec notre propos; sinon, peut-être, en tant que lutte contre soi-même, mais cela nous entraînerait trop loin que d’en tenter la démonstration. De même, le jeu de construction ou le puzzle, par exemple, font bien intervenir le principe d’émulation, mais à ce point modifié (ces jeux se pratiquant dans la solitude) qu’on ne peut guère parler de « combat » en l’occurence.
Il reste qu’à un moment de l’histoire de l’humanité, la lutte pour la vie semble avoir évolué en cette lutte sans objet, parfaitement gratuite et désintéressée qui fait le fond de la plupart des jeux.
Quand et comment le premier des combats – la lutte pour la vie – est-il devenu un jeu? Quand et comment le jeu a-t-il pris naissance? Question impossible à résoudre autrement que par des hypothèses.
Si pourtant on admet que le jeu est avant tout une évasion de la réalité (qu’il s’agisse du vertige ou du simulacre), il ne semble pas qu’il ait pu exister un temps où l’homme, s’il voulait survivre, ne pouvait s’évader, précisément, d’une réalité oppressante et dangereuse. Si le chasseur de la préhistoire poursuit des proies, c’est uniquement pour se nourrir; s’il s’aménage une retraite dans une grotte, pour se protéger. L’oiseau ne joue pas quand il construit un nid; le loup, quand il poursuit un lièvre. L’un et l’autre cèdent à un besoin: c’est une question de vie ou de mort.
De même les mouvements instinctifs du petit enfant ne semblent plus (à l’encontre de ce qu’on a cru longtemps) des manifestations ludiques. Lorsqu’il court dans un jardin, roule sur le sol et tout à coup bondit vers quelque chose qui bouge, pierre qui roule ou papillon, il ne joue pas, ne fait pas semblant: il vit.
Mais, quand l’enfant grandit, qu’il commence d’apprendre à respecter les règles des adultes et à leur obéir, il lui faut à de certains moments s’évader de cette contrainte péniblement imposée. Alors il fait comme s‘il était un cow-boy, un pirate, un aventurier, un homme libre. Ou bien – autre façon de se rêver libéré – il imite ses parents, ses maîtres, se fabrique des épées de bois, des fusils factices, manoeuvre des autos, des trains et des avions qui simulent ceux des hommes.
On imite seulement ce que l’on n’est pas; ainsi le jeu, imitation d’une vie libre et spontanée, exige d’abord qu’on ait quitté cette vie.
Ne peut-on pas penser que l’homme préhistorique a découvert le jeu comme une compensation, sinon une nostalgie, de la vraie vie, après que de nomade il fut devenu sédentaire, possesseur d’un champ et d’une demeure?
Sitôt que l’homme possède une tente et un troupeau, il se sent rassuré; il ne vit plus, comme le chasseur et comme l’enfant, dans l’oubli de la veille, l’ignorance du lendemain: la terre est toujours là – et les fruits qu’elle produit. Plus évolué, il acquiert l’expérience du temps et des saisons, il établit ses règles. Bientôt, il accroît ses biens, ses troupeaux; sa récolte est engrangée; les fruits, cueillis et mis en tas. L’homme n’est plus toujours sur la défensive et n’a plus besoin de tendre ses forces, à tout instant, pour assurer la continuation de sa vie. Il a du temps à perdre.
C’est alors, probablement, que (pour « tuer le temps » d’abord) il devient un « créateur »: il invente des outils, des parures, des chants. Il invente aussi des rêves. Il commence à regretter – à imaginer peut-être – une vie plus mouvante, plus gaie, plus pleine, qu’il nomme l’âge d’or, le paradis terrestre dans le souvenir. Mais c’est l’enfer, dans la réalité.
Partout dans la nature, l’homme découvre les signes d’une vie instinctive, furieuse, à laquelle jadis il a participé lui-même et dont sa prudence et ses possessions ne le protègent pas vraiment. Au contraire: il craint maintenant pour ses biens (une crainte que le chasseur nomade ignorait). Un cyclone détruit sa récolte, un raz de marée noie ses troupeaux, un séisme broie sa maison.
A tout moment, villages disparus, populations détruites viennent rappeler à l’homme désarmé que la nature même joue contre lui un jeu cruel et sans raison. D’où jaillit l’éclair et pourquoi frappe-t-il? Quel dieu méchant ensevelit vingt ans de travail, de peines et de joies, la maison, la femme et l’enfant sous l’imprévisible incendie, l’irrésistible inondation?
Des cataclysmes plus terribles, dont nous avons perdu le souvenir (mais conservé l’horreur dans nos légendes) – glissements, effondrements de vastes territoires, envahissements glaciaires – suppriment non seulement un village, une tribu, mais des pays et des peuples. La parfaite liberté de la vie change d’aspect; elle devient l’incohérence, l’injustice, la fatalité. Le « tout est possible » de la vie apparaît à l’homme prisonnier déjà de certaines habitudes une menace permanente (un peu de la même façon que le feu, l’eau, une simple promenade terrorisent l’enfant éduqué par des parents trop prudents).
Ces malheurs qu’il ne peut prévoir, l’homme cherche à les conjurer. Il s’interroge sur son destin, il s’invente des idoles qui seront les maîtres de la foudre, de la terre tremblante et de l’océan déchaîné. Son regret est devenu sa peur. Libéré de l’obsession de la nourriture prochaine, il cherche à retrouver la vie qu’il a perdue pour triompher de la vie qui le menace, sans concevoir sans doute que c’est la même. Il fait semblant de la reconquérir par le vertige, l’illusion, la gratuité folle d’un effort auquel lui-même ne voit aucune utilité.
CONCLUSION
J’ai souvent, au cours de ces pages, insisté sur le caractère de « gratuité » du jeu. Quand un champion se manifeste en public devant des spectateurs qui doivent payer leur place, ou quand un professionnel du bridge ne joue qu’à cent francs le point, on ne peut plus parler de divertissement. Adjoindre au jeu l’idée de gain, d’utilité, de récompense même, en dénature l’esprit. Je voudrais qu’il me soit permis,, en manière de conclusion, de déborder maintenant le cadre un peu étroit que je m’étais fixé, puisque aussi bien la notion nouvelle de « risque », que nous venons de mettre à jour, ouvre à l’esprit des horizons plus vastes.
Si l’on admet que l’alpiniste audacieux ou le pilote d’essai sont – au sens le plus noble du mot – des joueurs, il ne semble pas qu’on puisse dénier ce caractère à d’autres aventuriers, non plus du corps mais de l’esprit, poètes ou savants, qui risquent sinon leur vie, tout au moins leur bien-être (et parfois leur raison) dans d’autres quêtes incertaines. Au point où nous sommes parvenus, il semble difficile de distinguer le goût du risque qui jette un aventurier sur l’océan Pacifique de celui qui précipite un poète comme Rimbaud ou un peintre comme Van Gogh dans la folle recherche qu’on sait.
En effet, à première vue, que peuvent-ils espérer gagner? Ni la fortune ni le succès (de leur vivant tout au moins): Rimbaud brûle et détruit lui-même ses manuscrits, dont il est insatisfait; Van Gogh, de son vivant, ne vend qu’une seule toile. Mais le goût du risque l’emporte sur l’inquiétude: ils persévèrent malgré la misère solitaire, la peur de la folie. Jusqu’à leur mort, ils ne reprennent pas leur enjeu.
[…]
Qui nous dira quel enfant fou, malade ou immobilisé, créa jadis – pour tuer le temps – la première étincelle jaillie du choc des pierres, la première roue ou le premier essieu?
Sur cette question sans réponse, nous pouvons achever une étude trop brève, qui nous a menés de la notion de combat à celle de gratuité; de la notion de gratuité à la notion du risque; de la notion du risque à celle d’ingénuité – sans quitter les limites du Jeu. Car cette question, sans doute, est la limite où l’instinct de la lutte, du risque et du défi ne se distingue plus du progrès même; où le Jeu enfin n’est plus différent de la Vie, dont il apparaît seulement l’émanation la plus humaine.
« Vivre, c’est combatttre ». La maxime latine alors se complète: si le jeu est un combat, vivre c’est encore jouer – atteindre cet accord de l’instinct et de la règle sans lequel l’homme remonte à l’animal ou devient le robot.
Les ésotéristes des temps à venir, qu’on aperçoit bien lorsque l’on étudie les grands poètes, les grands écrivains de notre temps, diront ceci: il y a un rythme trinitaire qui fait que l’on va vers l’ouest à la quête de l’Amérique, après celle du Graal en Irlande. Puis le mouvement s’inverse, on retourne en Orient, c’est le retour au passé. Et en même temps qu’a lieu cette pulsion double, se succèdent et se mêlent des cycles (une civilisation après l’autre, une génération après l’autre). Ces cycles se présentent dans un sens de progrès, d’amélioration, et figurent une spirale. Tandis que le phénomène de pulsion ramène, lui, toujours du Big-Bang au trou noir et du trou noir au Big-Bang, de l’enfance à la mort et inversement. Les deux visions (la continuité et l’aller-retour) sont vraies en même temps. Aussi peut-on se demander si le problème a été bien posé jusqu’ici, par moi et par tous ceux qui en ont traité. Pour approcher l’univers du jeu il faudrait peut-être approcher celui de l’homme sérieux, c’est-à-dire l’univers contraire. Si l’on se demandait ce qu’il veut, ce qu’il exige, ce qu’il rêve on comprendrait peut-être l’utilité, la nécessité du joueur. L’homme sérieux veut que ses actes lui servent à quelque chose, il veut qu’il y ait une utilité à ce qu’il fait. En même temps son intérêt le porte à conserver ce qu’il a, l’accroître, l’enrichir, l’améliorer si possible. C’est dire que tous les actes de l’homme sérieux vont l’immobiliser dans une certaine conception de l’univers ou de ses propres forces. Il a besoin de ses limites et il jouit de ce qu’elles ont produit: les religions, les lois, les principes, les sciences. Le bonheur est de posséder pour toujours, tel est le rêve de l’homme sérieux.
Mais le joueur? Nous prendrons pour exemple un texte du Coran où Allah dit qu’il a cherché sur la terre entière une aide, un serviteur à qui il pourrait se fier et qui pourrait répandre ses enseignements. « Je l’ai cherché partout », dit-il: auprès des arbres, des animaux et tous lui répondirent qu’ils n’étaient pas assez fous pour ça. Mais Allah trouva cet être assez fou qu’est l’Homme. Et cette folie de l’Homme dont Dieu se nourrit c’est le jeu, c’est-à-dire le dépassement de la limite.
Lorsqu’on a cherché à différencier l’Homme de l’animal, on a dit que sa spécificité était dans le fait de marcher debout. Ce qui est faux. Puis on a dit que c’était du fait de sa main, ce qui est également faux. Alors on a dit que seul l’Homme pouvait nommer quelque chose qui n’était pas là: la spécificité de l’Homme réside dans la parole abstraite. Il peut dire la vie qu’il aura, celle qu’il a eue, le danger qui est absent mais qui est possible. Mais le chef des éléphants peut connaître à l’avance la nourriture qui n’est pas là, qui a été, autrefois, ailleurs ou différemment. Le rat a son chef, et l’amibe, et la cellule. Qu’un membre du groupe pousse un cri ou s’éloigne et le groupe sait que la nourriture va manquer, qu’il faut se déplacer, se développer et s’étendre pour chercher cette nourriture. La différence est que les animaux obéissent à leurs maîtres alors que les hommes n’obéissent pas à leurs prophètes. L’animal a une loi, y obéit et n’en change pas. L’Homme n’a pas de règle propre. Il ne rêve que d’échapper à ses limitations, il cherche à faire ce qui n’a pas été fait, ce qui est le plus dangereux, le plus redoutable, bref ce qui est impossible. Ce dépassement est ce qui s’oppose à la maintenance de l’homme sérieux. Et ce dépassement est tellement fou que, selon le Coran, il est réellement et totalement gratuit. On ne sait pas pourquoi l’on fait ça. Ce n’est pas pour de l’argent. Simplement le jeu pur est l’expansion du corps, de l’esprit, le développement de ce qu’on est.
Et je voudrais parler de la danse qui est aujourd’hui l’un des derniers recours de l’Homme, le plus proche de ce dépassement et de cette divination. Ceux qui se tournent vers l’avenir, les grands poètes et les grands prophètes, doivent être danseurs. Tous disent que l’Homme doit danser avec Dieu, avec un autre Jésus-Christ, beaucoup plus fou que celui d’il y a 2000 ans, avec un Christ presque désincarné. C’est celui que l’on appelle le libérateur, celui que d’autres appellent le Verseau. L’autre Christ, le Dionysios qui ne s’est pas réalisé il y a 2000 ans. Les Pères de l’Eglise disaient de lui qu’il était un enfant, qu’il fallait s’occuper de l’homme Jésus-Christ mais que Dionysios avait le temps pour lui. Maintenant il n’a plus le temps, le sien est venu.
En effet, à l’heure actuelle, il apparaît à ceux qui s’occupent de jeux, des modifications de plus en plus curieuses au niveau des règles; elles vont contredire un peu les règles passées et peut-être complètement. Socrate disait: « Connais-toi toi-même » et c’est une première approche de ses propores possibilités ludiques mais cela ne suffit pas. Il ne suffit pas de se connaître soi-même, il faut connaître le partenaire, l’autre, la vie, la mort, l’animal, l’ennemi dont on ne triomphe pas si on ne sait rien de lui. Or pour connaître l’autre il faut s’oublier soi-même. Les jeux tels qu’on les a évoqués ce soir proviennent d’un rituel qui est l’oubli de soi-même. Mais l’oubli ne porte pas sur l’aujourd’hui car il faut que je sois là quand je parle ou que je me sers d’un bâton ou d’une épée. C’est le soi-même d’hier que je dois oublier pour que cette loi soit possible: « Deviens ce que tu es ». Nietzsche veut dire aussi: « N’accepte pas d’avoir été ». Ce que tu as été, nie-le, n’en tiens pas compte. Ce que tu sais, ce que tu as appris doit servir maintenant, tu as cette force d’intelligence.
Mais devenir tout ce que tu es ne suffit encore pas. Car si tu n’es pas tout ce qui est, si tu n’es pas la nature, l’animal, le tremblement de terre, la comète, il y a un jeu auquel tu ne pourras jouer, qui t’échappera. Si tu ne connais le Yi-King ou les règles de ces jeux africains où l’on joue des mots, des nombres que l’on apprend aux enfants dès leur plus jeune âge, si tu ne connais pas ces règles mythiques, tu ne peux pénétrer les destins et les chances. Il faut connaître les moeurs des animaux, les règles du soleil, du cosmos, de l’inconscient. Le véritable combattant sait tellement ce qu’est l’univers que par exemple, dans les arts martiaux, il va fermer les yeux lorsqu’il décochera sa flèche, pour se faire la flèche, et il ne rate pas son but. Cet autre monde qui s’ouvre est dans les jeux et dans les danses. Il faut devenir tout ce qui est, mais il faut devenir celui qui se tient en face, l’adversaire. Rabelais, dans sa page sur les jeux de Gargantua, dit: « Gargantua apprenait à monter à l’arbre comme le chat, à grimper au mur comme le rat, à ruminer comme la vache… » Il devenait la nature et ainsi il dépassait la sienne. Lorsque le combattant nippon, au plus haut stade du judo, se tait, se fait violence peut-être avant de pousser son cri mortel, il devient l’autre, son adversaire. De même quand le grand joueur d’échecs ou de dames fait le coup irrésistible et remporte la victoire, il s’est mis à la place de l’adversaire, il a compris que son éducation ne lui permettrait pas de répondre à ce coup. En devenant son propre ennemi il a pu dépasser sa propre limite.
A ce moment se dessine un progrès autre que celui, naïf, qui a marqué le début de cette causerie. L’Humanité ne va pas vers un adoucissement mais ne va pas non plus vers son contraire. Elle va vers ce qui hier était inaccessible mais qui demain sera atteint. Cette saisie de soi-même, par l’oubli du soi d’hier, par le devenir-autre, le devenir-univers, le devenir-ennemi, ne conduit pas à l’égalité ni à la justice. Il s’agit du balancier, qui fait que la vie est un fil, par delà le bien et lemal, l’ami ou l’adversaire. Ce danseur de corde est le Zarathoustra, pour qui le progrès n’est rien d’autre que lui-même: une remise en cause constamment reprise. Le jeu permet le dépassement d’une limite dans l’atmosphère purifiée, dans l’exaltation et le paradis de la gratuité. Ici enfin, ici seulement, le jeu fait de l’homme plus que le complice, l’égal d’un dieu.
Texte transcrit par Laurent Chabot et Julien Debenat