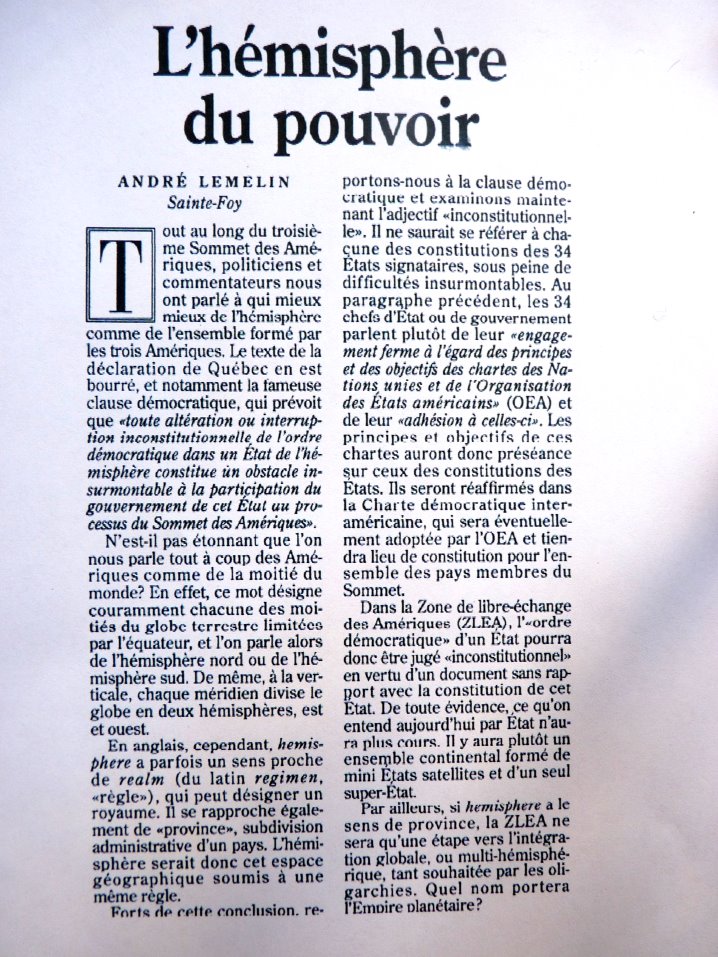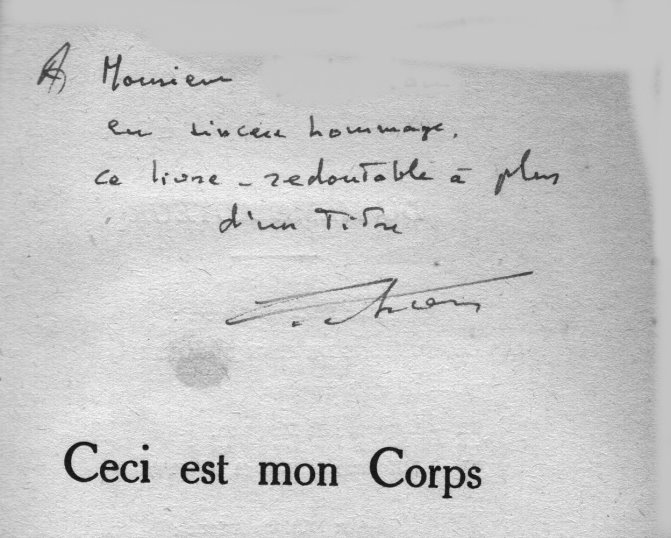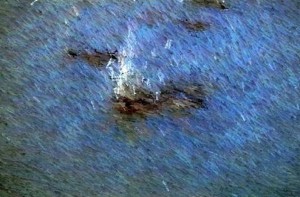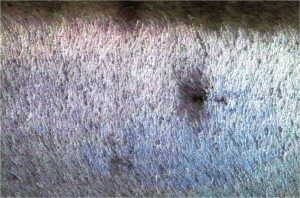A l’âge de 25 ans, Jean-Charles écrivit le texte ci-dessous, dans lequel on trouve une grande partie des idées qu’il ne cessera de développer au long de son oeuvre. Il fut publié dans la Revue « Prétextes » en 1945.
l’Ethique
Introduction à une morale sensuelle mystique et raisonnée
Prélude

Illustration Pierre-Jean Debenat
Aspects du monde
En dépit des sempiternelles philosophies patiemment édifiées, sinon échafaudées dans la peine oisive d’un esprit assuré déjà de sa découverte ; – en dépit de tant d’œuvres dont je passerai en revue les savantes erreurs, – erreurs parce que savantes ; – en dépit même d’une façon héritée de retenir des choses leur aspect régulier, rien ne ressemblera, même de loin, à la pensée kantienne, voire à la pensée hégélienne, – car rien ne m’est plus étranger que l’organisation arbitraire de mes plus vives intuitions. – Je reviendrai, par ailleurs, sur le sens de ces mots.
Et, d’abord, dès l’instant qu’il entreprend l’accomplissement d’une doctrine, l’homme, – philosophe ou poète, – ne peut moins faire que de se raconter, se raconter dans le sens, bien entendu, de son œuvre .
L’erreur la plus commune à tous les dogmatismes est, en effet, de se croire, – non pas seulement universel, ce qui s’admet, – mais éternel. Or, il n’est que trop certain que l’œuvre, et l’esprit de l’œuvre même, porte l’empreinte du siècle qui l’a formulée. Le siècle, et non pas l’homme, – car nous pouvons tenir l’éthique de Spinoza, le discours de Descartes ou les livres de Bergson pour nécessaires à ce point que, faute de leurs auteurs, d’autres se fussent levés .
Nous eûmes, nous autres, au lendemain de la Grande Guerre (celle-ci étant la guerre mondiale), l’estimable chance de naître dans la paix, de grandir et de nous développer dans l’ultime brasier des vieilles théories, et d’arriver à l’âge d’homme à temps pour assister ensemble qu’à l’essor d’une pensée libre d’aïeux, à l’écroulement final des formules. De nos aînés, si grands et si ardents qu’ils soient, qu’attendre ? Leur ardeur a pu les jeter dans la fournaise, – les amener à découvrir les lois primaires de destruction, – les contraindre à refuser le parti pris des morales, – et les faire déchirer à coup de dents joyeux le principe et le langage. Mais, enfin, quand, debout au pied des murs en ruines, il s’agit de reconstruire, qu’offrent-ils à quoi nous puissions rêver ? L’existentialisme… Quant à nos fils, – ou bien ils croîtront dans un ordre sûr, dans une carrière déjà tout équipée, les matériaux sur place et les outils en main, – ou bien l’incendie s’emparera d’eux et les fera danser, ivres d’un dieu pourpre, sur la pointe des flammes.
Derrière et devant nous, pas de secours, pas d’appui. C’est à nous qu’il appartient de construire, seuls et vite.
En notre faveur, le délabrement, la mort, la faillite, l’agonie des castes et le désert charnel. Plus une pierre n’est à chasser, plus un trou n’est à creuser, tout est néant, si complètement et si proprement qu’en vérité, cet aplanissement est un pur miracle.
Contre nous – notre solitude. Nous allons venir (nous, moi et ceux qui croiront en moi) nous allons venir après de faux égards accordés aux jeunesses ; après une propagande éhontée de fantoches et de pauvres gamins qui, tous, détenaient, disaient-ils, la sagesse, qui se rêvaient banquiers, acteurs, poètes, librettistes, académiciens – ne voulaient que tirer parti de leur temps inhumain – et, finalement, ont dégoûté de la jeunesse tout homme digne de ce nom.
Contre nous, le rapide besoin de la révolution. L’ordre donné d’en haut d’exprimer promptement et dans une langue claire – la doctrine des jours nouveaux.
Heureux qui dans la nuit annonciatrice d’orages, et dans l’orage lui-même, a su garder le calme et le silence ! Mais heureux plus encore qui, dans ce court espace de seize à vingt-quatre ans ( le seul temps où l’homme pense) a pu vivre sans cesser de s’immobiliser dans une attente vierge – et confronter, à tout instant du jour, sa vie et sa pensée !
Heureux qui, sans le savoir, sans oser espérer que le destin le promettait à ce rôle insoutenable, a retenu de ses sensations de ses inspirations et de ses élans ce qu’il en fallait pour être – à l’heure de la naissance prêt à tout enfantement !
Car en vérité, le reste l’homme peut l’acquérir : la parole et le style et les idées elles-mêmes. Mais cela seul est l’œuvre d’en haut – la silencieuse, mystérieuse et REELLE progression d’un esprit vers un but qu’il ignore. Et nous irons plus loin : nous sommes ceux qui n’ont jamais cru qu’une heure pût leur être donnée et qui, même quand l’heure sonnera, continueront de travailler et de combattre pour un but qu’ils auront dès longtemps dépassé.
Certes, dans notre victoire, nous n’oublierons pas la mémoire de nos précurseurs. Plus que personne nous aurons le respect de toutes les voix qui se firent entendre, de toutes les mains qui se sont tendues, de tous les pas qui nous ont précédé sur un quelconque chemin.
Car , quelle que soit la tâche que nous accomplissons – il nous faut reconnaître qu’elle va se présenter sous la forme la plus simple et cela grâce à ceux qui se sont débattus dans les pires outrages. En un siècle, que de martyrs ! Nulle époque n’est plus riche en destins prestigieux. Rimbaud dans ses sables d’Ethiopie, Nerval pendu, Tolstoï mangé des loups, Dostoïevsky au bagne, Edgar Poë humilié, Baudelaire condamné, Rilke prisonnier de sa tour d’ivoire, Lautréamont fou – supplices volontaires, je le veux bien, mais arrachés tout de même par la faim ou l’alcool, les risées de la foule à des cerveaux pensants. Wilde torturé sous le prétexte d’un vice et de Foucault tué pour sa foi – Thomas Mann exilé et Jarry moribond, – et Gorki vagabond et René Crevel hanté par l’ange du suicide – tels furent les dieux de notre adolescence et les victimes de la guerre : Fournier, Apollinaire, Peguy.
Oui, dans ces années mêmes où des hommes, – nos pères, – voyaient en eux des névrosés, des malfaisants, des fous, nous affirmions par nos fièvres magiques que ceux-là seuls avaient compris la vie, qu’eux seuls et non Stuart Mill, Hegel, Spencer ou Schopenhauer étaient dignes du nom nouveau de philosophe.
Car ils n’apportaient pas seulement la négation des concepts étranglés. Ils ouvraient sur l’abîme des routes suspendues, et telle phrase de Rimbaud, ne serait-ce que celle-ci : “…les rois de la vie, les trois mages, le cœur, l’âme,l’esprit ”, nous en apprenait beaucoup davantage que le traité des passions. Et telle autre, du même :” Vous êtes de faux nègres, vous, maniaques, féroces, avares”, nous était plus terrible que les quatre Evangiles. Derrière des mots où certains feignaient de voir de vagues lieux communs et les autres d’insoutenables paradoxes, nous apercevions, nous, le complexe étonnant d’un esprit qui se cherche et d’une âme qui sait. C’est par eux que, bien avant de goûter aux plaisirs qui occupent les hommes, nous avons appris l’art de mépriser.
Parmi cela, autour, entre les heures d’extases, imaginez le professeur de province, second père de famille, et trop ceint de diplômes pour s’ouvrir à la vie, plein de charmants aperçus sur toutes les questions, nourri peut-être de Freud et de Baudelaire, mais, en fait, survivant disciple de Renan, croyant au progrès de la science formelle, à la toute puissance du socialisme, pacifiste ou chauvin, mais sans rien voir au delà.
Alors, prit forme le premier ouvrage. Nous sûmes éviter l’écueil des grands martyrs : nous ne nous révoltâmes point. Comment cela fut-il possible ? Je ne sais. Mais, alors que tout en nous répétait : “Tu n’obéiras pas”, nous tendîmes nos forces à vouloir obéir, et cela, sans doute, nous sauva du malheur.
Il est facile de prétendre, après coup, que nous ne fûmes si dociles que parce que nous savions que l’Aurore luirait et que nous la connaîtrions. Facile : trop facile. Au vrai, nous ne le savions pas, nous ne savions rien si ce n’était, peut-être, que la révolte est vaine et que le signe vient d’en haut.
Toujours est-il que nous évitâmes les cris inutiles, et les veilles malséantes et les projets impurs. Nous tentâmes, comme nous le pûmes, de nous frayer un chemin dans le monde des idoles. Certains firent de la politique, n’est-ce pas, mes frères ? et tels autres se rejetèrent dans l’art, dans les sciences, dans l’amour. Aujourd’hui, mes amis, je regarde en arrière, et je vous vois. Bien sûr, je ne pouvais pas deviner pourquoi tu t’es tué, par un soir de grand froid, sur ta motocyclette ; – ni toi, plus tard, pourquoi tu t’habillais de ton sourire bête devant les imbéciles ; – ni toi, pourquoi tu travaillais, la nuit, dans ton épais silence ; – pas plus que vous n’avez su pourquoi chaque semaine je hurlais le nom d’un poète nouveau et de quoi j’ai rêvé dans les cours de Solesmes et pourquoi je me suis engagé un mois avant la guerre et pourquoi j’ai tenté un peu chaque métier. Mais, nous tous, vous et moi, nous attendions le jour.
Oh ! nous fûmes des vivants rapides, – voyages, argent, amours, – tout fondait dans nos mains. Mais, bien vite assagis. Combien de nous, à vingt ans, ne furent pas mariés ? Combien ne sont pas pères de plusieurs enfants ? Il me semble que notre devise ait été :”Assez pour connaître, trop peu pour se laisser prendre”. Nous fûmes bouddhistes, n’est-ce pas mes frères ? Et fétichistes, et protestants, et catholiques, par surcroît ? Et soldats, et congressistes de la Paix ? Et relativistes et absolutistes ? Héros et renégats, bienfaiteurs et bandits, ouvreurs de portières et philatélistes ? Et vrais députés, et vrais commandants, et vrais jeunes premiers ?
Mais, surtout, ô plus encore ! victimes. Je pense à vous, soldats, isolés de votre race, en lointaine Silésie, pendant près de cinq ans. Je pense à vous, enfants jetés de ville en ville, de maquis en maquis et regroupés à la dernière heure. Je pense à vous, les déportés, les prisonniers des camps, les fusillés vivants, les torturés hurlants. Je pense à vous les esclaves des usines, nuit et jour bombardés. Car, par là dessus, nous avons connu, serrant dans nos bras l’enfant endormi, la grande peur des Soirs ardents. Nous avons éprouvé par le déluge du feu l’angoisse d’être un homme pas encore solidaire que la mort vient saisir. Nous avons cru, tous plus ou moins, mourir, mourir avec le monde qui naissait dans nos crânes, nos bras forts et crédules et notre âme jaillie en une pitié fervente pour la folie des hommes. Et nous avons compris, cette nuit-là, que l’Aurore avançait à grands pas. Nous avons su que le plus dur était fait, cette attente sans yeux et qu’il nous suffisait de vivre un peu de temps. Alors, nos diplômes, nos titres, notre orgueil d’avoir poussés si vite, champignons phénomènes dans la fraîcheur des bois, tout notre passé qui ne fût cette attente s’est détaché de nous, et nous avons trouvé ce puzzle dérisoire, le matin , à nos pieds.
Quel âge as-tu ? Vingt-cinq. Toi ? Vingt-huit. Et toi ? Vingt.
Panorama des esprits las
Simple ouvrage, si simple !
Aurions-nous pu, toute notre vie, subir les visages assurés, les yeux morts dès l’enfance de ces hommes sans morale autre que le code et les fascicules fiscaux qui parlaient sans desserrer les lèvres, si grotesquement loufoques dans leur raison-raison qu’il semblait difficile, qu’il semblait impossible qu’ils n’en fussent pas conscients.
Ces hommes qui prétendaient détenir la vérité, – dans leur livre de caisse, – espèces de héros sans légende et d’amants sans amour, persuadés de n’avoir vécu que pour et par une société ; usant leurs nerfs aux collections de timbres-poste, aux rapports entassés, aux formules arbitraires (La liberté de chacun finit où commence celle des autres), tambourins résonnant sous les doigts de quelques initiés qui savaient le prix de l’esclavage, joueurs de belote ou de bridge, chasseurs, pêcheurs, incapables au fond, – l’ont-ils assez prouvé ? – de vivre un seul instant pour vivre.
Aurions-nous pu, vraiment, les supporter ? Pour moi, je n’ignore plus que c’était au dessus de mes forces. Mais la face du Monde a changé. Ces mêmes nous promènent, soudain, dans les chambres désertes de leur crânes. Leurs idoles gisent à terre. Qu’a-t-il fallu pour cela ? Quelques balles explosives et quelques incendies, – en place de la vie qu’ils refusaient de voir, la présence nue de la Mort. Et, maintenant, il va falloir qu’ils paient, en dépit de nous, malgré nous, dont ils ne comprennent pas le message sauveur ; qu’ils paient pour Comte et pour Renan, pour Paul de Kock et pour Willy, pour Thiers et pour Poincaré, pour Lavedan et pour Hervieu et pour la Tour Eiffel et le premier chemin de fer, – et pour le French cancan et pour le traité de paix et pour les hausses en Bourse et pour les belles combines qui relèvent une affaire, et pour leur existence ratée de fonctionnaires et leurs médailles non méritées et leurs discours dithyrambiques sur l’Empire français, – quand ce n’était pas sur l’extinction du paupérisme (ô ! ces formules !), – car il faudra qu’ils paient pour leurs masques impudents, leurs gestes trop appris, leur insouciance de l’être.
Et le paiement est déjà commencé. Quel ! A ces hommes à qui il manquait souverainement la conscience du drame, (pendant cinquante ans l’adultère suffit à leur composer un monde tragique) à ces hommes sans imagination, la surprise effrayante devait apparaître comme le dernier mot de l’horreur. La mort même n’est plus le pire châtiment, car les bombes et les balles tuent vite et sans souffrance. Mais ces retraités qui toute leur vie ont cru qu’une présence quotidienne dans un quelconque bureau leur permettait d’abolir leur esprit leur âme et leur corps – et qui se retrouvent, à la veille des vieillesses dépossédés de cela seul à quoi ils tenaient : la rente viagère… Mais ces commerçants, ces paysans, ces directeurs de banques qui traitaient de monstre du bizarre tout ce qui les dégageait de leur comptoir ou de leur ferme et qui n’ont plus ni l’un ni l’autre et, parfois, plus de famille… Mais ces professeurs qui ne savent plus ou qui n’osent plus (enfin !) enseigner leurs petits manuels de littérature sans art, d’histoire sans pensée, de science sans dieu… qui dira, qui chantera leur angoisse plus horrible de n’être pas prévue ?
Nous ne serions pas ce que nous voulons être si nous n’adressions pas à ces êtres meurtris un regard de grande pitié. Mais nous ne pourrons pas faire que cette pitié même ne soit pas méprisante, car ils se sont rayés de ceux que nous étudions – la phalange haute des vivants.
Alors ?
Alors, nous écoutons ceux qui naissent à peine, nos enfants, – et nos frères cadets. Nous comprenons leurs plaintes égarées, leur effarement d’ouvrir les yeux dans un monde qiu ne croit plus à ses propres piliers. Et leurs désirs et leurs soupirs et leur effort vers la lumière nous pénètrent d’une joie profonde, car nous ne serons pas pour eux ce que nos pères furent pour nous. Nous ne nous isolerons pas de leur chasse patiente. Nous ne leur serviront pas ces sortes d’assiettes anglaises où le bon sens, l’expérience, et les plaisirs permis font un mets séduisant – pour celui qui l’apprête. Nous n’opposerons plus des gestes mesurés à leur violente ardeur. Et pour qu’ils comprennent bien que nous ne sommes pas leurs juges nous voulons – moi, je veux, mon fils, t’apprendre l’effort patient de ma pensée.
Naissance
A l’origine, je dédiais à l’homme tout pouvoir – j’établissais ce postulat premier que l’Esprit est le maître. C’était un peu primitif, j’en conviens. Mais il me fallait bien remonter le cours des âges.
J’admettais, par ailleurs, que nous ne savions rien que le progrès accompli était inexistant et que nous ne pouvions compter ni sur la preuve des sens, encore moins sur celle des consciences. En cela j’étais seulement de mon époque – non de celle de Clément Vautel, mais de celle de Freud et de Bergson.
Cette similitude ne m’importait pas. Mais, tout au contraire, l’antinomie qui se dessinait en moi : nous pouvons tout, nous ne savons rien. Antinomie qui se réduisait, bientôt en celle-ci, plus concise : il faut douter et croire. Qu’une telle position me classât dès l’abord dans la chambre des fous, je ne m’en souciais pas. Car il ne s’agissait pas, déjà, d’une logique (toutes les logiques étaient numérotées, classées, hors d’usage) mais d’une vraie façon de vivre la vie.
A cette antinomie vinrent s’en ajouter d’autres qu’il n’est pas temps de dévoiler. Mais six mois plus tard, j’échouais sur la pierre d’assise : l’Obstacle. Il m’apparut que les hommes avaient pu déserter la route droite, la route nette qui monte, et qui monte sans cesse – parce qu’ils avaient eu l’effroi des obstacles. La vérité leur importait moins, la santé, le bonheur même leur importait moins qu’une certaine façon d’avoir l’esprit tranquille, la chair et l’âme tranquilles. D’où la terreur des lois qui se contredisent, des exercices non enseignés, des passions exaltantes. Ils voulaient bien souffrir (car comment l’éviter dans la pire paresse !) mais refusaient d’être autre et dans la crainte qu’on veuille les guérir, refusaient aussi d’avouer leur souffrance.
Cela compris, restait à entretenir l’obstacle. Je n’y eus pas mérite. Pour qui le veut, l’obstacle se présente de lui-même. L’incompréhension des vieux patentés, la nécessité de gagner de l’argent, le souhait d’aimer qui ne vous aime pas – et en plus, et surtout, l’effort constant à ne rien admettre qu’on ne puisse quelque jour rejeter – cela donne, après cinq ans seulement de patience, un joli entraînement à la vie périlleuse.
Certaines antinomies, d’ailleurs, furent fulgurantes. C’est ainsi que le procès des morales terminé, trois œuvres s’élevaient droites et pures au-dessus des ruines misérables : la Bible, le Banquet et les quatre Evangiles. Trois œuvres irréductibles, hélas ! les unes aux autres, j’écris hélas ! car, alors,je le pensais – et pourtant rien n’était plus chargé de sens que ce triple isolement.
Hanté cependant par les principes anciens je perdis du temps, combien de temps ? Je ne sais, à vouloir résoudre le problème dans le sens facile d’une synthèse. C’était à renouveler l’erreur de Plotin. Mais je ne le compris pas tout de suite. Mieux : cette synthèse s’organisait, tant il est vrai qu’on croit sans peine ce qu’on veut croire. Samson revivait en Hercule – qui lui-même survivait en Saint Christophe – Salomon et Saint Louis éclairaient Pythagore. Macchabée annonçait Alcibiade et Saint Dominique, – où m’entraînait cette pente trop aisée ? Je n’y voulais pas penser. Je reniais la loi d’obstacle. Paris et ses cercles mystiques, l’accueil des penseurs chimériques à mes divagations, m’avertirent du danger.
J’’ai connu de ces vieux à l’âme toujours chaste
Portant, spectres blafards que le regret dévaste,
L’inutile fardeau de leur virginité.
Et j’ai tremblé, sachant que si j’avais été
Moins désireux de vivre et moins pétri de grâce,
Dans cette foule vaine, aussi, j’avais ma place.
Mais enfin, ma folie prit fin. Je refusai de mentir, pour le pauvre appareil d’une Muse séduisante, à mon destin chercheur.
Alors vint l’isolement forcé, la magique solitude. Un an sans livres, et presque sans pensée ; l’œil ouvert sur les choses, sur les oiseaux, les fleurs ; le bain dans le réel, les marches assagies – l’extase provoquée par des rayons de soleil dans une mare de gasoil – les mots simples – l’oubli de soi.
Le jour où le goût d’une pomme me parvint, primitif et désaccoutumé, le jour où je pus, ensemble, entretenir des pensées si contraires que celles-ci – : je suis immortel mais je suis mortel. Le jour où je tins pour vrai et digne de prolongement tout élan de mon âme, je fus sauvé des hommes et de leur vocabulaire – je m’entretins de Dieu face à face avec lui. Et le travail prodigieux commença.
Oui, sur un autre plan et comme d’une montagne jamais escaladée. Mais sans perdre jamais la mesure des hommes. Loin d’eux, non pas hors d’eux, et sans renier jamais leur conscience profonde. Contre les Instituts et les Académies, contre les enseigneurs et les dicteurs de lois – contre les inciteurs aux paresses légales, mais avec la mère qui pleure son enfant, avec l’adolescent qui s’efforce à comprendre, avec le malheureux qui gâche son bonheur, avec l’artiste las qui contemple son œuvre, avec l’homme sincère qui dit : “Je ne sais pas” – et maintenant, et de plus en plus avec les malades, les hésitants, les angoissés ; avec celui qui cherche une morale, non pas dans la crainte du gendarme de l’enfer ou de son père, mais dans le souci patient de vaincre la douleur, le doute et la tristesse. Et demain, avec ceux qui crieront des abîmes refermés sur leurs têtes : “Je n’ai pas voulu ça”, avec les infirmes, les paralytiques et les névrosés, avec les rejetés de leur première croyance, avec les âmes lasses de ne plus guérir.
Je ne demanderai pas l’aide des Docteurs et des Magistrats – je ne parlerai pas le langage des Ecoles mais une langue que chacun puisse aimer et comprendre. Car je ne prêche pas pour le désert des sables et des amphithéâtres mais pour l’homme qui construit une triple existence dans les ennuis de sa vie quotidienne. Je ne songe pas à juger des bons et des méchants, mais par delà le mal, je rêve d’enseigner à chacun son salut.
Car ce qu’il faut d’abord, c’est éviter de fuir sa mémoire. Il faut livrer sa chair, la livrer toute entière. Retrouver la formule charnelle du poème. Ici commence la réalité : dans un corps de jeune homme, et ce que je suis, mon fils, tu le seras dans vingt ans. Faire de sa chair la complice de l’esprit ; baigner ses yeux dans la conscience du regard, ceindre son cœur d’une heureuse présence.
La morale n’est plus une façon de penser : elle est, au sein des rares qui n’ont pas perverti les données essentielles, une façon de vivre. Elle est devenue, à force de connaissances accrues, d’expériences comprises et de joies retenues, une véritable race.
Nous allons vers ce temps où les éducateurs seront des chefs non pas sur l’appui de fallacieux diplômes, mais au nom d’un génie véritable, conservé, retrouvé par une âme fidèle.
Odes à mon fils
I
Mon fils, toi qui liras ces pages, je veux t’enseigner. La morale de nos derniers temps, l’ultime morale des peuples civilisés, celle qui précéda le refus des dogmes et notre anarchie, cette morale n’était plus viable. Il ne faut pas la regretter. Elle était allée dans l’absurdité aussi loin qu’il fallait qu’elle aille pour n’être plus qu’une chose morte ; délibérément, elle avait trahi l’essence de l’homme. Elle n’était plus qu’un catéchisme pour cadavres. Elle était arrivée à l’envers d’elle-même, sa propre négation. Créée pour aiguiller la vertu de l’homme vers ses fins naturelles et pour servir de base aux élans de son âme, elle était parvenue à nier cette vertu et ces élans. Elle condamnait toutes les puissances nobles au profit d’éléments de mort. Et quand je t’aurai dit que la passion lui était suspecte, qu’elle bafouait le désintéressement, interdisait l’idée de sacrifice, qu’elle étouffait l’Idée lumineuse par des raisonnements savants, qu’elle niait la beauté et troquait la justice contre une raison d’Etat qu’elle n’expliquait pas, je ne t’aurai pas avoué le plus terrible : car cette morale, mon fils, édifiait au Besoin un Temple colossal et se scandalisait de nos derniers Désirs, et tentait de détruire par toutes les violences ce qui restait en nous de ces états divins.
C’est assez, cette époque m’a fait rougir de l’homme. C’était le temps où la politique ne rêvait plus que d’assouvir la bête, où tout était licite qui ne fut de la vie, où tout acte était enterré sous le voile épais de l’habitude, emprisonné dans les murailles de la possession. Et plus personne ne pouvait fuir l’enfer si ce n’était, comme le tentèrent certains, par la négation de leur âme.
De ces pionniers égarés dans la brousse par haine des chemins droits, peu tinrent jusqu’au bout la gageure. La folie, la prison, l’isolement, le suicide en délivrèrent le monde.
Quant à leur œuvre, elle ne fut qu’une raillerie, une pirouette de clown.
Mais leur manière de diminuer l’homme fut si directe et si rapide qu’ils en gardent à mes yeux une auréole de gloire.
Sans eux, sans la brutalité qu’ils mirent à leur ouvrage, serions-nous maintenant saufs du pire ? La civilisation et son fronton moral était l’admiration du monde. Eux seuls ne s’y laissèrent pas prendre. Les premiers, ils comprirent que l’immense bâtisse était construite sur pilotis. Plongeurs silencieux, ils atteignirent les profondeurs et, ne découvrant que des rondins pourris que grignotaient des rats, ils eurent pitié de ceux qui valsaient dans les salles et regardaient la lune à travers les fenêtres. À coup de hache, ils s’acharnèrent. À grands coups de cette hache terrible qu’est le Rire, ils condamnèrent à mort danseurs et lunatiques.
A nous, mon fils, à toi, sans doute, l’autre tâche appartient. Ce n’est pas des deux la plus simple, car la construction doit être très lente, et nous devrons aussi travailler dans le fleuve longtemps, sans doute, pour établir seulement les fondations. Et les survivants, réfugiés en hâte sur les rives barbares, avec les rats qui ont fui le naufrage, ne devineront pas notre travail sous-marin avant que les premières pierres ne surgissent de l’onde, – et leurs cris d’admiration ne s’élèveront que, tard, pour saluer les heureux maçons qui décoreront de drapeaux la plus haute terrasse.
II
Premier essai de paysage mystique
Un mur au soleil, dans une cour blanche, et cette île entourée de grèves où nous reposions, la fiancée et moi, au bord des falaises, parmi les œillets bleus que nous cachait l’herbe dorée… Et cette autre fille aux jambes de statue, Hélène ! Enfant tardive, femme précoce, sur une autre plage, vers la mer… Jours de clarté et de rédemption !
Oui, ces jours-là, j’ai mérité la vie : une fraîche tiédeur, comme un vin de Bourgogne que l’on boit au réveil, coulait dans mon sang, parfumait mes lèvres. Ah ! que tout besoin était loin de nous quand nous n’avions en nous que cette soif délicieuse et la douceur de cette soif.
Or, cet instant est incommunicable. Le vivant seul connaît la vie. Et la joie est cette chose qu’on n’attend ni ne désire avant de l’avoir connue, puisqu’on ne peut pas, même, pressentir qu’elle existe, – et qu’on n’espère, l’ayant connue, pas plus que revivre un beau rêve.
Soleil de Mars, joyeuse rémission des heures creuses, et, dans mon âme, une égale clarté quand je revis ces fertiles dépenses.
Nous situerons ce lieu de la plus haute vertu, mon fils, sous un ciel hivernal, car la légèreté de l’air et une certaine froidure sont ses marques premières. L’homme aigri s’exprime par symboles. Nous serons, nous autres, à semblable distance de la violence et de la fatigue, une excitation agréable étant le moyen terme des souffrances qui nous pressent.
Je devine d’abord une haute muraille percée de fenêtres au bout d’une allée très claire, et les arbres encore dépouillés sous le soleil de Mars ; le ciel, toujours, au dessus de nous, comme une cloche de cristal, et, seule verdure, à droite, deux buissons de houx.
Nous sommes en ce lieu, mon fils, par la grâce de Dieu. D’un Dieu auquel n’entendent rien les montreurs de lanterne magique, – parce qu’ils gâchent les dons qu’ils ont reçus de lui. Et nous y sommes pour être ses images. Ceci n’est pas un rêve.
III
Je n’en finirais pas de te dire mes raisons. Et si cette morale n’est qu’une des expressions de mon désir d’évasion, sache que ce désir procède d’une source pure. Mais, je conçois qu’un désir de prison puisse être aussi parfait dans sa tragique erreur. La fausse voie n’est pas de se rêver meilleur, mais de dépouiller son propre choix de sa virginité. Se diminuer en face de Dieu, c’est trahir Dieu. Pourquoi le remords est crime impardonnable.
Et pourquoi tant de joies, si contradictoires, sont données à l’homme qui sait les vouloir.
Il se découvre à moi, dans la paix de mon cœur et le silence des choses, une origine qui serait finalité, une vie légère comme l’imperceptible avance du danseur de corde sur le fil tendu. Il se découvre : que dis-je ? Cette vraie vie est sous ma main. Heureux l’enfant qu’une vigilance tient en garde des péchés ! Heureuse la jeune fille qui nait à l’amour, pour qui rien ne compte plus qu’un visage d’homme dur aux yeux droits ! Heureux celui qui vit au rythme de son Dieu, même si ce dieu n’est qu’une idole ! Là réside seulement une triomphante et douce liberté. Et là seulement, – dans cette bienheureuse ignorance, – est la joie de la vie, le jardin merveilleux, le Royaume des Anges.
Toute croyance est un jalon qu’on pose. Et nous sommes, mon fils, les petits Poucets de l’éternité. Emplis au seuil de la vie, emplis ton âme de crédules espoirs. Tu n’en auras jamais trop à perdre si tu veux retrouver ton chemin, et surtout, le chemin du retour.
Je n’ai jamais perdu un seul espoir, sans la connaissance que je le retrouverai au lieu du scandale, sans la confiance au signe qu’il me fera dans un instant désespéré.
Une musique lointaine d’une maison toute blanche enchante les novices sous le préau plein d’ombre. Ainsi me charme aussi la romance de l’Adieu, des adieux incertains que j’ai dit à mes rêves. Et personne plus que moi n’a vécu dans la joie d’être doué de mémoire. Entends que je parle du souvenir, non du Regret, – son envers diabolique.
Pour ces souvenirs là, une prière incessante monte de moi vers un Dieu. Et quand même je n’aurais d’autres preuves de sa toute existence, je croirais en Lui parce qu’il me souvient des bonheurs passés.
Première partie
DES ORIGINES ET DE LA NATURE DE LA MORALE
Toutes ces questions s’enchevêtrent dans mon crâne comme les nuages d’un ciel d’été aux fils télégraphiques des routes nationales. Je connais bien l’insurmontable de ma tâche. Quoi ? Me poser d’abord en historien et reprendre la morale depuis ses origines ? Le pourrais-je sans voir et faire voir dans cette histoire même une preuve tangible de mon éthique et ne serais-je pas alors accusé justement de préjugés et d’idées préconçues ? Ou, plutôt, exposer les éléments nus de ma méthode sans les voiler d’exemples ? Mais que ne faut-il pas prouver avant d’affirmer ? N’est-il pas décidé qu’il en doit être ainsi ?
Certes, la vie n’a pas de ces dilemmes. Mais la vérité est encore ce qu’on peut le moins dire. Que penserait-on de moi si j’écrivais : Tel jour, il m’est apparu que la circoncision des juifs n’avait d’autre utilité qu’une hygiène élémentaire, et, ce même jour, j’ai connu que le cycle accidentel s’établissait ainsi : Appétit, – Conscience, – Volonté, – Appétit. Quel lien, me demanderait-on, existe entre ces deux inégales découvertes ? Aucun. Mais c’est ainsi que procède l’esprit. L’homme qui cherche contrôle à toute heure son expérience par sa raison, c’est cela même, – cette patiente interréaction, – que nul ouvrage philosophique ne peut rendre.
A ce problème, il y a bien une solution : la rédaction sous forme d’aphorismes ou de maximes, méthode également chère à la Rochefoucauld et à Nietzsche. Mais, il me déplait de jouer à l’esthète. On croit écrire les Pensées de Pascal, et l’on compose les pensées d’un Emballeur. Je n’aime pas à m’amuser avec les astres : on risque de se brûler les doigts.
Je préfère, – tout simplement, – tricher. Tricher avec la plus grande loyauté, en prévenant que je triche.
Voilà : ce sera comme un jeu de société. Je vais feindre d’être un homme hors nature en qui les théories naissent tout équipées, comme on dit que Minerve sortit du crâne de Jupiter. Tout le monde saura que ce n’est pas vrai, mais je demande à chacun de faire semblant d’y croire.
ORIGINES DE LA MORALE
1. Morale nécessaire.
Pour quiconque réfléchit sur l’origine possible de la morale, il apparaît si incompréhensible que l’homme, volontairement, se soit soumis à une loi, qu’on est tenté d’attribuer à cette loi un caractère terrible de nécessité.
Elle le possédait, en effet, comme toute condition sine qua non de la vie.
2. Morale et dualité.
Le caractère de nécessité fatale de la loi, ,universellement reconnu, – quelle que soit, par ailleurs, la loi à laquelle on l’applique, – ce caractère a fait naître deux réponses au problème des origines de la morale.
Première réponse : La loi morale est de révélation divine. (Chateaubriand a cru subtiliser cette réponse en exprimant que l’idée morale est née de l’idée d’une vie future.)
Deuxième réponse : La morale est l’invention des prêtres et des docteurs, qui virent dans les lois sanctionnées le moyen d’assurer leur prestige.
1° Il est absurde de supposer que l’homme, avant même de mourir, ait eu l’idée d’une seconde vie. Or, le premier homme dut connaître la peur de la souffrance et le soin de l’éviter. Et ce soin même était moral en ce qu’il posait l’interdiction et la règle.
2° Il est trop évident que les législateurs n’eussent jamais existé si le besoin d’une loi ne se fut fait sentir. La question n’est pas de savoir si, au début, l’idée morale fut commune à tous les hommes ou l’apanage de quelques-uns ; elle est d’expliquer comment une idée aussi étrange que celle de l’obéissance à une discipline a pu se faire jour parmi les hommes.
|
Morale et au-delà
|
L’homme n’est pas devenu moral parce qu’il se croyait immortel.Il n’est pas devenu moral par suite de la ruse d’un législateur. Mais il s’est donné des législateurs parce qu’il ressentait le besoin d’une loi. Et le sentiment d’une éternité lui est venu de la conscience en lui d’une dualité.Il a fallu, pour qu’il imagine que quelque chose de lui put lui survivre, qu’il sentit en lui deux parties, dont l’une lui parût plus durable que l’autre (ainsi des enfants qui trouvent deux brins de paille s’amusent à les comparer). Et cette dualité, elle-même, n’a pu naître, comme toutes les dualités, que d’une opposition, c’est à dire d’un combat, combat qui n’est autre que l’expression violente d’une contrainte morale imposée par l’homme à lui-même. L’homme s’est cru immortel pare qu’il était moral. |
3. L’homme primitif.
Je voudrais qu’on comprenne bien ceci : l’erreur la plus commune de qui se penche sur l’origine de l’homme est de tenter de résoudre intellectuellement le problème.
Certes, l’explication théologique : “L’homme a ressenti le besoin d’une loi parce que Dieu l’avait créé ainsi” ne me satisfait pas et ne m’explique rien. Mais, je la préfère aux théories de certains philosophes (à ce point embrouillées que bien peu d’hommes modernes peuvent les comprendre) que leurs auteurs nous présentent comme la genèse exacte de la pensée morale dans le cerveau d’un nègre de l’Afrique centrale ou, mieux, dans le crâne d’un de nos premiers pères.
Quelle que soit la légende admise des commencements du monde, l’homme primitif apparaît toujours à travers papyrus, pierres gravées, etc…, ce que nous le voyons dans les terres africaines ou les îles océanes : un être uniquement physique. Il ne vit que de sensations, et ses sens sont le seul rapport qui existe de lui au monde.
Il s’ensuit que le problème de la dualité (et de la morale) est insoluble si la sensation primitive est une, car il n’est pas possible d’imaginer qu’un rapport simple donne naissance à l’idée de combat. Au contraire, le problème est résolu si la sensation est double.
4. Vivre, c’est assimiler.
Toutes les actions physiques de l’homme ne tendent qu’à l’assimilation : assimilation de la nourriture, du silence (par le sommeil), des couleurs, des sons ; ce monde physique est essentiellement celui du Je-Lui plutôt que celui du “Je ou Lui”. Car, l’être qui n’assimile pas ne détruit pas tout rapport : on voit des yeux fermés, on touche des mains immobiles. Celui qui ne prend pas est pris, – celui qui n’assimile pas est assimilé.
Cette loi fondamentale, l’homme la découvre par le spectacle des choses : l’herbe courbée par le vent, l’insecte poursuivi par l’oiseau, la nuit victorieuse du jour et vaincue par lui.
5. La sensation passive.
Surtout, cette loi, il la découvre en lui-même.
Condillac imaginait que, à l’origine, toute sensation était plaisante ou neutre. Mais il n’y a pas d’exemple qu’une sensation passive soit un plaisir. Et, à l’origine, toute sensation dut être passive puisqu’elle était inattendue.
Ce que j’entends par sensation passive ? l’étranger, l’indésirable, le surprenant : ce qui vient des choses et non pas de nous.
Je cueille une fleur : sensation active, – plaisir.
La fleur me pique : sensation passive, – douleur.
Toute la dualité et ce qui en résulte naît de ces deux actes, dont l’un est agi par moi et l’autre subi. Cette dualité nous semble peut-être, à nous, hommes du vingtième siècle, enrichis d’un esprit et d’une âme, d’une importance très relative. Il n’en allait pas ainsi du premier homme : à peine ouvre-t-il les yeux, il lui faut agir ou subir, être le but ou le départ de l’acte.
Les philosophes admettent aujourd’hui que l’univers lui est d’abord apparu sous la forme d’un chaos de lumières et de plans duquel l’homme primitif, de même que l’enfant de nos jours, son image, ne recevait qu’une impression confuse, et que je nomme la sensation passive.
|
L’enfant
|
L’enfant peut nous fournir un excellent exemple : ses petites mains toujours en quête, ses yeux cillant, sa bouche hésitante, le moindre de ses gestes indique la peur de l’inconnu. L’enfant naît avec la peur en lui. La peur de quoi ? de tout ce qui peut venir. |
C’est pourquoi l’enfant se rapproche avec prédilection de sa mère, univers connu, familier. Dans le chaos des images effrayantes, le visage de la mère représente l’élément rassurant : l’image que sa présence a isolé des autres. Et le premier rire de l’enfant, – son premier plaisir, – éclate toujours dans l’instant où le visage de la mère est penché sur le sien. Expérience précieuse ; l’instant du premier rire est aussi celui de la première sensation active de l’enfant.
6. La sensation active.
L’homme primitif a connu les mêmes effrois et le même labeur que nous révèlent les larmes et le rire du nouveau-né. Il a fallu qu’il apprenne à regarder avant de voir, apprenne avant d’entendre à écouter. Il lui a fallu respirer avant de sentir, toucher avant de prendre. Rien n’existait pour lui que des présences : ce qui s’impose par la lumière, le son ou le contact, – c’est à dire le mouvement.
L’univers, pour un tel être, épouse deux aspects : ce qui était là et n’y est pas, – ce qui n’y était pas et qui s’y trouve : un oiseau disparaît dans le ciel, la nuit vient. Il ne comprend pas que la dualité qu’il se crée est fausse ou que, du moins, elle recouvre une autre, toute différente : le renouvellement et le changement.
Il marche : plaisir. Quelque chose vient : fatigue ou pierre sur le chemin : douleur. Qu’irait-il chercher au-delà ? Puisque tout inattendu le frappe, l’important pour lui est de tout attendre. Puisque tout imprévu le blesse, l’important est de tout prévoir.
D’où la valeur, chez les primitifs, du présage.
D’où aussi la valeur, pour eux, de la grimace.
|
La grimace
|
L’enfant peut nous être encore, sur ce point, d’une observation féconde : la grimace de l’enfant m’est longtemps apparue comme un étrange mystère, quel démon pousse mon fils à distendre ses lèvres, à cligner des yeux, à tendre son front ? Les totems et les masques d’horreur nous sont une preuve de ce que, pour les primitifs, la grimace ne présentait pas une valeur moindre. Et, pour eux comme pour mon fils, cette valeur est grande, en effet : la grimace est l’acte par lequel l’homme physique prend conscience de sa liberté. |
7. Celui qui se donne prend.
Je voudrais placer toute cette étude sous le signe de cette antinomie apparemment insoutenable : celui qui se donne prend et gagne. Celui qui refuse est pris et perd.
L’homme devint moral parce que, vivre, c’est choisir entre la sensation subie et la sensation agissante. Il fallait, dit le bon sens populaire, dévorer ou être dévoré. ce qui s’énonce : il faut donner ou recevoir.
La nécessité du don, sur le plan physique, ne fut pas le résultat d’une considération altruiste, mais une nécessité vitale. Regarder, c’est donner ses yeux. écouter, c’est donner ses oreilles. Celui qui se ferme, qui refuse d’agir est pris dans le tourbillon des forces agissantes. Dans un univers d’action, la passivité, c’est la mort. L’homme, dans sa faiblesse première, ne peut prendre qu’en se donnant tout entier. Car la douleur est le seul don des choses à l’homme. Et le don de l’homme à l’univers, c’est le geste de celui qui prend.
8. Morale et liberté.
Peu à peu, l’accoutumance et l’attention aidant, l’homme sépara les couleurs et les formes, perçut distinctement des sons et des odeurs. Il sut l’art du toucher et ses raffinements : la caresse et la meurtrissure.
|
La cruauté
|
La cruauté de l’homme primitif ou de l’enfant a la même origine que la grimace. l’une et l’autre, d’ailleurs, sont inconnues des bêtes. L’animal le plus sauvage tue pour se nourrir ou pour se défendre. L’homme physique et l’enfant sauvage font souffrir pour le plaisir de faire souffrir, par recherche gratuite de sensations actives. |
En somme, la densité de certaines sensations les isola des autres. Mais cette densité provenait de l’homme et non pas des choses : elle était la part active de la sensation. elle était la “liberté” de l’homme.
Et ce fut pour sauvegarder et pour agrandir cette part de liberté que l’homme devint moral, c’est à dire qu’il s’obligea à ne pas se laisser diriger par le monde extérieur, qu’il préféra se soumettre à soi (à la part savante de soi) plutôt qu’aux choses.
9. Le péché originel.
Si nous quittons le domaine de raisonnement pour pénétrer dans celui de l’hypothèse, la question la plus irritante qui se pose est celle du péché originel. Si la Bible était l’unique document qui fit mention de cet événement, nous pourrions peut-être le négliger. Mais toutes les religions et toutes les légendes parlent de cet étrange crime de l’homme (et Prométhée dérobant le feu divin est bien ce même Adam qui ambitionne le fruit de l’arbre de science). Surtout, les conséquences de cette révolte sont encore visibles de nos jours. Le problème du péché originel est, en effet, tout semblable à cet autre : que s’est-il passé dans la nuit des temps qui a isolé l’homme de l’univers ? Ou, sous une forme plus philosophique, pourquoi l’homme, seul de tous les animaux, s’est-il voulu libre ?
Il est trop évident que si notre raisonnement explique la naissance d’une dualité en l’homme (et par suite de l’idée morale), il n’explique pas pourquoi les animaux, bien que, pour eux comme pour nous, la sensation fût double, n’ont pas accédé aux mêmes idées de morale, de liberté, d’au-delà.
Résoudre le problème du péché originel reviendrait à résoudre cette question : “Pourquoi l’homme, seul de tous les animaux, est-il cruel ? Pourquoi est-il grimacier ? Pourquoi, – troisième expression primaire de son désir de liberté, – pourquoi est-il doué de parole ?
Cette question est d’une importance extraordinaire : y répondre serait marquer la limite qui sépare l’homme de l’animal et, tout ensemble, marquer le départ de l’idée de progrès, établir la cause première de cette course haletante vers son triomphe ou vers sa chute que l’humanité mène depuis le début des temps.
10. La liberté et la souffrance.
La question peut encore être posée ainsi :
“D’où est venu à l’homme le désir de liberté ?”
Les êtres vivants ne sont pas libres. Une graine tombe contre un mur et meurt. Trois pas plus loin, elle serait devenue un arbre. Et cet arbre lui-même pousserait selon la règle naturelle dans le seul espace qui lui serait réservé. Un jeune loup court dans la forêt : s’il a faim, il cherche à manger. S’il trouve une proie, il la tue et la mange. S’il n’en trouve pas, il meurt. Et lui aussi obéit à sa loi : il ne montera pas sur une louve enceinte. Pourquoi ? La réponse est trop évidente : parce que son acte ne la procréerait pas.
La part active du végétal est presque nulle : si ce n’est de tendre vers la lumière. La part active de l’animal est plus grande. Plus grande aussi l’intensité de ses douleurs et ses plaisirs. Mais plaisirs et douleurs le frappent tour à tour sans que jamais il ne tente d’accroître les plaisirs et de vaincre les douleurs aux dépens de la loi. Tout être vivant apparaît comme esclave de la loi de sa race, – tout être, sauf l’homme. Et son histoire n’est que la recherche desespérée de cette loi perdue, au regard de laquelle, si elle est retrouvée, toutes les morales et tous les dogmes apparaîtront comme de très pauvres palliatifs.
Comment l’homme a-t-il perdu cette loi ?
Pourquoi tente-t-il de la retrouver ?
Il l’a perdue en s’efforçant vers la liberté.
Les recherches scientifiques semblent prouver que l’homme primitif était, de beaucoup, l’être le plus faible de la création :
Sans moyen de défense, – ni fourrure ni écailles. – N’ayant pour fuir ni les ailes de l’oiseau, ni les pattes agiles du chevreuil, ni les nageoires du poisson.
Sans moyen d’attaque : ni dents acérées ni griffes redoutables.
Les singes de l’Afrique, suffisamment armés étant donné leur grande taille, nous donnent un exemple d’effort vers la liberté, – analogue, bien que moindre, à celui de l’homme, – avec leur langage inarticulé et les branches qu’ils dérobent aux arbres pour s’en faire des massues.
Ainsi, la réponse la plus simple à la question posée semblerait être : “l’homme est, de tous les êtres, celui dont le désir de liberté a été le plus vif parce qu’il était, de tous, le plus sensible et le moins défendu”.
NATURE DE LA MORALE
11. Le Désir et le Besoin
Il résulte de tout ceci que les notions de morale et de liberté coïncident. Qu’elle s’exprime sous forme d’acte (vie physique), de libre arbitre (vie intellectuelle), de mouvement (vie spirituelle), la liberté n’est pas autre chose que le désir de soumettre pour n’être pas soumis. Elle n’est même que le Désir, – car le désir, sous toutes ses formes, n’est qu’un souci de liberté. En quoi, il s’oppose au Besoin, qui est obligation, esclavage, nécessité. L’animal n’a que des besoins. L’homme seul possède des désirs. C’est la raison pour quoi il est moral.
12. Premiers aperçus sur l’histoire morale de l’Humanité.
L’étude de la vie végétative et animale nous enseigne que la liberté et la douleur sont dans un rapport constant. L’activité et la souffrance naissent ensemble, les pierres ne souffrent pas. Mais les fleurs, les plantes et les arbres sont doués de la faculté de souffrir. Et bien plus encore les êtres mobiles comme les animaux.
L’étude médicale de l’homme nous fortifie dans cette certitude : l’être le plus libre, le plus instruit, le plus dégagé de toute loi, celui-là peut souffrir mille fois plus que les autres. Celui qui est arrivé au stade du Désir peut être frappé par n’importe quoi, à toute heure du jour : car tout peut lui être prétexte à désir.
Il était donc naturel que certains hommes tentent de réagir contre le désir de liberté de l’homme. C’est la réponse à la question que je posais : Pourquoi l’homme tente-t-il de retrouver sa loi ?
Il le tente parce qu’il est las de trop souffrir.
Cette mise au point était nécessaire pour expliquer la redoutable antinomie que pose l’histoire morale de l’humanité.
En effet, pour quiconque a compris la vérité de la double identité : morale = liberté = désir, il peut sembler étonnant et pénible que les doctrines humaines aient erré si longtemps dans un méandre de doctrines et de lois.
L’explication en est que, tandis que certains moralistes énonçaient parfaitement l’axiome du progrès moral : morale = désir, d’autres moralistes se tournaient, au contraire, vers l’ancienne loi perdue, énonçaient cet axiome : morale = obéissance = besoin.
Depuis des milliers d’années, ces deux espèces d’hommes existent en même temps, enseignent en même temps sur les places publiques. Et il se produisait ceci, qu’on peut ne pas comprendre : les prêtres de la loi paraissaient toujours triompher des autres, soit en les tuant, soit en les torturant, soit en leur ôtant le droit de parole, mais, en fait, ce furent ces autres : les prêtres du désir, qui l’emportèrent toujours, même au delà de la mort, et contraignirent les hommes au progrès. S’il n’en était pas ainsi, il n’y aurait eu des prêtres de la loi. Une loi suffisait, dès l’instant qu’elle était obéie. Mais l’humanité a connu cent mille lois et s’en cherche une, une fois encore.
Je voudrais que l’on m’entende : un homme dit : ” Ceci est la loi. Peu importe qu’elle soit mauvaise ou bonne. Une loi n’est jamais mauvaise : c’est la loi. Obéissez, et je vous sauve de la douleur.” On lui obéit. Alors, un autre homme se lève et dit : “Cette loi est mauvaise. Elle est mauvaise parce qu’elle est loi, c’est à dire inactuelle, arbitraire, immobilisante. L’homme ne peut se sauver qu’en allant au-delà. Et voici, moi, ce que j’enseigne.” Le premier homme tue le second et, le jour venu, il meurt. Alors, d’autres se lèvent, érigent l’enseignement-désir du prophète en une nouvelle loi, et le cycle se reproduit. C’est ainsi que le Christ, tué par les Juifs, triomphe de leur doctrine, et c’est ainsi que son enseignement-désir, repris par saint Paul, devient une nouvelle loi. Ce fut ainsi, avant lui, que Socrate, vainqueur dans la mort, réduisit à néant les lois des Philosophes, et que Platon, s’emparant de son enseignement-désir, en fit une doctrine.
13. Chercheurs et Législateurs.
Ce double courant est trop manifeste et trop continu pour qu’il ne recèle pas un important secret.
Et, certes, il peut sembler étrange que ce secret soit encore à découvrir. La raison en est que l’étude objective de l’histoire des morales est demeurée, de toutes les études historiques, la plus stérile et la plus imparfaite.
Le moins partial des philosophes, des historiens, dès qu’il s’attaque au problème de la morale, soit qu’il en défende une, soit qu’il les rejette toutes, devient un sectaire. Dans l’un et l’autre cas, seul guide sa recherche le souci de faire une lumière éclatante sur telle question particulière dont dépend son propre bonheur. Il traite des autres questions, bien sûr. Mais il n’étudie à fond que l’objet de son effroi. Plus que toutes les sciences et toutes les philosophies, étude dans laquelle se fondent toutes les autres, la morale est ce qui tient au sang, au ventre, aux membres de l’homme autant que sa vie.
La morale et la peur
Le guerrier, que la mort du feu dont il avait la garde condamnait à la sienne propre, n’avait d’attention et de soin que pour ne pas le laisser éteindre. Mais quand la flamme lui fut devenue familière et facile, il en a cherché le pourquoi.
Aujourd’hui, où nos philosophes feignent de s’interroger sur l’utilité de la morale, il était bon de rappeler ceci : toutes les philosophies, et partant toutes les sciences qui en découlent, sont filles de cette mère.
Soit un fait donné : la chair d’un homme se couvre de pustules horribles, sa peau se fendille et tombe en lambeaux, il dégage une fétide odeur. Devant ce fait, deux attitudes sont possibles : ou songer aux conséquences du mal, contagion, épidémie, destruction de la tribu, ou chercher les causes du mal et tenter de le guérir. La première attitude conduit à une mesure de morale sociale (législation) : isoler le malade, interdire au peuple tout contact avec lui. La seconde conduit à une découverte de morale scientifique : les baumes de Nostradamus contre le choléra.
Soit un autre fait : un homme tue. Le législateur moral envisage les conséquences de l’acte : s’il ne punit le meurtrier, tous les hommes peuvent s’entretuer, et il découvre la nécessité d’un châtiment public : la peine de mort. Le moraliste chercheur se tourne vers les causes de l’acte : qui a conduit le coupable au crime ? Et il découvre la misère, la faim, la haine, la prison, une faille dans l’édifice social.
Ces deux exemples que je pourrais multiplier, indiquent parfaitement comment il se peut que la morale soit, à la fois, une barrière au progrès sous sa forme légale et le facteur essentiel du progrès sous sa forme savante. Et l’on comprend que ces deux attitudes soient aujourd’hui, après je ne sais combien de milliers d’années, les conséquences fatales des deux attitudes primitives de l’homme : l’homme-désir et l’homme-loi.
14. La Morale et la Science.
Il y a donc une sorte de morale au départ de chaque science. La métaphysique, à l’origine recherche de ce qui plaît aux Dieux, lorsque les dieux ne furent plus redoutés, devint l’étude des sources de la vie. Et, dès lors, se séparant de la morale législative, elle s’intéressa aux courses des astres, à l’observation du ciel et, de l’astrologie à l’astronomie, guida l’homme vers la physique. Elle s’intéressa aux organes vivants et de la magie à la médecine introduisit aux éléments de chimie.
La logique, effort vers la clarté de l’esprit, lorsque l’homme crut voir clair, s’achemina vers l’étude de toutes choses et, par les Mathématiques, ouvrit la route aux sciences mécaniques.
Nous verrons de même la psychologie chrétienne se détourner de sa finalité pour parvenir, avec Freud, à la psychanalyse et à la psychiatrie.
Enfin, nous assistons, depuis quelques années, à un revirement plus surprenant encore : la sociologie, base des Morales législatives, suit le chemin de ses aînées. À mesure que le législateur sentit s’assurer son pouvoir, à mesure que la crainte de Dieu, l’émulation, le sentiment grégaire groupaient les races plus étroitement autour d’une gerbe d’idées, le châtiment devint moins nécessaire. La mort fut un recours très rare. La prison, puis l’amende adoucirent la rigueur des juges. La sociologie ne sera plus, demain, que la science des statistiques.
Est-ce que cela signifie que la morale est appelée à disparaître, vaincue par la science ? Devons-nous le souhaiter ?
Les deux questions ne demandent qu’une réponse : Non. La morale, telle que les faiseurs de lois l’ont comprise jusqu’à ce jour, repose sur l’étude des conséquences. Et, par là, elle s’oppose à la science, qui est la recherche des causes. Nous avons vu que, le châtiment diminuant, la morale perdait de sa nécessité. À l’inverse, le danger s’estompant, l’homme tend à la liberté, c’est-à-dire à rejeter toutes barrières.
Ce qui veut dire : la science, en éloignant de l’homme la peur abolit peu à peu les morales formelles (morale = obéissance = besoin), mais, dans le même instant qu’elle diminue le péril par ses découvertes, elle donne à l’homme un désir plus grand de liberté et facilite ainsi l’avènement de la morale-désir. Ses conséquences de l’acte, cessant d’être vitales, perdent tout intérêt. Et l’attention de l’homme se tourne naturellement vers l’explication de l’acte, assuré qu’il est que cette explication lui sera une excuse.
Un exemple ? Il y en a mille, mais je n’en veux qu’un : à toute période de guerre, de troubles ou d’épidémies correspond chez le peuple vaincu, frappé ou malheureux une vague de superstition et de mysticisme.
A l’inverse, plus la vie d’une nation devient aisée, faite de bien être et sans danger, plus s’accentue la recherche des causes, plus se ramifie la science. Le savant, l’homme qui cherche n’est jamais sous la morsure du mal qu’il étudie. Y tombe-t-il ? Il cesse aussitôt d’expliquer pour prévoir. Il devient moraliste.
La science est un divertissement d’homme heureux.
CONCLUSION
L’homme ambitieux et révolté qui, au lendemain de terribles orages et à la veille de jours indécouverts, a fait ce rêve de construire une éthique nouvelle où l’homme se puisse connaître tout entier se doit de tenir compte de l’expérience formidable accumulée par les erreurs et les vertiges des races, des nations et des individus.
Il doit comprendre qu’il lui faut éviter de faire de la morale dont il rêve, aussi bien une loi formelle et pénale qu’une science indifférente à ses propres conséquences. Certes, le législateur qui doit vaincre le mal en tuant le criminel commet une faute redoutable. Mais l’inventeur de la dynamite n’est pas moins dangereux. Alors que le premier ne s’est pas efforcé d’expliquer l’acte de celui qu’il tue, le second ne s’est pas assez inquiété des résultats de son invention. L’un, en s’immobilisant dans la sèche formule du code, l’autre, en se laissant berner par sa chimère étroite du progrès, ont manqué aux premiers devoirs du vrai moraliste, c’est à dire du créateur soucieux de son humanité.
Au législateur, je suis en droit de dire : “Guérir la société avant de guérir l’homme est une utopie de fou. Quand l’homme sera, dans son ensemble, devenu cet animal moral qu’ont rêvé d’être quelques-uns, alors les rapports de la vie commune s’ordonneront naturellement les uns aux autres. Mais construire ces rapports entre des hommes en proie encore à la souffrance et leur donner force de loi, ce n’est pas combattre le mal, c’est le codifier. C’est admettre l’erreur, l’angoisse et la douleur comme des compléments éternels de l’humanité ; c’est, au sens le plus atroce des mots, désespérer de l’homme. Et je peux dire au savant : “S’enfermer dans la recherche des causes, s’attacher au jeu exaltant de faire sourdre des forces nouvelles sans en avoir calculé la portée, entourer l’homme de machines parfaites dans leur loi de destruction sans avoir doué l’homme d’une perfection pour le moins égale, prétendre guérir le mal de tête ou la tuberculose… avant d’avoir guéri la cause profonde du mal et sans qu’on puisse savoir, – telle est notre ignorance, – si les remèdes inventés ne seront pas les causes d’autres calamités, ce n’est pas faire preuve de progrès, mais c’est enfermer l’homme dans un cercle infernal qui va se resserrant.”
Il n’est pas question de supprimer ni l’étude des causes ni l’étude des conséquences, mais de les acclimater.
L’homme n’est plus le demi sauvage en proie à la douleur et quêteur de plaisir.
L’homme ne vit plus sur un seul plan : celui de la présence. Des milliers de morales, de codifications, de recherches et d’études que l’histoire charrie jusqu’à nous, l’homme peut se faire, enfin ! un exact aperçu de ce qu’il fut et de ce qu’il prétendit être. Or, la classification de ces morales reste à faire, si difficile à croire que cela soit, – reste à faire d’un point de vue objectif. La seule classification que nous en ayons (la somme théologique) est l’œuvre de la dernière d’entre elles, la morale spirituelle : il est douteux, à supposer qu’elle ait su analyser celles qui l’avaient précédée, qu’elle ait tenté ce nécessaire examen sur elle-même. Quant à ceux, comme Nietzsche, qui ont voulu combler cette lacune, ils sont tombés dans une erreur toute semblable en ceci qu’ils se posaient en défenseurs d’une précédente morale physique ou intellectuelle et que, par suite, un aspect de la question leur a toujours échappé. Lorsque nous connaîtrons les ambitions des hommes, nous saurons mieux ce que nous sommes devenus et ce à quoi nous pouvons prétendre.
Deuxième partie
LA BIBLE ET LE MALENTENDU PHYSIQUE
I
LA MORALE NATURELLE
15. La vie du corps
Durant des milliers d’années, les Egyptiens, les Chaldéens, les Hébreux (tous des sémites) ont combattu le mal physique par des lois qui tendaient à limiter ce mal, à le réduire. Ils avaient devant leurs yeux l’univers vrai et leur propre misère en eux. Ils devaient se défendre avec leur corps seul, comme ils ne souffraient que dans leur chair seule.
Ces souffrances, nous ne pouvons qu’à peine les imaginer. Les ressentir nous est impossible. Cette acuité merveilleuse des sensations ne peut nous être révélée que par la triple étude de l’enfant, de l’homme sauvage et des livres anciens.
A – L’enfant vit dans le monde des sens, à l’exclusion des autres, ce pour quoi il nous est, souvent, difficilement saisissable. Sa psychologie (il serait plus exact d’écrire : sa physiologie, mais je me ferais mal comprendre) se dévoile dans un sursaut, un geste, un cri – toujours un réflexe.
Des enfants dansaient en rond. Quelque chose vient que nos sens d’homme ne perçoivent pas : un changement de température, une qualité de couleur du ciel, et la danse se fait plus molle, plus alanguie, les mains se désunissent, les enfants se regardent et rient.
Les peines du petit enfant ne sont que physiques. Mais ce sont des peines si violentes qu’elles nous semblent aller jusqu’au désespoir (ce que nous nommons désespoir par ignorance de ce degré de douleur physique). L’enfant crie pendant des heures ; les langes enlevés, que découvre-t-on ? Une piqure d’épingle.
B – Les larmes et le rire ne sont chez le nègre ni moins violents ni moins répétés. Un bibelot qui brille, un son harmonieux, une odeur vive l’enchante à l’excès. Sa gourmandise est proverbiale, de même que son goût pour le bruit, les bijoux, les parures. Mais un coup de fouet lui arrache des hurlements.
Encore nous faut-il bien admettre que ces exemples sont très insuffisants. L’enfant du XXe siècle est l’héritier de plusieurs milliers d’années d’histoire ; à peine s’il parle et comprend la parole, notre langage ressuscite en lui le double héritage intellectuel et spirituel – ce n’est jamais l’être physique à l’état pur, sauf peut-être dans ses premiers mois, alors que son étude est pénible et stérile. Quant au noir de certaines contrées d’Afrique et d’Océanie, il ne représente pas seulement le type de l’inévolué mais aussi le type de l’inévoluable.
Dans un cas comme dans l’autre, nous ne pouvons connaître que des velléités de civilisation physique, dont la perfection nous demeure tout à fait étrangère ; elle nous paraîtrait sans doute impossible à réaliser, si nous n’avions les témoignages écrits des papyrus égyptiens et de la Bible.
La Bible est un témoignage douteux en ceci qu’elle ne date guère que de quelques siècles avant Jésus-Christ et que la tradition orale a seule transmis pendant plusieurs milliers d’années les premiers faits de l’histoire juive.
Les papyrus composent un témoignage tronqué, expressions parfois inintelligibles, ouvertures étonnantes sur un monde disparu.
Ici et là cependant, des récits d’événement surnagent dont la sincérité ne peut être mise en doute, à cause même de cette curiosité dont ils marquent nos esprits et nos âmes et qui survit à leur lecture. Ainsi les lentilles de Jacob et d’Esaü ; ainsi ces troublantes maladies des Egyptiens : celui qui ne peut supporter certaines douleurs, celui que la lumière du ciel torture.
Le plaisir et la douleur revêtent pour de pareils êtres une importance vitale . De même que, d’après de récentes découvertes de la science, les nerfs de l’homme ne peuvent supporter certains sons, ainsi la mort devait suivre certaines visions, certaines odeurs. Les premières pages de la Bible nous apportent le parfum d’un univers charnel où le moindre regard de l’homme engageait sa vie.
16. Les lois physiques
A – L’hygiène : la vertu de l’eau.
Des lois dont l’étrangeté nous frappe n’avaient d’autre raison d’être que de tendre à une plus grande hygiène. Ainsi les préceptes d’Abraham sur la Circoncision ôtaient du corps de l’homme le replis de chair le moins pur parce que le plus facile à souiller.
L’abondance de ces lois sur la pureté physique suffirait à prouver l’ordonnancement sensuel de la morale. Et, surtout, cette vertu salvatrice et rédemptrice de l’eau (dont la croyance se poursuivit jusqu’aux bords du Jourdain, à la veille de l’avènement du Christ, quand Jean baptisait dans l’eau du fleuve)
“Purifie-toi dans l’eau du Gange” (Inde)
“Lave ton corps deux fois le jour et deux fois la nuit” (Egypte)
“Lave ton corps après l’impureté” (La Bible)
B – La médecine élémentaire : les plantes.
Les animaux, porc, bœuf, etc…, étaient, alors comme aujourd’hui, porteurs de germes dangereux pour l’homme (nous disons aujourd’hui : microbes), d’où interdiction de manger la chair de certains animaux, interdiction commune à toutes les religions physiques, égyptiennes, brahmanes, juives…
Les régimes végétariens étaient conseillés et parfois ordonnés, dans le même temps que leur caractère sacré défendait les bovins ou les porcins de l’appétit des hommes.
Enfin, des plantes étaient retenues comme particulièrement guérisseuses. La médecine primitive soignait par les herbes.
Ainsi en arrive-t-on aux formules rigoureuses. Tout sera ordonné, les heures de sommeil et les mets du repas, et les jours où l’homme peut coucher avec sa femme. Ainsi arrive-t-on aux portes de cette autre forme de la morale naturelle : la morale sociale.
17. Essai de psychologie élémentaire
Mais d’abord, évoquons le mystère des jeux. La définition du rythme physique peut s’énoncer ainsi : un rapport constant entre l’homme et son œuvre. Il n’exprime rien d’autre que le souci de l’homme de reproduire dans sa vie la marche naturelle des phénomènes qui l‘entourent : retour régulier des saisons, évolution des astres. Mais en même temps qu’il est un essai d’imitation de la nature, il est aussi le remède apporté par l’homme à la perte de l’instinct.
Le rythme
|
Voyez un nègre écraser du millet, abattre un arbre. La répétition monotone du geste qui meut le pilon ou la hache est un garant de l’utilité du geste. Le rythme assure ici une économie de forces, que nulle violence d’élan ne semble pouvoir égaler. Et c’est ainsi que la musique, dans le tam-tam primitif, est moins un accompagnement qu’un “témoin de l’accoutumance” et, partant, de l’efficacité de l’effort.L’enfant obéit au même besoin. Qui n’a vu un bébé de quelques mois, s’efforcer à faire entrer une ficelle dans un cercle de bois ? Cette occupation le tiendra des heures. Mais s’il réussit dans sa recherche et s’il peut reproduire son acte, il s’y adonnera pendant des journées. Imaginez alors une succession de sons qui puisse exprimer son effort et bercez-le de cette musique : la jouissance empreinte sur les traits de l’enfant vous récompensera de votre attention. |
La même loi d’adaptation à laquelle se rattache l’étude du rythme explique le phénomène du déguisement.
Le déguisement
|
Le plaisir d’être autre, si fort chez l’enfant et l’homme physique, est d’abord, en effet, le plaisir de s’identifier à…, et, donc de s’adapter. Les oripeaux dont se couvre le Caffre dans ses danses guerrières ou ceux que revêt l’enfant dans ses jeux de jardin ne sont pas, pour le Caffre et l’enfant, de simples masques mais les authentiques attributs d’une personnalité autre. Le gosse de huit ans coiffé de plumes “est” un peau-rouge, le même gosse coiffé d’un képi “est” un général. On peut invoquer l’imagination mais l’imagination, n’est, comme nous verrons, qu’une “aptitude sympathique”, c’est-à-dire, en fait, la faculté la plus physique de l’esprit. |
18. L’Art et le langage
Le rythme et le déguisement furent à l’origine de l’art. Tout art, quel qu’il soit, n’est qu’un déguisement harmonieux : et l’homme de l’âge de pierre qui dessine un bison sur les murs des cavernes est ce bison en même temps qu’il lui est supérieur par son pouvoir de le styliser.
Eschyle, dans son “Prométhée enchaîné” porte au nombre des bienfaits dont le monde est. redevable à son héros, la création de la mémoire. Je ne pense pas qu’il faille voir dans ce texte une métaphore. Le souvenir n’est que la puissance de reproduire et d’imiter. Toute image est un héritage – et celui qui trace sur la pierre ou dans les mots la ressemblance de son époque lègue cette époque à ses descendants.
Ainsi l’art n’est pas seulement déguisement et rythme mais témoignage. Toute œuvre est une présence impérissable : la première – et non moins importante – victoire de l’homme sur le temps.
A l’origine de l’art fut le langage, prise de possession naïve du passé. Qu’il soit une loi, une formule magique, une prière, le Verbe est, d’abord, un recueil de sons précieux parce que, dans telles occasions, ils ont manifesté de leur pouvoir. Ces vieilles traditions, maintenues jusqu’à nous dans les campagnes reculées (par les rebouteux) de prononcer des phrases pour “conjurer” le mal – colique ou verrue – s’apparentent directement au moulin à prières de l’Inde ou aux psaumes chantés autour des jeux de guerre.
Le langage, en effet, de même que la prière gravée, est ce qui conserve sa forme. C’est la chose identique à soi-même, l’élément de stabilité auquel toujours on peut faire appel dans les péripéties d’un monde mouvant.
19. La mort
Cette conception de la vie entraîne une conception de la mort.
Dans les tombeaux, les Egyptiens déposaient des aliments : légumes, poissons, raisins, et des vêtements de rechange. Le mort ne goûte pas à ces mets ? ne touche pas à ces étoffes ? Mais le double des mets nourrit, le double des robes vêt le double du mort. Et ce double n’a de vie qu’autant que vit le corps, ce pour quoi les Egyptiens poussèrent si loin la science des embaumements : l’art, moyen de l’immortalité.
La même croyance explique les coutumes d’antropophagie. En mangeant la chair de l’ennemi, ce sont les vertus de l’ennemi que l’on s’intègre (entendez vertu dans son sens physique : la force). Même croyance, enfin, dans l’apprêt des têtes des ancêtres suspendues aux cases. Tant que ces têtes seront présentes, leurs vertus agiront sur ceux qui ont pris soin d’elles.
Les religions physiques, en un mot, croient que la mort réside dans l’abandon du corps par quelque souffle périssable. Si quelque chose, pensent-elles, est immortel en l’homme, comment ne serait-ce pas cette force bondissante qui fait de lui un chef, un guerrier, un grand prêtre ? cette rapidité de son sang, cette dureté de ses muscles ? cette acuité merveilleuse de ses sens ?
II
LE DEUXIEME ASPECT DE LA MORALE PHYSIQUE
20. Le choix social, Moïse
Moïse sur le mont Sinaï ouvre une période nouvelle dans l’histoire des morales.
Il serait faux de le montrer recevant sa morale du ciel, la créant ab nihilo . Toute la morale individuelle existe avant qu’il ne soit né. Les éléments que je viens d’évoquer ont déjà joué leurs rôles dans l’évolution de l’humanité, le déguisement, le rythme et le langage, les fondements de l’hygiène, la médecine végétale ont tenté de discipliner l’homme dans le sens de l’adaptation ; et l’obligation de la circoncision, d’une importance si grande dans le code hébraïque, date d’Abraham.
Mais jusqu’à ¨Moïse, les législateurs sont aussi des hommes, ils ont le sens de la tribu, non de la société. Noë, le danger passé, s’enivre. Et Joseph ne songe qu’à sauver ses frères.
Cependant, Moïse a connu les cités égyptiennes. Il a souffert de l’esclavage social. Il s’est senti promis au salut de sa race pour avoir vu qu’une race, comme un homme, peut mourir.
Et ce salut nécessite, certes, l’entretien des lois anciennes. Il faut songer d’abord, à l’homme. Moïse médecin ne le cède en rien à ses précurseurs : supériorité des herbes sur les viandes, l’eau remède contre l’impureté (corruption du sang), l’interdiction d’approcher une femme durant ses règles, de toucher un homme qui saigne.
Ces lois, Moïse les complète par d’autres qui, bien que physiologiques, laissent déjà prévoir le plan social :
– l’interdiction de la bestialité et de la fornication. Que l’homme ne s’abaisse pas au rang de l’animal, de peur de corrompre la race ;
– l’interdiction de l’adultère :
a) il est impur,
b) il désorganise la famille, donc la race.
Mais, enfin, sauver la race ne suffit pas : il faut l’organiser. Plus se prolonge le séjour sur le Mont, mieux se précise la pensée profonde de Moïse : la nature va céder le pas à la société. Jusque-là, les hommes n’avaient tenté que de s’adapter aux lois naturelles. Moïse exige d’eux une nouvelle adaptation : au code qu’il enseigne. En place de la fatalité des choses, il impose la fatalité des lois. L’homme change de monde, pénètre dans l’univers créé de la main de l’homme.
Et voici les premières lois sociales, imitées des lois naturelles : la défense de la personne humaine par l’interdiction de tuer, la défense de la propriété par l’interdiction du vol. Les biens, les serviteurs, la femme, les animaux vont être protégés au même titre que la vie humaine. Et notre code civil n’est que l’application précisée dans le temps des préceptes du Sinaï.
Cette organisation dictatoriale est l’expression intellectuelle de la pureté : la justice. Justice injuste sur le plan naturel, mais nécessaire à l’ordre social.
21. Pénalité et jeux.
Sauver la race, l’organiser. Et, pour atteindre ce but, la discipliner par les châtiments et les cérémonies.
Les châtiments, depuis le début des temps, étaient physiques.
“Frappe le faussaire de verges” (Zoroastre)
Moïse ne s’élève pas contre cette tradition : “Il faut punir le criminel dans sa chair”. La peine corporelle apparaît, en effet, nécessaire dans un univers de présence où l’homme ne raisonne encore que par plaisir et douleur. Mais l’identification de l’homme et de ses biens matériels permet de le frapper non seulement dans sa chair, mais aussi dans ses biens. Moïse institue l’amende. Seul celui qui ne pourra payer, qui ne possède que son corps subira charnellement sa peine. Ainsi est sauvegardée cette justice sociale qui semble à l’homme nu la pire des injustices.
Punir, amuser. Les sacrifices qui ramènent les actions d’un peuple à cette maille première de la chaîne : le prêtre, nécessitent un cadre digne d’eux. Moïse est créateur de l’idée de culte dans le sens le plus majestueux et le plus spectaculaire du mot. Médecin, législateur, Moïse n’oublie pas que, d’abord, il est guide, chef, envoyé d’en haut. Toutes les ressources du déguisement, du rythme et du langage, il les emploie à l’établissement d’un monde prodigieux : la cérémonie. Tout ce qui émeut et réjouit, les parfums, les étoffes de couleur, la musique, le mouvement des processions, il l’offre en gerbe, avec une minutie extrème, à son peuple de grands enfants. Tout est prévu, le nombre des officiants et leur disposition, les piliers et les figures du tabernacle, l’horaire des évènements. C’est le triomphe incontesté du Rythme. Enfin, s’il faut, les prêtres frapperont l’esprit du peuple par des actes plus grands que nature : les miracles physiques.
Nietzsche (critique du mensonge sacré) écrit à ce sujet :
“Ils peuvent prescrire une foule de choses parfaitement raisonnables (il eut mieux valu d’écrire : “éprouvées”) à cela près qu’ils doivent indiquer comme la source de leur sagesse non l’empirisme, mais une révélation.”
Nous savons aujourd’hui que l’interprétation donnée par Joseph du rêve sur les vaches maigres et les vaches grasses est explicable par les astres. Bien des miracles de Moïse nous demeurent encore mystérieux : les plaies d’Egypte, le passage de la Mer Rouge, la manne et la pluie de cailles, l’eau du rocher, le serpent d’Airain.
Nous en savons assez pour deviner, derrière ces actes prestigieux, une connaissance profonde, subtile et accomplie des choses de la nature.
22. Le passé et l’avenir.
Morale de présence, certes, mais d’où l’avenir et le passé ne sont pas exclus. Il existe une présence de l’avenir (le pressentiment) et une présence du passé (la tradition). Et les moralistes hébraïques, comme avant eux les Egyptiens, les brahmanes, les fétichistes, firent de l’un et de l’autre le plus grand emploi.
Le culte parvint d’ailleurs rapidement à les concilier. L’étude des rêves et les augures, de même que l’accoutumance aux rites devaient donner aux prêtres une étrange puissance. Ils devinrent les seuls détenteurs du temps, le peuple n’ayant d’autre obligation que de jouir de l’heure présente et, pour le reste, d’obéir.
Je pense que les prêtres n’étaient pas infaillibles et qu’ils se trompaient quelquefois. Mais je pense aussi que ce n’était pas trop cher acheter sa tranquillité que de fermer les yeux sur ces erreurs. Il suffisait que les pasteurs prophétisent vrai trois fois sur cinq pour qu’il apparaisse dangereux de douter. Un peu d’expérience permet de prévoir l’issue de certains drames, et, au surplus, quand l’évènement s’est produit, il n’est pas difficile d’en trouver le présage dans n’importe quelle parole.
| L’esclavage |
Partout où s’ordonne une morale sociale sur les traditions de la morale physique, prend forme la conception de l’obéissance absolue.La Chine, la Palestine, les bords du Nil ont connu cette suprématie de l’homme sur l’homme qui porte le nom d’esclavage.Le maître a sur l’esclave droit de vie et de mort. Et dans les lois de Moïse même la vie de l’esclave n’est pas prisée si haut que celle du maître puisque, dans le cas d’un accident causé par un animal domestique l’amende due par le propriétaire de l’animal n’est pas la même selon que la victime est serviteur ou parent de la personne visée. |
23. La famille et le droit d’esclavage.
J’ai cité cet exemple à dessein parce qu’il ouvre des aperçus sur l’origine de l’esclavage, et, pour tout dire, qu’il offre de cette institution une explication autre que celles qu’on en donne parfois.
Pour certains, en effet, elle est née de la guerre entre races, entre peuples, entre tribus, le vainqueur ayant droit de prendre au vaincu, au choix, sa vie ou sa liberté.
Mais si l’esclavage n’est qu’une conséquence de la guerre, quelle devient l’origine de celle-ci ? Les Latins attaquant les Sabines ne désirent que des femmes, et le Pharaon à la poursuite des Hébreux n’est entraîné que par le souci de ne pas perdre ses esclaves.
Ainsi donc, il semble bien que la première guerre ait été causée par un naturel besoin de main d’œuvre (qu’on donne à ce mot le sens de chair à plaisir ou de chair à travail, il n’importe) plutôt que l’esclavage institué par la première victoire.
L’esclavage est la conséquence directe de l’idée de famille.
Mais, pour que cette assertion soit compréhensible, c’est toute la métaphysique primitive qu’il me faut rapidement étudier.
24. Les Dieux
La peinture précédemment tentée de l’homme primitif ne serait pas complète sans l’évocation de ses dieux. Cette évocation sera simple et bouleversante : ils n’existaient pas. À l’origine des croyances, Dieu est le chaos.
De ceci témoignent :
A. Les textes sacrés ; le plus ancien manuscrit de la Chine : “Le Livre du Néant”. Les premières Traditions Brahmanes (Dieu fils du néant) et Egyptiennes (le chaos originel). On sait, de même, que les Perses adoraient le cercle entier du ciel.
B. Les races primitives vivantes. C’est ainsi que, de nos jours, les Caffres croient que tout s’est fait de soi-même : montagnes, océans, arbres et fleurs.
Il n’y a rien là qui doive nous étonner, le néant premier n’est-il pas l’expression totale et pure de la divinité physique ? Mieux :il eut suffit de la foi de l’homme pour concrétiser la loi extérieure (sensation active ou passive). Car cette loi s’exprime aussi bien par l’abîme que par le tronc de l’arbre dont sera faite l’idole.
Mais la foi de l’homme en son propre corps l’amenait naturellement à donner une forme,- un corps, – à sa divinité : ainsi naquirent les représentations de la divinité : animal, montagne, fleuve, élément, soleil.
Encore ces représentations demeuraient-elles charnelles et ne pouvaient donner naissance à nulle obligation autre que celle créée par la loi primaire d’adaptation.
25. Le Mensonge Sacré.
Alors, apparurent les prêtres. C’est, il me semble, une évidence aujourd’hui que tous les chefs, juges, rois, conducteurs de peuples assirent leur puissance sur une filiation divine. L’école dite d’”exégèse scientifique” du siècle dernier accuse ces premiers prêtres d’avoir volontairement trompé le peuple, d’avoir institué des divinités auxquelles eux-mêmes, prêtres, ne croyaient pas. Je pense que cette explication ne tient pas compte des facultés de l’être physique : rythme, déguisement, création d’art. La seule faculté intellectuelle ( ?) de l’être physique, c’est l’Imagination. Ici encore l’observation de l’enfant et du sauvage atteste que je ne me trompe pas : l’être physique ne raisonne pas, n’analyse pas, ne compare pas : il imagine, c’est à dire : il crée. Physiquement, le mot : “Mensonge” n’a aucun sens. Le menteur est seulement celui qui se crée une nouvelle adaptation. Surtout, la vie est si multiple, si diverse, si déconcertante que le mensonge n’est que l’affabulation d’une vérité possible. On ne peut mentir lorsque tout existe.
Ceci compris, l’accusation de mauvaise foi disparaît. Il reste que des hommes imaginatifs, exaltés par des victoires physiques, ayant conquis l’estime de leur peuple par des actes si parfaits qu’ils le frappaient de stupeur, ont donné à leur propre puissance une existence réelle : Dieu.
Et de ceci témoignent les castes privilégiées, toutes de filiation divine. En Chine l’Empereur, au Japon, les Samouraïs, en Egypte, les Pharaons, dans l’Inde, les Brahmanes et, parmi le peuple hébreu, les Rois. Fils du Ciel, Fils du Soleil, Fils d’Osiris, Prophètes de Dieu, Elus de Dieu, ces hommes s’identifient avec leur création, artistes supérieurs, créateurs inconscients dupés par leur propre chef d’œuvre.
26. Sa création et l’adaptation. Le droit d’aînesse.
Celui qui crée est l’être libre par excellence.
|
Mettre au monde
|
Je tiens d’une femme cette attestation, d’une femme mère de plusieurs enfants :“ Le temps de souffrance de la mise au monde de mon premier fils a été de huit heures. Le temps de souffrance de la mise au monde de mon deuxième enfant a été de trois heures. Et cependant, j’ai plus souffert pour celui-ci que pour celui-là.” Elle réfléchit quelques minutes et eut ce mot : “C’est sans doute parce que, la première fois, je ne savais pas ce que c’était.” |
Je concevais très bien ce qu’elle voulait dire. Et rien ne pouvait mieux illustrer ma théorie de la sensation active. Les deux points les plus hauts de cette sensation sont, en effet, pour l’homme, la jouissance sexuelle et, pour la femme, la mise au monde.
Je sais que cette affirmation va soulever des tempêtes. Les femmes torturées pendant leur accouchement ne me pardonneront pas de l’avoir émise et plaideront leur expérience contre la non mienne. Mais l’homme ni la femme moderne ne savent ce qu’est la vie physique. Le témoignage de cette mère me suffit : la mise au monde de l’aîné est une jouissance prodigieuse, car toutes les sensations passives créatrices de douleur (écartèlement des chairs, etc…) sont, durant un instant, balayées par l’Autre sensation, jamais éprouvée, d’être l’origine de la sensation. Dans les naissances qui suivent, cette dernière sensation diminuée, annulée par l’accoutumance, les sensations passives domineront et nulle autre mise au monde ne sera plus le prodige que fut la première.
Cette digression était nécessaire pour établir le lien qui unit la morale sensuelle et la notion de famille, lien purement sensuel lui-même puisque tressé du plaisir des sens et de cette exaltation que cause la souffrance à celui qui l’agit.
L’aîné de la famille, dès l’âge le plus lointain des temps, connut des faveurs toutes particulières parce qu’il était l’incarnation vivante du miracle de la création.
27. Préservation de la race.
Il apparaît pourquoi je fais dépendre l’esclavage de la réalité de la famille. Les races élues de Dieu (de qui le père, le grand-père, l’aïeul fut créateur de ce Dieu) furent l’objet d’une bienveillance extrême de la part des prêtres, rois, juges, qui en sortaient. Ainsi s’établirent des privilèges qu’il fallut, dès le premier instant, songer à maintenir.
Epargner des travaux pénibles et souvent périlleux dut être le premier soin de cette vigilance. Ainsi naquit la nécessité légale d’avoir des esclaves.
J’imagine assez bien que, au début, cette nécessité ne fut que spasmodique. L’œuvre faite, on tuait l’ouvrier. Mais, bientôt, les besoins se firent plus grands. Le créateur du Dieu pût être dupe de sa création. Son fils ne le fut pas, mais l’ambition qu’exalte une enfance ouatée, l’orgueil de sa situation maîtresse eut tôt fait de l’inciter à profiter de cette situation et de cette duperie. Il fallut à lui et aux siens une demeure plus spacieuse, des œuvres d’art, des musiciens, des jardiniers, des femmes et, bien sûr, des soldats pour défendre ces biens. L’esclave devint un habitant de la tente ou du palais, un membre inférieur de la famille, dont la mort n’allait pas sans représenter une perte pour le maître.
La grande muraille de Chine, les pyramides d’Egypte, les jardins de Babylone, les temples d’Israël et, d’une manière générale, toutes les œuvres grandioses par lesquelles les Rois espérèrent s’immortaliser furent d’immenses charniers humains.
L’homme qui mourut écrasé par une pierre géante après avoir, durant dix ans, usé son squelette décharné dans les sables brûlants sous les charges trop lourdes, cet homme ne savait pas le sens de son travail ni si même il avait un sens. Mais de le savoir ne l’eut pas consolé, car l’œuvre qu’il bâtissait n’était pas faite pour lui non plus que sur ses plans.
28. Comment cela fut-il possible ?
Une question redoutable se pose : comment les esclaves acceptèrent-ils d’être des esclaves ? Ils avaient pour eux le nombre légion. Et le nombre dans cet univers est l’unique force. Dix hommes armés de bâtons triomphent d’un guerrier armé d’une lance. Et ils n’étaient pas dix contre un, mais des milliers pour un. Question terrible, ai-je dit, car elle recouvre cette autre : “Comment les hommes acceptèrent-ils le passage de la morale naturelle à la morale sociale ? Comment, quand Moïse descendit du mont Sinaï, les tables de la loi à la main et fit périr, nous apprend la bible, les adorateurs du veau d’or, comment se laissèrent-ils massacrer ? comment renoncèrent-ils à l’inoffensive idole au profit d’un Dieu dont ils ne savaient rien si ce n’est qu’il apportait le châtiment et la mort ?”
A cette question, il est deux réponses, empruntées toutes deux aux morales naturelles :
1) L’homme était las de souffrir.
2) L’homme naturel aime d’avoir peur.
29. L’échec de la morale naturelle.
Keyserling rapporte que, voyageant dans l’Inde septentrionale, il y vit une femme qui prétendait avoir accouché d’un Dieu. Toutes les femmes la crurent sur l’heure, en vertu, ajoute Keyserling, de ce raisonnement : “Moi, je n’ai jamais prétendu avoir enfanté un Dieu ; pourquoi Lakchmi le dirait-elle si ce n’était pas vrai ?”
L’explication de Keyserling est bonne, à cela près que le mot “raisonnement” ne convient pas, rien n’étant plus irrationnel que cette croyance de l’être physique au miracle.
Analysant, quelques pages plus loin, le rayonnement du chef, Keyserling épuise toutes les raisons possibles de ce rayonnement (y compris celle, fort pertinente, de l’imitation) et n’omet que la plus essentielle, à savoir que l’homme croit facilement tout mensonge parce que la vérité le déçoit.
Et, sans aller plus loin, où trouverait-on ailleurs l’explication de la faveur dont jouissent les romans, les poèmes, les pièces de théâtre ? L’homme enfermé dans sa vision du monde sans espoir de s’en délivrer accueille avec transport toute nouvelle manière de voir, parce qu’il espère en l’inattendu.
Et cet espoir constant de l’homme-désir en l’inconnu est le climat seul qui permit, au cours des âges, aux hommes-loi de s’imposer.
J’ai remarqué, et cette remarque chacun l’a pu faire comme moi, que la crédulité est en rapport direct avec le degré de souffrance présente. Nul n’attend avec plus de confiance les chances de fortune les plus invraisemblables que l’homme qui ne possède rien. Et n’importe quel charlatan de foire aura audience près d’un malade qui souffre.
30. Le plaisir et la peur.
Cela est, si je puis dire, l’explication d’ambiance. Il en est une autre, apparemment étrange, qui tient à la nature même de l’homme.
Quand nous parlons du Plaisir, il est rare que ce mot présente pour nous le sens qu’il présentait pour l’homme primitif. J’inclinerai à croire qu’il ne le présente jamais. En effet, l’esprit de l’homme moderne joue un rôle extrêmement important dans toute sa vie charnelle. Les concepts esthétiques de la Grèce et le sentiment du devenir spirituel nous ont gâté la sensation brute. Il nous est inconcevable qu’on puisse préférer l’odeur du crottin à celles des roses. Nous nommons plaisir une certaine conformité de la sensation et de nos représentations du mieux intellectuel.
Mais si nous admettons que le plaisir naturel n’est que l’expression émotive d’une sensation active, nous comprendrons qu’il en allait tout autrement pour l’homme charnel. En effet, la vivacité et la densité de la sensation étaient, alors, les seules causes réelles du plaisir. Les couleurs violentes, les parfums forts, qui s’isolent d’eux-mêmes des perceptions globales et s’imposent aisément à la mémoire physique (accoutumance), facilitaient à l’homme la sensation active, ne fut-ce que par les réminiscences sensuelles, les rêves à l’état de veille, etc… L’homme recréait sans l’aide du monde extérieur ces sensations dont la richesse l’avait frappé.
| La peur chez l’enfant |
Je prends souvent mes exemples dans le monde de l’enfance. C’est parce que, encore une fois, l’enfant est le seul sujet d’expérience purement sensuel.Il est un fait, que l’enfant aime avoir peur. Jouez avec un bébé de deux ans, prenez-le dans vos bras, feignez de le jeter au loin : l’enfant criera. Mais reposez-le doucement sur le sol, il réclamera : “encore !” et si vous renouvelez la menace un certain nombre de fois, ce sera, bien vite, chez l’enfant, mille cris de plaisir, un vertige de joie. |
Qu’y a-t-il au fond de cette allégresse ? Certes, avant tout, l’attrait de ce qui est nouveau. Mais répondre ainsi serait déplacer le problème sans le résoudre, car tout nouveau est, pour le primitif, une menace possible. Il aime l’inattendu parce qu’il aime avoir peur. Et, ainsi, expliquer son goût de l’épouvante par l’attrait du nouveau reviendrait à ne rien expliquer.
Et je crois ce problème insoluble si l’on n’admet que la peur n’est pas un sentiment ni un jugement, mais une simple sensation. Cependant, à la différence des sensations auditives, gustatives, visuelles, etc…, il s’agit d’une sensation “intérieure” provoquée par (et intimement liée à) des sensations auditives, visuelles, etc… De sorte que la peur (il n’est question ici que de la peur physique, nullement dépendante de jugements) serait la sensation active par excellence, puisque créée dans et par l’homme lui-même ([1]).
Seul, cet attrait de l’inconnu, joint à la faillite de la morale naturelle, peut expliquer que des milliers d’hommes aient accepté (et acceptent encore) la tutelle tyrannique de quelques-uns.
III
LES REALISATIONS DE LA MORALE HEBRAIQUE
31. Les vertus.
A) Sur le plan physique.
La plus grande vertu physique, celle qui contient toutes les autres, est la Force : perfection de l’acte.
Elle n’est faite que de la stricte obéissance à la loi extérieure, quelle que soit cette loi (pour Samson, le secret de sa force est dans la chevelure), mais, en réalité, de l’obéissance à la loi d’adaptation.
Ce qui condamne Samson, ce n’est pas la perte de ses longs cheveux, mais l’esclavage où le tient une femme : Dahlila. L’homme qui veille à la force de son corps ne doit pas s’abandonner aux étreintes passionnées. Dura lex, sed lex. L’homme fort c’est d’abord l’homme libre d’attaches (la loi n’étant pas considérée comme une attache, mais, au contraire, comme le chemin de sa liberté). ([2])
On voit ici la vertu d’Ethique qui recouvre la Force : la Pureté. Mais, alors que la Pureté s’attache à l’état physique, la Force tend aux actes. Elle comporte deux aspects : le libre jeu de la conscience, la perfection de l’aptitude. L’homme fort est celui qui sait et qui peut.
Ce dont la métaphysique juive a fait cette formule : La force s’obtient par la Justice (connaissance de la faute), la Puissance (moyen de rachat).
B) Sur le plan intellectuel : la Justice, application intellectuelle des lois naturelles.
1) Dans le cadre naturel, elle est l’expression de la plus haute conscience : la pierre tombe parce qu’elle atteint le bord du gouffre ; le trop de nourriture cause l’indigestion, l’excès sensuel, la fatigue. Telle est la justice élémentaire. Cela est juste parce que cela est. L’homme juste est celui qui connaît la loi.
2) Dans le cadre social, elle est aussi l’expression de la plus haute conscience, non plus d’une fatalité naturelle, mais de la fatalité instituée par l’homme même dans les lois constituées. “Tu voles, et ma loi te défend de voler. Je te punis.”
L’enfant partagé entre les deux mères et le jugement de Salomon montre bien le côté brutal de cette justice. À noter aussi le problème physique par lequel Daniel confond les vieillards calomniateurs : “Quel était l’arbre ?”
C) Sur le plan spirituel : la Puissance, application spirituelle des lois naturelles. Toutes les grandes légendes hébraïques en sont l’écho.
Puissance du corps sur les éléments (passage de la mer Rouge), sur les astres (Josué arrêtant le soleil), sur la matière (l’eau du rocher, le serpent d’Airain) ;
Puissance du corps humain sur les animaux (Daniel dans la fosse aux lions) ;
Puissance de l’homme sur l’homme (Judith et Holopherne, Les Macchabées).
J’écris : puissance du corps, en dépit des controverses que cette expression ne peut manquer de soulever auprès des spiritualistes. Ce n’est pas moi qui parle ici, mais Moïse lui-même, pour qui l’âme est une faculté physique : le sang. Une âme puissante, pour les anciens, c’est un sang riche. Et je ne crains pas de rattacher à cette croyance des expressions paysannes, telles que le “Il se fait du mauvais sang”, employé pour des malades frappés, de toute évidence, moins dans leur corps que dans leur âme.
Cette interprétation explique que la Puissance, vertu spirituelle, n’a rien à voir avec le courage ni avec l’amour. Elle ne se donne pas, elle ne sait pas : elle est question de sang, en effet.
32. L’art biblique
L’art biblique découle de la morale.
Nous avons vu qu’elle était dogmatique, c’est à dire qu’elle croyait dépendre (ou dépendrait effectivement) d’une vérité objective ; qu’elle était sensuelle et tendait à une perfection de la jouissance ; qu’elle était statique (corollaire du dogme) et, pour tout dire, une morale de présence.
DOGMATIQUE, elle comprend l’art comme un enseignement. Ses grands livres (la Bible, le Coran) sont, avant tout, des recueils de conseils pratiques et de lois.
SENSUELLE, elle comprend l’art comme une jouissance sensuelle. D’où l’importance prépondérante de la danse, de la musique, de la fabrication des parfums. Le cantique des cantiques, le style du Coran, la sensualité des poèmes orientaux seraient, s’il était besoin, de nouvelles preuves du caractère rythmique de cet art. Et, de même, les mélopées des peuplades sauvages.
STATIQUE, elle comprend l’art comme une éternisation de la présence. La momification était un art. L’importance et la qualité des édifices et des constructions que nous ont légués non seulement Thèbes et Jérusalem, mais les civilisations des Incas et de l’Inde sont un gage parlant de cet art statique. Et aussi les comparaisons minérales qui abondent dans les œuvres anciennes : “la tour de son col”, “l’assise de sa splendeur”, etc…
33. La science.
Dans la science, les Anciens voyaient une connaissance directe (obtenue par les sens) du monde. Son but était alors d’assurer l’existence de l’homme dans les meilleures conditions de plaisir. C’était un essai d’adaptation aux nécessités immédiates.
Elle ne dépassait pas le cadre des deux besoins les plus essentiels de l’homme : guérir, se protéger.
L’étude des herbes, la science des aliments répondaient au premier besoin. La construction des navires et des villes, la fabrication des armes répondaient au second.
Certes, ces précurseurs ne cherchaient pas dans le seul but de la recherche, en quoi l’esprit de la science moderne leur fut tout à fait étranger. Nul n’ignore, cependant, que c’est la science de la navigation qui a donné aux Phéniciens les premiers éléments de cosmographie.
Pour ces primaires, tout était mystère. Mais le mystère est une ambiance très riche, où tous les gestes sont permis. Le moindre pas découvre un monde. On croit ne s’informer que d’un nouveau parfum, et l’on met à jour une loi vitale. On croit pêcher un poisson dans la mer, et l’on trouve le remède qui guérit les yeux malades de son père.
34. La décadence.
Il est trop évident que la morale sociale, création de l’homme, était plus simple et plus claire que la morale naturelle. Il n’est donc pas surprenant que le Culte et le Dogme formel prirent de plus en plus d’importance aux dépens de la morale proprement dite.
Aux Juges succèdent les Rois, aux Rois, les Pharisiens. À la Bible, recueil de conseils sensuels, succède le Talmud, recueil de prescriptions rituelles. L’existence de l’homme se subordonne à une suite ininterrompue de préceptes. À telle heure, accomplir tel geste ; à telle autre, telle purification. Les fresques, les gravures, les marbres donnent l’immortalité, et l’homme se trouve pris dans une chaîne d’ancêtres (l’échelle de Jacob à rebours), de laquelle il ne peut sortir.
Les Philosophes en Grèce, le Christ en Palestine, par des chemins différents, tenteront d’arracher l’homme à l’emprise familiale. Mais, après les éclairs brûlants des uns et de l’autre, les Universités et le Catholicisme retourneront à la morale sociale, dogmatique et formelle.
35. Les imitateurs.
Complètement en dehors des courants intellectuels et spirituels, des hommes, de la Bible jusqu’à nous, tentèrent de reformer des religions physiques.
L’un des plus grands d’entre eux fut Mahomet. Les lois qu’il édicta ne diffèrent pas tellement de celles de Moïse. Il s’apparente à la morale physique :
– par son respect de la sensation, que nous prouve l’importance des parfums et du rythme dans la vie musulmane, l’institution de la polygamie ;
– par son humeur guerrière et le droit donné à l’homme de disposer de l’homme (esclavage des eunuques) ;
– par les gestes rituels de son culte et les formules consacrées. Ainsi que l’affirmation de la filiation divine : “Allah est Dieu et Mahomet est son prophète” ;
– par l’acceptation de la fatalité qui marque la morale du sceau statique ;
– par l’immortalité physique qu’il promet aux croyants. Les belles femmes nues et les tendres musiques sous les ombrages d’une oasis paradisiaque.
Mais le dogme de la vérité objective possession d’un homme, d’un parti ou d’une race, connut son plus long destin sous son expression sociale. Après les grandes autocraties et les puissants Empires, il est curieux de retrouver dans l’Hitlérisme la forme la plus achevée et la plus récente de cette morale :
– exaltation de la force physique et de la santé ;
– formes savantes et rigoureuses du culte ; spectacles inhumains donnés au peuple ; manifestations énormes ;
– importance dans les châtiments de la torture corporelle ; esprit de conquêtes guerrières ; restauration de l’esclavage.
|
La zone
|
Et qu’est le dernier abri de la morale physique sinon le monde des entremetteurs et des souteneurs ? Goût des bagarres, maîtrise violente de l’homme sur la femme, prédilection pour les couleurs vives et les parfums violents, jouissances exacerbées mais non intellectuelles (se souvenir du mot de Baudelaire : “Seul, l’homme de la rue sait foutre”), enfin justice expéditive et brutale, souverainement injuste pour qui ne sait pas la loi :que nul n’est sensé d’ignorer. |
Dans un cas comme dans l’autre la décadence est trop évidente pour être discutée.
IV
L’ECHEC
36. La douleur n’est pas vaincue.
C’est ainsi que la morale se résout en échec. Les hommes inventent des villes et des navires et guérissent la lèpre. Mais le mystère qui les presse n’est pas entamé et la douleur les guette au moindre de leurs pas. Les maladies se sont multipliées, la durée de la vie a diminué, les sensations se sont émoussées. Et malgré tous les soins que les hommes ont pris contre, ils n’ont vaincu ni la souffrance, ni la mort.
Il suffirait, pour s’en convaincre, d’opposer à l’Hébreu conquérant et guerrier le Juif malingre et débile d’aujourd’hui, à l’Inca de l’Ere du Soleil l’Indien de nos jours. La bataille physique est perdue. Qu’en est-il advenu de la bataille sociale ? Nous l’avons vu : le Monde de la zone.
Et pourtant si la morale physique ne réussit pas sur le plan physique où peut-elle prétendre réussir ?
37. L’orgueil et la colère.
A) Sur le plan intellectuel, la morale est irrationnelle.
Dans son dogme, elle est une négation de l’Esprit : défendu de chercher à comprendre – la Loi est la Loi – défendu d’user d’arguties et de tenter de résister à l’ordre. Le dernier représentant des Grands Prêtres est l’adjudant de la caserne : Vous me ferez quatre jours – Mais…- Vous m’en ferez huit – Mais…- Vous m’en ferez seize. Et ainsi de suite, jusqu’à l’éternité. La Bêtise n’a pas de limite.
Le mal intellectuel, pour elle, est l’injustice, c’est-à-dire ce qui est contraire à la Loi. Le mal intellectuel c’est la révolte qu’on ne peut châtier trop durement puisqu’elle va contre l’ordre établi.
Toute compréhension (conjecture intelligente) est mauvaise en soi, puisqu’il suffit de connaître (conscience).
Stupidité des Lois de Moïse. Est-ce que l’esclave n’est pas un homme comme son maître ?
Stupidité du jugement de Salomon. L’enfant mort ne serait plus à personne – du jugement de Daniel : est-ce qu’un des vieillards ne pourrait pas mal se souvenir.
Mais aussi ces juges n’ont misé que sur la réaction physique (réflexe) de la mère, du vieillard. Et cela était juste comme était juste, socialement, la Loi de Moïse sur les accidents des serviteurs.
Nul ne réclame que le juge soit intelligent, c’est-à-dire soit capable d’être celui qu’il juge – mais seulement qu’il sache appliquer la Loi.
B) Sur le plan spirituel, la morale est égoïste.
Dans la nature, l’homme combat pour sa vie et pour sa vie seulement. Dans la Société, il combat pour sa liberté, sa quiétude. Dans l’un et l’autre monde résonne le “Vae Victis” de “Malheur aux Vaincus”. Et rien n’est plus contraire aux lois d’Amour.
En vérité, la morale physique porte la marque des lois barbares. Il manque à l’homme moderne pour pouvoir l’appliquer avec chance de succès – l’étonnante pureté d’un début du monde.
La Justice devient un moyen de gouvernement. Elle convient pour juger des faits, non des hommes. Encore la vérité dont elle est l’instrument de recherche demeure liée à l’état physique du juge. Une condamnation à mort peut être la conséquence d’une mauvaise digestion.
C’est le triomphe intellectuel de la colère : “Je châtie parce qu’on m’a blessé”, ou, pire “parce que je suis blessé”.
La Puissance, tout comme la Justice, est devenue moins une règle morale qu’un moyen de gouvernement. Spirituellement, elle n’est qu’une immorale permission à s’enorgueillir. Puissant, celui qui possède un fusil en face de celui qui n’en possède pas ; qui dispose d’un commandement en face d’un simple troupier. L’âme est étrangère à ce genre de choses, tout comme l’Esprit est étranger à la Justice.
C’est le triomphe spirituel de l’orgueil : “Je domine et méprise parce que je suis le plus fort”. Que devient alors la Force ? Non plus du tout un synonyme de santé et de plénitude de vie sensitive, c’est-à-dire de pureté, mais l’affirmation de sa présence corporelle sous forme de brimades et de supériorité musculaire. L’homme qui en fouette un autre à tour de bras peut se croire, le temps de la correction, plus vertueux que cet autre. Mais sur le plan moral, qu’est-ce que cela signifie ? Donner la douleur n’est pas un moyen de la vaincre en soi.
Et telle est bien, pourtant, la seule réussite de la morale physique : devenir capable d’établir en autrui la douleur et le plaisir. Ils avaient l’ambition de vaincre la douleur, ils n’ont su que découvrir de nouvelles méthodes pour la faire naître.
38. L’introduction de la métaphysique.
À l’origine de toute grande morale nous retrouverons un symbole identique en qui s’exprimera le dilemme éternel – le combat sans cesse renouvelé entre l’homme-désir et l’homme-loi.
À l’origine de la Bible, le symbole se nomme “Abel et Caïn”.
Celui en qui s’identifiait la force, vainement, fut meurtrier. La postérité d’Abel l’emporte. ([3])
La Force que l’homme savait être l’œuvre de son propre corps, un Dieu en fut le dépositaire et le dispensateur. Bientôt, au lieu de se nourrir d’aliments riches et de cultiver sa chair, il suffit d’offrir au Très-Haut des agnelets fraîchement tués.
Et cette introduction de la métaphysique dans la morale fut le coup dont la morale ne s’est pas relevée.
CONCLUSION
Aujourd’hui, dans un jardin clair derrière de hauts murs, un enfant rit et danse son plaisir. Et sur le chemin qui longe les murs, un gendarme passe et mange sa moustache à cause de ce rire qu’il ne voit pas.
Il n’y a rien de plus à dire sur la caresse des couleurs et des odeurs et sur la rigueur de la Loi.
Rien de plus qu’un souvenir…
LA VISION MAJEURE
Le Héros
Samouraï Fil d’Or, Siegfried des bords du Rhin, Rhuys de la ville d’Ys et Toi que chante Ossian, et Saül, David et Samson, mais non pas Roland, Tristan, Roméo,
Le grand Achille, le brave Hector et Coriolan, le vieil Emir des Assassins et l’illustre Imam Housseïn, mais non Bayard et Duguesclin,
Tel le héros s’élève au-dessus des légendes.
Cœur ferme et yeux perçants, la bouche d’une jeune fille et le front dans le ciel, assailli à chaque heure par le chant des oiseaux et le vertige des fleurs et la dureté du sol, ô ! Celui qu’engage, pas après pas, plus avant, toujours plus avant, la beauté de la vie !
Ma chair est pleine d’une étrange rumeur comme si les arbres me parlaient le langage de mes aïeux.
Mon fils et ma fille, ma femme et ma sœur, mon père immobile comme l’ombre des morts sur le trépied de fer. Tous, autour de moi, les bras étendus, doucement oscillent, oscillent vers moi pour m’implorer de conserver ma force.
Qu’on m’apporte des chevreaux entiers, des langues de flamands et les poissons bleus aux écailles d’argent, qui ont goût de fruit. Qu’on emplisse mon verre de l’eau de la vie, qui brûle et nourrit. Et qu’on apprête mes jambières d’or, mon casque brillant et mon épée lourde et serrée dans son étui comme le pied de l’arbre dans la terre.
Que les tambours résonnent sous la mesure agile des doigts de mes guerriers, et que les flûtes égrènent sur la splendeur des mets les sons en qui revit l’haleine de la mer.
La plaine large, incurvée comme un ventre, porte le poids de dix mille cavaliers. J’avancerai seul entre leurs rangs ouverts, vers l’ennemi seul qui s’en viendra vers moi. Et commencera le jeu qui fait mourir.
Cette nuit, dans trois chambres successives, sur les trois lits d’apparat, m’attendront les corps parfumés de trois jeunes vierges, et l’œuvre de vie se continuera.
Ou bien, sur un dais haut et tenu par dix hommes, en avant, toujours seul, de la foule hurlante vêtue de robes rouges, j’irai, droit et glacé dans l’attente suprême, pour une larme saignante sur mon cœur dévoilé, dormir parmi les chants étranges des bonnes herbes que nourrissent les morts.
Troisième partie
LA GRECE
Berceau de l’Intellectualisme
(39) 36. Les origines.
Nous ne savons rien des origines grecques. Homère évolue déjà dans un monde physiquement affadi (descriptions des richesses d’Achille au début de l’Illiade). Mais, que nous importe les Pélages, les Colonies Egyptiennes de Cenops et de Danaüs ? Il est bien évident que le début de l’histoire grecque doit se perdre dans la morale physique, comme l’origine de toute les races. Nous avons, par ailleurs, relevé dans Homère les derniers vestiges de cette morale : primauté de la Force, justice brutale, dieux humains toujours sanguinaires, vie essentiellement sensuelle.
Aussi bien, ce qui compte pour cette étude, n’est-ce pas les lointains de la race grecque, mais la naissance de la morale intellectuelle : la Grèce des philosophes à travers le courant hellénique. Et cette Grèce-là, n’est-elle pas, tout entière, une décadence ?
(40) 37. La conscience du passé.
Ici se place une hypothèse philosophique :
Le conflit entre l’homme et le monde, sur le plan du je-lui, s’achève, nous l’avons vu, par un échec. Et, peu à peu, l’homme se persuade de ce que le coupable n’est pas lui, mais le monde. Trop de forces l’entourent contre lesquelles le corps est impuissant. La sensation, même à son plus haut degré de force, n’empêche pas les raz de marées, les tremblements de terre, la souffrance et la mort par les épidémies.
Mieux : plus la sensation approche de son point de perfection, plus le monde devient dangereux et cruel. Car cette perfection n’est pas seulement d’attente, mais d’accoutumance : et plus le corps s’accoutume à certaines sensations actives, plus nombreuses apparaissent les sensations passives ; l’univers est devant l’être physique comme un inépuisable réservoir d’inconnus.
Les hommes-lois désespèrent de l’homme et l’immobilisent dans sa souffrance par des doctrines apparemment irréfutables. Les hommes-désirs ont à combattre à la fois la souffrance née de leur liberté et l’hostilité des lois. L’homme tourne en vain dans le cercle de ses cinq sens. Et tôt ou tard, la mort tombe sur lui.
Alors, plus grande apparaît la faiblesse du corps, plus d’importance prend cette faculté de l’être jusque là dédaignée : la conscience ; on découvre qu’elle ne vit pas dans le présent comme le corps. Elle ne vit, à proprement parler, que de souvenirs. Elle seule crée l’expérience, cette arme mystérieuse. On s’aperçoit de ce que l’inattendu surtout est à redouter. Les choses qui se renouvellent, on sait comment s’en défendre. Et les sculptures et les monuments ont une durée plus longue que le corps vivant. L’homme qui perd pied dans le présent triomphe dans le temps : la continuité le sauve de la présence.
(41) 38. L’Art, fondement de la morale intellectuelle
En vérité, j’imagine ainsi cette grande transformation : Prométhée a vraiment existé. Il fut ces hommes qui découvrirent que les Lois, – toutes les lois, – peuvent être interprétées dans le sens du désir.
Il fut ces hommes qui découvrirent que les livres dits “de révélation”, les manuscrits sacrés, étaient aussi des œuvres d’art et des symboles. Il fut ces hommes qui vulgarisèrent les messages “divins”, les créateurs de la Mythologie
(42) 39. La Mythologie.
En effet, si le seul remède à l’infériorité présente de l’homme est le Temps, il faut amener le monde à se renouveler. Par conséquent, le simplifier, le préciser, le posséder une fois pour toutes. Il ne faut plus être à la merci de l’ignorance, cette ignorance qui n’est que de la vie immédiate. il ne faut plus subir les images du monde, mais, puisque les créations durent plus que l’homme, créer.
On arracha aux prêtres leurs papyrus secrets, on descendit le ciel sur l’Olympe, on habilla les Dieux de robes légères, on donna à toutes les misères de la vie, par avance, une illustration, à tous les gestes de la vie une sorte de divinité.
Le grand Hésiode ne fut pas, sans doute, l’auteur de ce bienfait : les noms des Dieux existaient avant lui, comme avant même Homère. Mais il fut un de ceux qui enfermèrent le Temps dans de belles légendes et qui donnèrent ces légendes aux peuples, non pas comme Moïse descendant du Ciel, mais comme un ami parmi ses amis. Il est, avec Homère, un des créateurs de l’Homme Nouveau.
(43) 40. L’homme nouveau.
Dans cette poursuite de l’Autre Lumière, trois phases :
1) Connaître, c’est hiérarchiser et même, au besoin, détruire les images qui se refusent à la hiérarchie.
2) C’est donc sélectionner, se poser en arbitre du monde, opposer sa propre expérience aux représentations et aux évolutions.
3) Mais, pour que l’esprit atteigne à une autorité suffisante, il lui faut se déborder lui-même et se perdre en Dieu.
Ainsi, aux trois phases de la morale physique :
– découverte de la sensation active,
– primauté du corps,
– création de l’univers social,
vont répondre, sur un autre plan, trois phases identiques :
– découverte de l’entendement actif,
– primauté de l’esprit,
– création de l’univers logique.
Ces trois phases recouvrent elles-mêmes l’éternel combat : homme-loi homme-désir, dont, au début de la Légende, le duel Apollon-Marsyas est le second symbole.
LES TROIS ASPECTS DE LA MORALE INTELLECTUELLE
(44) 41. Connaître, c’est hiérarchiser.
La Mythologie est un poème qui célèbre la victoire de l’ordre sur le chaos (Zeus et les Titans, Apollon et le monstre). Que l’homme crée un ordre, et l’homme sera Dieu.
Dès ce premier aphorisme, il apparaît combien la nouvelle morale sera différente de l’ancienne. On peut dire, dans un certain sens, qu’elle en est à l’opposé. C’est que l’adaptation à la présence réclame impérieusement l’Ignorance : nul être n’est aussi adaptable que l’enfant.
L’adolescent
|
Ce n’est pas par hasard que j’oppose l’enfance à l’adolescence. Il n’est pas dans mon dessein, par un trop facile arbitraire, de confondre les âges de l’humanité et ceux de l’homme, bien que cet arbitraire soit extrêmement tentant. Mais rien ne me semble mieux représenter l’évolution qui se manifesta, soudain, dans la morale, que celle qui a eu lieu chez le pubère de quinze ans.Le désir de connaître ne va jamais chez lui sans le désir d’être le maître de la connaissance. Cette bouche soudain fermée et ces yeux secs de l’âge ingrat, cette impression irritante pour l’âge mûr de secret à garder que donne l’adolescent ne sont, en fait, que les apparences d’un changement de plan, de la volonté neuve d’arbitrer soi-même ses conjectures. |
Ce dont il est question, d’abord, c’est de créer le monde à son image, c’est-à-dire de l’appréhender dans un sens conforme à l’humanité. Et cette recherche d’un cadre fut l’unique préoccupation des premières Ecoles Ioniennes du VIe au Ve siècle avant Jésus-Christ. Il nous est facile, aujourd’hui, de sourire des naïves organisations d’Héraclite, d’Anaximède, de Thalès de Milet. Nous ne croyons plus pouvoir ramener la vie à l’étude d’un Elément (et encore notre illusion est-elle dissipée ? Et nos arrières-petits-enfants ne jugeront-ils pas nos défenseurs du quanta, nos dissociateurs d’atomes comme nous jugeons celui pour qui le Feu était l’essence de la vie ?). Mais ces hasardeux chercheurs précèdent de peu Démocrite et la stylisation de l’univers autour de l’atome. Ne rions pas du crochet preneur de ce dernier, il exprimait, tout aussi bien que le précepte A = A, l’effort persévérant des Hommes Nouveaux vers l’humanisation de l’univers. Encore un pas, et ce seront Euclide et Pythagore : la constitution du cadre rêvé de la pensée humaine, l’étonnante création (de rien) du monde le plus rigide et le plus souple, le mieux fermé et le mieux ouvert : les Mathématiques.
(45) 42. Arbitrage du monde.
Mais, dans l’instant que la loi de sélection obtient ses plus purs disciples, elle réalise aussi ses plus dures disciplines : l’esprit se heurte partout à des axiomes. L’antinomie, ce fléau de l’esprit, naît des lois intellectuelles comme étaient nées des lois d’Abraham de nouvelles souffrances. La douleur prend un autre nom : l’erreur.
Or, cette extrême sélection va réveiller un petit homme laid, marié à une femme acariâtre. Les plaisirs physiques n’offrent pour lui, à n’en pas douter, qu’un agrément médiocre.
Socrate devine sans peine le “deus ex machina” de l’affaire. Il n’est pas dupe des créations de l’entendement. Mais cet entendement, capable de reconstruire le monde, l’enchante. Pas d’esprit moins métaphysique que le sien. Comme Joseph s’inquiétait de sauver sa famille, Socrate parle pour un petit groupe d’amis, et ne parle pas sous les auspices d’un dieu. Dieu est en lui : c’est son daïmon.
Nous voyons très bien comment il raisonne : ”On affirme ceci, on affirme cela. Moi aussi, je peux affirmer n’importe quoi et le prouver. C’est pourquoi les systèmes ne m’intéressent pas. Mon arbitraire me permet d’un seul mot de les détruire. Mais ce qui est merveilleux, c’est ce moyen mis en moi de détruire et de construire librement.”
Socrate découvre l’Esprit, et cette découverte, le transportant de bonheur, lui arrache le cri : “Connais-toi”.
“Connais-toi” veut dire : “Ton problème, c’est ta vie. Organise-toi selon une morale qui te soit propre. Tout est illusion qui n’est pas le monde du “je-moi”. La morale est de se connaître, car le bonheur, c’est la vertu.”
Socrate créa le libre-arbitre en imaginant l’outil de l’esprit : la dialectique. Il le paya de sa vie.
“Depuis longtemps, on cherchait un prétexte pour le faire périr. On le trouva dans son impiété. Et lui, en dernière ironie, fit promettre qu’on sacrifierait un coq à Esculape.”
Il donnait ainsi l’exemple de la plus grande vertu intellectuelle : la Sagesse.
|
L’esprit de contradiction
|
Qui n’a pas été irrité, voire scandalisé (après l’avoir été lui-même jadis) de ce jeune homme qui ne songe qu’à contredire ? Tout homme digne de ce nom a connu cette seconde phase de l’adolescence où l’on répond par la raillerie et l’insolence à l’énoncé de toute “vérité” établie, et surtout de celle-là que jamais personne n’a mise en doute. |
Ainsi s’aiguise l’instrument de la raison, arme à double tranchant, qui frappe aussi bien l’envers que l’endroit, celui qui la manie et celui qui s’en défend.
(46) 43. L’univers logique. Les idées.
De même que Moïse avait utilisé le passé de sa race et l’enseignement de X milliers d’années de vie physique, de même, Platon utilisa toutes les doctrines grecques, toutes les croyances. De même que Moïse, par le Décalogue, avait introduit la métaphysique dans la vie morale de son peuple, de même, Platon introduisit la métaphysique dans la vie intellectuelle par le système des Idées-mères, triomphe de la continuité.
Penser, construire n’est rien. Il faut croire en ce qu’on construit. Socrate (malgré son axiome d’identité : vertu = bonheur) fut peut-être un homme très malheureux. Platon apporte le bonheur aux hommes par la seule formule : les Idées qui te hantent sont les images de celles qui sont dans le sein de Dieu.
Platon est, avec quelques autres, le type achevé de l’homme-loi. Ces hommes sont possédés soit par un immense orgueil, soit par une grande pitié de la race humaine, probablement les deux à la fois. Ils sont tourmentés par l’absurde besoin de créer une doctrine telle que plus personne ne s’en puisse échapper. Alors que l’homme-désir se voue à la recherche de la seule liberté et s’offre, s’il le faut, en victime expiatoire, sans se laisser arrêter par aucune des souffrances qui le poignent, l’homme-loi est toujours prêt à arrêter les frais, à proclamer le “Rien ne va plus”, le “Tout a été dit”, à quoi l’on reconnaît l’Organisateur.
Vue de cet aspect, l’œuvre de Platon est une réussite, égale aux plus grandes. C’est, en somme, toujours le même procédé d’extériorisation. Les moralistes de la vie physique construisaient des idoles matérielles. Ils adoraient des animaux, des fleuves, des astres, jusqu’au jour où l’un d’eux recueillit ces croyances dans le nom : Jehovah : l’être des Dieux. Platon invente une divinité d’une toute autre allure : Aei o Theos Gemetrie ; Dieu est Géométrie. C’est le Dieu-Raison qui dit à l’homme : crois en moi puisque tu penses.
Dieu étant esprit, l’âme ne peut moins faire que d’être esprit aussi. Pour Moïse, l’âme était le sang. Pour Platon, elle ne fut qu’une faculté de l’entendement, qui, lui-même, est trois : science, entendement pur, opinion.
Le don physique, le charnel “ils se connurent” de la Bible échappe tout à fait à ce nouveau monde. L’amour ne s’accomplit plus dans l’union charnelle des êtres, mais dans leur union intellectuelle. Aimer, c’est comprendre, c’est saisir dans son intégralité et sa totalité l’Idée de la chose ou de la personne aimée.
Conséquence ultime de la doctrine : c’est à l’esprit de l’homme qu’est promise l’immortalité. Dans l’au-delà ne l’attendent plus les femmes nues, les musiques et les parfums, mais des entretiens sérieux et graves sous les arbres sans odeur des avenues élyséennes.
LES REALISATIONS DE LA MORALE
(47) 44. Sur le plan intellectuel : la sagesse
La première vertu de la morale intellectuelle est la Sagesse, c’est-à-dire la connaissance de ce qu’il faut savoir pour vivre en paix avec soi-même. Le Sage, comme l’a très bien noté Maeterlinck, exclue le drame par sa seule présence. Les ennemis de la Sagesse sont la Colère et l’Envie. La Colère parce qu’elle égare l’homme dans la conscience de l’instant, l’Envie parce qu’elle détruit cette conscience. Se plaire en ce qu’on fait et ne pas souhaiter d’être autre que ce qu’on est, telles sont les formes secondaires de la Sagesse. Quant à son essence, elle est la science pure, aussi éloignée des illusions de l’envie que des superstitions de la colère.
Cette vertu recouvre ce que Bergson nommait l’intuition, mais que Platon avait appelé de ce nom bien avant lui. Et l’intuition est toujours provoquée par le choc de deux vérités contraires. Devant une affirmation, le Sage sourit (ironie socratique). Devant deux affirmations contraires, il se retrait en esprit, et la vérité naît de leur opposition..
Cette connaissance supérieure est le Bien. “L’homme, dit Socrate, pêche par ignorance”. Le Sage ne peut commettre le Mal, parce qu’il sait.
La Sagesse s’obtient par la Tempérance (connaissance de la faute), le Courage (moyen de rachat).
(48) 45. Sur le plan physique : la tempérance.
Socrate, lui-même, avait donné l’exemple de cette modération. Habillé toujours pauvrement, se nourrissant avec frugalité, il errait dans les rues d’Athènes et s’arrêtait parler aux hommes du peuple.
Epicure (341–270) s’intéressa particulièrement à cette vertu secondaire, qui tendait moins à “satisfaire le corps” qu’à laisser en paix l’esprit. La morale est d’une simplicité toute arbitraire : “Ne cherche pas des jouissances telles qu’elles fassent ensuite naître une plus grande douleur”.
La Tempérance est une application physique des lois intellectuelles. À la base : une discipline raisonnée. Dans sa finalité : le souci que le corps ne soit pas une gêne pour l’esprit.
Il s’ensuit que la Force n’est plus une vertu. Les maladies, les difformités, les laideurs ne sont plus des preuves que Dieu s’est détourné de l’homme. Esope, Socrate, sont rois s’ils créent leur univers. Voilà le monde divisé en petites cases où jouent les chiffres merveilleux. La nature demeure ? D’accord. Mais elle devient cette ombre personnelle : la destinée. Et, l’esprit aidant, on vivra contre elle, malgré elle, sans souffrir.
(49) 46. Sur le plan spirituel : le courage.
D’ailleurs, l’action n’est pas interdite à l’homme qui pense. Certes, ce ne sera pas celle de Samson s’ensevelissant sous les portiques du Temple. Mais ce peut être Socrate buvant la cigüe. À la Force, les Grecs substituent la Tempérance ; à la Puissance, ils préfèrent le Courage.
Et le Courage, tout comme la Tempérance, procède d’une doctrine : le Stoïcisme. Elle tient dans cette formule : “L’homme ne doit rien craindre des choses de ce monde. Car il est, de par son esprit, au-dessus des choses”.
Le Courage est si prisé qu’il fait pardonner le vol (épisode de l’Enfant au Renard). Il est, exactement, l’intelligence de l’œuvre : je sais ce qu’il faut faire, et je le ferai pour la seule raison que je le sais ; car, si je ne le faisais pas, c’est que ma chair serait plus forte que mon esprit.
Par ailleurs, le sentiment qui dicte le courage n’importe pas. Alcibiade est courageux par ambition ; Léonidas l’est par amour de la patrie ; Socrate, par sagesse ; l’Enfant au Renard, par peur.
Car, au début de la morale, il est admis qu’on peut être courageux par peur, d’être mal jugé, sous-estimé, honni. Il est interdit seulement de reculer devant la souffrance physique. Mais Zénon et ses disciples allèrent plus loin, jusqu’au mépris des ambitions et des richesses, dans cette zone où le courage est héroïsme et dessèchement.
(50) 47. Les réalisations artistiques : la beauté objective.
Pour les primitifs, l’art, nous l’avons vu, était dogmatique, sensuel, statique. Pour les Grecs, au contraire, il fut symbolique, raisonnable, évolutif.
A. LA POESIE ET LE SYMBOLE – Le premier but de cet art est de synthétiser. Rien de plus étranger aux poètes grecs que ces histoires islamiques ou bibliques où la moindre action du personnage était décrite, où tout était subordonné à une imitation exacte de la vie. Les poèmes n’existent plus que par leur sens caché, ésotérique. Plus d’égarement de la pensée en bonds frivoles. La Beauté n’est pas pour les sens, mais pour l’esprit.
Le vers grec opposé au verset hébreux montre le triomphe de Nombre (concept intellectuel) sur le Rythme.
B. LA PEINTURE ET LA SCULPTURE – Mais, dans les arts plastiques, éclate surtout cette distinction. Les fresques égyptiennes ou assyriennes, de même que les dessins primitifs des cavernes donnent du monde une image présente, dans le chaos, la diversité de l’instant. Les arbitraires concepts du chiffre d’or, de la perspective, du modelé, etc…, arrachent l’art au domaine de la représentation sensorielle. Tout s’ordonne, se clarifie, se compartimente. La nature a tort devant l’artiste. Mille corps de femme seront peut-être nécessaires à constituer une apparence de la Beauté dont a rêvé le sculpteur. Mais l’œuvre faite sera la Vénus de Milo.
C. LA DANSE ET LA MUSIQUE – Enfin, en place des danses sacrées qu’animait un sentiment naturel (la crainte, le plaisir, le désir sexuel) et parfois même une simple sensation (l’ivresse du vin ou des parfums) prend naissance le jeu scénique, où l’acteur, quelle que soit sa sensation présente, se doit d’obéir aux données de l’auteur.
Euripide, Sophocle, Eschyle, Aristophane, remplacent les lourdes odeurs ou la femme dénudée autour de qui l’on danse. L’Art n’est plus, sous toutes ses formes, que l’expression de la pensée.
(51) 48. Les réalisations scientifiques.
Pour les primitifs, l’objet de la science était d’aider à l’adaptation aux lois de la vie. Pour les Grecs, elle fut de faciliter l’organisation intellectuelle par la sélection des phénomènes.
Le premier effort tendit à ordonner le monde. Sous la diversité des faits (Il neige et le soleil apparaît ; il y a des étoiles dans le ciel et la cerise est rouge ; du feu tombe sur la terre, il fait du vent et la porte de la maison se ferme), découvrir leurs rapports réels, tel fut le premier souci.
Peu importait que la solution trouvée fut vraie ou fausse : les trouvailles cosmographiques de Platon furent démenties par celles d’Aristote, celles-ci par Copernic, etc… L’important était de posséder le monde, de le recréer sur les manuscrits à l’aide des inventions humaines : la règle et le compas.
L’invention des mots correspond à celle des instruments : la cause et la conséquence, le possible et l’impossible, le relatif et l’absolu, la substance et l’accident, l’être et le non-être, l’erreur et la vérité classifient, étiquettent, immobilisent la pensée dans des cadres si soigneusement, scientifiquement, harmonieusement bâtis qu’elle ne peut songer à s’en échapper.
Alors, Pythagore, Euclide, Archimède, commençaient leur œuvre d’ouvriers patients, dont le but lointain était de faire de l’homme le maître du monde, non pas dans un illusoire présent, mais dans la connaissance accrue de l’expérience, non pas dans son corps mortel, mais dans son immortel esprit.
LA DECADENCE
(52) 49. La douleur n’est pas vaincue.
Mais, enfin, il n’est que trop clair que la Morale, malgré ses réalisations, se solde, une fois encore, par un échec.
De porter le monde en soi sous forme de théorèmes n’a pas libéré l’homme, ni ne l’a sauvé de la défaite physique. Qu’il la nie comme les stoïciens ou qu’il tente, avec Epicure, de la tempérer, elle existe et le mène à sa fin inéluctable : la mort.
Non seulement la morale intellectuelle n’a pas résolu le problème, mais elle l’a compliqué en ne tenant aucun compte de la loi primaire d’adaptation.
(53) 50. Le doute et la notion de malheur.
Fait plus grave : créée par et pour l’esprit seul, elle a échoué en tant que morale de l’esprit, c’est-à-dire sur son propre plan. Sa postérité est très lamentable : sophistes des premiers siècles, hérésiarques au sein des Eglises, Sorbonnards du Moyen Age ; sur son tronc fleurissent mille pousses vénéneuses.
En persuadant les hommes de la liberté arbitraire de l’esprit et en faisant de l’Entendement la faculté suprême, elle les a conduits, d’abord en petit nombre, puis en nombre infini, à construire en soi des images différentes du monde. La réalité objective s’est effondrée, de sorte que, sans réussir dans son premier dessein, elle a condamné l’homme à une nouvelle souffrance, pire que la douleur, que toutes les douleurs : le doute. Elle a donné à chacun le droit et le moyen de comparer sa route à d’autres routes, sa croyance à d’autres croyances. Elle l’a conduit à se construire des retraites mal défendues parce que arbitraires, que le moindre vent de la vraie vie peut mettre à bas. Et ce sont ces ruines qui portent le nom de Malheur.
(54) 51. La luxure et l’avarice.
Sur le plan d’une Morale générale de l’être, l’éthique intellectuelle s’est rendue coupable de deux grandes erreurs :
A. Elle s’est révélée impure. L’ivresse, l’abus de mets, d’une manière générale, la gourmandise est le vice physique qu’elle admet en tant que vice. Mais la contrainte physique dans le sens qui convient à l’esprit : certaines amours contre nature, certaines drogues qui avivent l’entendement et, d’un mot, la luxure, était non seulement tolérée, mais recommandée par elle pour assurer le repos de l’esprit ([4]). Ces accoutumances pouvaient ne pas convenir à l’état naturel du corps. Et les Grecs en furent châtiés par une décadence extrêmement rapide. Il suffit, pour s’en assurer, de comparer la durée de l’histoire guerrière des Egyptiens, plusieurs milliers d’années, aux quelques siècles de l’histoire grecque.
B. D’autre part, son égoïsme n’est pas moindre que celui de la morale physique. le courage polit un miroir où l’homme se contemple et se trouve beau ; et la plus grande satisfaction qu’il tire de ce spectacle est de pouvoir, à tout instant, s’en approuver et s’en complimenter. L’intellectuel sèche son âme aussi bien que le sensuel.
Et les grandes lois sociales de la Grèce portent la marque d’un égoïsme qu’elles glorifient :
— acceptation de l’esclavage,
— autorisation du suicide (Loi de Solon),
— institution du régime politique de l’aristocratie ([5])
ANNEXE
Il y a de cela quelques mois, je m’entretenais de mon Ethique avec un ami dont j’apprécie l’intelligence et le bon sens critique. Soudain il s’interrompit :
— Cette âme dont tu parles, dit-il, est-elle spatiale ou non ?
Je ne m’étais, je l’avoue, jamais posé une si grave question.
— Elle est spatiale, dis-je
— Impossible ! se récria t-il.
–Admettons donc qu’elle ne le soit pas.
Trois secondes plus tard :
–Quoi donc ? Tu viens de parler des “mouvements de l’âme” ?
— Parfaitement, dis-je, j’en ai parlé.
Aussitôt, il triompha :
–Comment des mouvements seraient-ils concevables hors de l’espace ?
Certes, ce genre de sophisme est facile à démembrer. Le nœud de la subtilité m’apparaissait assez clairement. D’une part, on crée des catégories où l’on enferme les mots abstraits ; ensuite, on défend de forcer les cloisons. Mais, je ne répondis rien, simplement peiné que mon ami ne conçoive pas même le ridicule de semblables distinctions.
Un autre exemple m’est évoqué par celui-ci : deux phrases lues dans le Nouvel Univers, de Jules Sagret, livre sérieux.
Voici la première :
Pour bien des gens, attribuer un phénomène à l’action d’un fluide, c’est déjà une explication…, avec des fluides, on peut tout expliquer : il suffit de leur attribuer le pouvoir de produire ce qui se produit en fait. Pourquoi l’opium fait-il dormir ? Parce qu’il y a en lui une vertu dormitive.
Jusque là, rien de plus sensé. Et, maintenant, savourez l’autre phrase qui, dans le livre, suit immédiatement celle que je viens de citer :
Aussi l’énergétique n’eut-elle aucune peine à réduire à l’état de fantômes les fluides électriques et magnétiques comme elle avait fait du calorique. Les formes d’activité de la matière…se ramenaient donc toutes à une même grandeur : l’Energie.
Adorable n’est-ce pas ?
Et telle est bien la dernière retraite de la logique : le nominalisme.
Le descendant de Platon, le dernier héritier d’Aristote et de Descartes est un jeune homme de vingt-huit ans, le cheveu rare et le nez chaussé de bésicles, qui, le cœur desséché par ses vaines recherches, écrit, entre deux masturbations, un traité sur les progrès inestimables de l’esprit humain qui, des éléments aux fluides, en passant par la phlogistique, en est arrivé à l’Energie…, en attendant le fligousta.
LA VISION MAJEURE
LE SAGE
Vainement, vers ma chambre ouverte sur la nuit
S’élève une clameur de bêtes en démence ;
Pour ouvrir dans la paix l’irréelle cadence
Un peu d’eau pour la soif, une image suffit.
En sa place meilleure un courage établit,
Palpitante du rire muet de l’Essence
Comme d’autres des jeux esclave du silence,
Ma pensée en un cercle où se love l’esprit.
De lutter pour les morts la volonté se lasse
J’accorde ce qu’il veut à celui qui menace,
Les autels et les dieux, les noms et les pays.
A travers le fouillis vert des métamorphoses
J’ai découvert ce soir le sens caché des choses :
Nul ne peut me ravir l’univers où je vis.
Quatrième partie
LE CHRIST
Source de la Morale spirituelle
(55) 52. Fatigue de l’esprit et du corps.
L’homme, cependant, ne renonce pas son destin. Après avoir constaté que son corps, qu’il croyait immortel et tout-puissant, était, au contraire, vincible et mortel ; après avoir connu que l’esprit n’était pas le dieu sans erreur dont il s’était formé la figure, il découvre en soi un troisième plan qui, apparemment, échappe à toute défaite : la passion.
Il lui paraît que la connaissance est un froid arbitraire, d’où rien de vivant ne peut être obtenu si ce n’est dans l’effort même de la connaissance. Il lui paraît que l’acte est sans durée.
Le geste fait, le problème résolu n’ont plus aucune valeur. Et c’est le geste à faire, le problème à résoudre qui mobilisent la faculté essentielle de l’homme (faculté d’essence) : l’âme.
Il ne faut pas se heurter au monde dans un vain combat, il ne faut pas immobiliser la vie en soi sous forme de concepts. Il faut être un élan. Il faut être soi-même et le monde et la vie. Ou, plutôt, il n’est pas plus question d’être que de connaître : il faut renaître à tout instant en quelque chose. Il faut aimer.
C’est la découverte d’un univers : le plan du je-tu.
(56) 53. Hypothèse philosophique.
1°) L’homme, séparé du monde par le mal physique, tente de retrouver le lien et ne peut. L’homme se regarde dans le miroir et se trouve laid.
2°) Il se crée un univers en rapport avec son mal (où le mal ne soit plus un mal). Il se crée un miroir déformant qui le reforme, mais ne peut faire qu’il ne se voie dans d’autres miroirs qui ne sont pas faits pour lui.
3°) L’homme brise tous les miroirs.
(57) 54. Histoire du désir spirituel.
À l’origine de la morale physique, nous avons trouvé des hommes-désirs qu’affolaient les couleurs, les parfums et les bruits. À l’origine de la morale intellectuelle, nous avons trouvé des hommes-désirs ravis par la connaissance.
De même, bien avant la venue du Christ, des hommes-désirs avaient-ils eu conscience de la troisième dimension. Les chercheurs de plantes guérisseuses s’étaient mués en cyniques prophètes qui, une corde enserrant leurs reins, logeaient dans des tonneaux et enseignaient que le rire est la seule réponse à faire aux insensés.
D’autres, les nuits de Bacchanales et d’Eleusis, suivaient, dans le cortège des ombres hurlantes, les flambeaux mystérieux. Et les symboles jaillis dans les tiédeurs des grottes faisaient battre leur cœur et gémir leur esprit.
Ce fut l’époque où les Esseniens se construisaient en Judée, sur les bords de la mer Morte, d’humbles lieux de retraite.
Mais la morale spirituelle prend ses racines plus loin dans le temps :
La légende des Mèdes nous enseigne qu’un prince, Zarathoustra, vécut dans sa jeunesse en lutte avec les démons. À trente ans, il fut ravi en extase devant Dieu, qui lui donna le LIVRE : le Zeud–Avesta. Par la suite, ce prince devint le législateur Zoroastre, dont l’enseignement fut d’une morale physique. Mais Zoroastre peut être considéré comme un des premiers mystiques, un des premiers qui tira son action de la méditation.
Et de ces mystiques l’Orient est d’une richesse surprenante : aucun d’entre eux ne parvint si haut dans l’initiation que le Saint Ciaka–Mouni, le Bouddha.
Sa légende raconte que, jeune prince, il eut l’occasion de rencontrer sur son chemin la Souffrance, la Vieillesse et la Mort. Cette triple rencontre, brusque et inattendue, le dégouta du monde. Il quitta de nuit sa femme, son palais et ses biens et tomba en méditation au pied d’un palmier. L’enseignement né de son silence fut celui-ci :
Pour vaincre la souffrance, il n’est que de vivre sans lien avec le monde. Le Bien suprême est la liberté de l’âme dans la Pureté : on atteint à la pureté par huit échelons qui vont de la pureté de la parole à la pureté de la pensée. À cette ascension une vie ne saurait suffire. Il faut donc admettre la métempsychose, l’âme captive de vies successives jusqu’au salut éternel.
Il est à remarquer que cette Pureté est à l’opposé de la Force, (dans le sens où les moralistes sensuels entendaient cette vertu). Elle n’est plus adaptation mais inadaptation volontaire. Il s’agit de passer dans le monde avec la volonté passionnelle d’en sortir. Je suis parce que je ne suis pas, tel est le mot suprême de la morale Bouddhiste.
Or cette évasion de la vie est la négation de l’être en tant qu’être. L’univers l’absorbe et le force à se nier excepté dans cette négation même. Son refus de vivre est l’unique affirmation de sa vie. La souffrance est alors d’être soi et le souverain bien devient le Néant ou Nirvana.
(58) 55. Le Christ et la loi d’Amour.
Ces hommes-désirs ne furent pas d’absolus novateurs. Ils demeurent soit des chefs et des législateurs comme Zoroastre, soit des logiciens possédés du besoin de coordination comme le Bouddha lui-même. Il fallait que naquît un homme aussi éloigné des spéculations de l’esprit que de l’attirance physique. Il fallait détruire les lois anciennes d’Adaptation et de Sélection et les remplacer par une loi nouvelle. Il fallait un Socrate spirituel : ce fut le Christ.
|
Les Évangiles
|
C’est au sortir de l’adolescence que l’étonnant message revêt son sens le plus tangible. Le jeune homme qui, déjà, s’est heurté au monde décevant de la connaissance, au monde cruel de “Vae Victis” ne se trompe pas sur le scandale inattendu de ces paraboles et de ces miracles. Et dans la révélation qui le possède soudain n’intervient ni sa raison ni ses six sens. Il ne combat, ni ne raisonne, il se sait pris. |
(59) 56. L’enseignement des paraboles : Aimez.
L’homme en proie à la souffrance et au doute ne peut se sauver que par l’oubli de soi (doctrine orientale) mais le meilleur moyen de s’oublier est de se donner. N’être plus pour mieux être, telle est la maîtresse clef des Évangiles. La morale du Christ est devenir.
L’homme ne peut aimer qu’en fonction de ce qu’il donne : – Que dois-je faire ? demande le jeune homme riche – Abandonne tes biens et suis moi ; plus tu donneras plus ton amour sera profond et grand. Mais le jeune homme hésita. Peut-être était-il de ceux qui croient que nous aimons en fonction de ce qu’on nous donne. Et Jésus s’en alla, tout triste.
À celui qui aime, rien n’est impossible. Il touchera les serpents en toute impunité, guérira les malades, ressuscitera les morts. Tous les miracles du Christ portent la marque de la puissance de l’amour. Il prend pitié de ceux qu’il va guérir. Et cette Pitié est le moyen de la guérison.
(60) 57. Le miracle gratuit. Espérez.
Le miracle est, essentiellement, échange : Tu espères en moi. Je t’aime. Par l’espérance ton corps est mien. Par mon amour mon âme est tienne. Il s’agit, à la lettre, d’une interpénétration.
Et c’est le sens – enfin – de la destruction de tous les miroirs : je me vois dans les yeux de mon frère.
D’où la loi seconde du miracle : s’unir. “Je donnerai mes pouvoirs, dit Jésus, à ceux qui se réunissent en mon nom”. Deux hommes qui ne sont qu’un soulèveront le monde.
À l’organisation de l’univers extérieur, se substitue sa destruction. Les gestes n’ont de valeur que par leurs prolongements. Il suffit à l’âme d’espérer pour que le corps soit guéri. Le monde tout entier n’est que tentative et évolution. Rien n’est impossible à l’homme qui s’oublie dans ce qu’il entreprend ; il peut marcher sur les flots.
(61) 58. Le sacrifice : Croyez en moi.
Mais l’amour ne demande pas un simple oubli de soi. Il veut le sacrifice, qui, tout autant qu’un don de l’âme, est un acquiescement de l’esprit. Les idées ne valent que par leur acheminements. Le calvaire ne prendra sa signification que plusieurs siècles après l’agonie. Jésus n’apporte pas des messages immédiats : comme Socrate, comme Jacob, comme tous les hommes-désirs il ouvre un chemin et le paie de sa vie.
Il suffit à l’âme de croire pour que l’esprit comprenne.
(62) 59. Le complexe de Saint-Paul. Les essais de synthèse.
Cela aurait pu être la défaite irrémissible des hommes-lois. Et cela l’aurait été si un centurion Romain, persécuteur des disciples du Christ, n’avait, un soir, sur le chemin de Damas, reçu cette illumination : Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?
La sobriété volontaire de mon exposé historique ne m’a pas permis de situer l’Empire Romain dans le chassé-croisé des morales. C’est que les Romains ne furent pas des créateurs. Leur métaphysique et leur philosophie devaient tout à la Grèce, leurs lois sociales s’apparentaient aux règles hébraïques. Tous les traits de la morale physique comme tous ceux de la morale intellectuelle se retrouvent dans leurs croyances. Leurs vertus jusqu’à la décadence sont : la force tempérée, la justice sage, la puissance courageuse. Soldat mais législateur, poète mais philosophe, conquérant mais citoyen, ce peuple-loi devait être tout naturellement pour le christianisme le pire ennemi. Et des Romains, le Centurion était le moins ouvert à la doctrine évangélique.
L’évangéliste de Paul est Saint-Luc : le plus politique des quatre. Il s’agit, écrit le père Didon lui-même, d’inspirer confiance aux païens. Quiconque lit les Épitres de Paul, immédiatement après l’Évangile de Saint-Jean, ne peut pas ne pas être frappé par la différence de ton des deux ouvrages. Paul réécrit la Bible dans le sens messianique, traite longuement du problème juif, s’attaque à l’Église de Corinthe, enfin commence d’établir les lois de la communauté.
Platon et Moïse revivent dans Saint-Paul ; du premier il possède le don de construction logique, du second le don de construction sociale.
J’imagine assez l’épouvante première du soldat devant les actes et les paroles du Christ. Cette vie de sacrifice qui ne laisse aucune place aux formes extérieures du Culte non plus qu’au développement syllogistique déroute son esprit. Heureusement pour lui, Jésus, ayant à choisir entre Jean qui le comprenait et Pierre qui ne le comprenait pas, choisit ce dernier comme base de son Église (cette église construite sur un homme comment serait-elle un édifice de pierre ?) Pierre et Paul sont faits pour s’entendre. Après leur passage il ne restera plus du message spirituel que ce qu’il en peut entrer (et qu’est-ce ?) dans une doctrine habilement ordonnée.
(63) 60. L’Église.
Pierre avait renié Jésus trois fois. Paul est guidé par la terreur que l’Évangile ne soit pas compris des Gentils. La mort du Christ n’a aucun sens : il lui en donne un ; certains actes, certaines paroles du Maître seraient pris en mauvais sens : il les expurge. Jésus n’avait prévu nulle dictature humaine, Paul y pourvoira. L’Eglise qui s’édifie sur le sang des martyrs aura ses Sacrements, son Canon liturgique. Plus tard, elle admettra le châtiment corporel et des sanctions nouvelles : l’ex-communication.
Et Dieu, une troisième fois, se transforme.
Il n’est qu’accessoirement la Force et la Sagesse ; essentiellement, il est Amour. Il ne dit plus à l’homme : “Crois en moi parce que tu vis et que ton existence ne peut venir que de moi”. Il ne dit plus : “Crois en moi puisque tu penses” – mais : “Crois en moi parce que tu m’aimes”.
Parallèlement, l’au-delà revêt un autre sens. Une seule chose est immortelle : l’âme. Plus de parfums et d’oasis, plus de conversations dans les Champs-Elysées. L’immortalité se résoud en présence (le Paradis) ou en absence (l’Enfer) de Dieu. Et dans l’au-delà, l’âme conserve sa vie particulière : le Devenir. D’où la nécessité chrétienne du purgatoire.
Cette belle construction résiste aux orages des hérésies, à la rivalité de constructions différentes, telles que celles de Luther et de Calvin. Elle se perfectionne d’âge en âge, se clarifie dans le sens dogmatique, gràce aux règles monastiques des saints, aux conciles fréquents. Elle trouve sa pierre de faîte dans l’infaillibilité du Pape.
(64) 61. La morale spirituelle.
Cependant, des hommes-désirs, sans souci de Saint-Paul ni de son Eglise tentent vers le Royaume de Dieu la joie promise. Les mystiques s’appliquent fidèlement à la destruction de la chair (jêune, flagellations, martyres), à la négation de l’esprit (Savonarole brûlant les livres et objets d’art en place de Florence). ([6])
Tolstoï est la dernière et l’une des plus hautes personnifications de la loi morale spirituelle.
LES REALISATIONS DE LA MORALE
(65) 62. Les vertus.
Comme pour les primitifs, la Force, la Justice et la Puissance, comme pour Platon, la Sagesse, la Tempérance et le Courage, les vertus chrétiennes sont des dons de Dieu. L’équilibre et l’intuition prennent sur ce troisième plan un troisième nom : la Grâce ; la Fatalité et la Destinée, ce nom : “la Providence”.
L’Amour est la vertu centrale. Les vertus secondaires sont la Foi (connaissance de la faute), l’Espérance (moyen de rachat).
(66) 63. Les réalisations artistiques.
Il n’est pas question ici de refaire le “Génie du Christianisme”. Mais ce que ce beau livre n’a pas assez montré, c’est la hardiesse de toutes les œuvres d’art chrétiennes. Par la primauté qu’il accorde à l’âme, le christianisme a renouvelé toutes les esthétiques : c’est le triomphe définitif de la beauté subjective sur la beauté objective.
Les constructions – Hardiesse, d’abord, dans les constructions. Audace de l’art gothique et de ces voûtes énormes maintenues en l’air, par quel miracle d’architecture ? Miracle aussi des vitraux et de leur vie lumineuse : la matière possédée d’une âme.
La musique. Le théâtre – La même passion anime les musiciens, les auteurs dramatiques. Ils osent décrire toutes les maladies de l’âme, ils en inventent s’il le faut. Mais de cette complexité naît une richesse extrême. Et combien les drames mêmes d’Eschyle nous apparaissent glacés à côté des Mystères, de Phèdre et d’Athalie, à côté – pourquoi pas ? – de nos comédies psychologiques modernes. L’erreur de Châteaubriant a été de se contraindre à l’étude seule des écrivains chrétiens. Il n’a pas voulu admettre (et pourtant, de ce fait, il était lui-même un exemple) que croyants et non-croyants vivent depuis deux mille ans, consciemment ou non, dans une ambiance spirituelle.
La peinture et la sculpture – Art, pour tout dire, plus mystérieux. Les sculptures grecques dans leur nudité n’avaient que cette chose à nous apprendre : leur beauté. La lumière et l’ombre, les plis des étoffes, le mouvement pudique du bras, l’incertitude de l’élan, autant d’éléments de recherche dramatique, de beautés mouvantes.
Les lettres et la poésie – Tout l’art chrétien se présente d’abord comme une énigme. Tout homme devient Œdipe. Mais le Sphinx qui l’interroge est au dedans de lui. Et quoiqu’il dise et quoiqu’il chante, ses paroles ne peuvent que recouvrir l’angoisse d’une réponse vainement cherchée. L’homme n’écrit plus pour faire de la beauté mais pour se délivrer d’un secret qui l’étouffe et qu’il ne connaît pas. De Villon aux Surréalistes, de Tristan et Yseult à Madame Bovary, de Shakespeare à Anouilh, la littérature de l’Occident est un effort à n’écouter que l’âme.
(67) 64. Les réalisations scientifiques : le sacrifice et la science
De même, la science née de la pensée chrétienne porte la marque d’une supériorité de la vérité subjective sur la vérité objective. Dans la science, les chrétiens voient un moyen d’accomplissement. Ils créent pour créer.
Les hébreux eussent rejeté cette conception comme nuisible à l’individu. Et qui peut prouver, en effet, qu’elle donne à l’homme contemporain plus de plaisir que n’en connaissait l’Egyptien du Ve siècle avant J.C. ? Effets des gaz, des bombardements, de la vitesse, de la lumière électrique – pour ne parler que des effets connus…
Les Grecs l’eussent rejetée comme indigne de l’esprit. Et cette attitude eut témoigné de bon sens, puisque nos découvertes nous contraignent peu à peu à nier toute loi, à fortiori les brillantes classifications grecques. On ne pouvait voir clair dans le monde qu’à la condition de ne pas y regarder de trop près. ([7])
Ainsi cette science à la poursuite de laquelle les hommes se vouent apparaît au moraliste sensuel comme au moraliste intellectuel la plus tragique des erreurs, puisqu’elle nous éloigne également et du plaisir et du savoir.
Que nous reste-il ? La joie de la création. Pour nous la vie redevient périlleuse et secrète. Nous sommes en marche et ni le sacrifice de notre bien-être, ni celui de notre raison ne semble devoir nous arrêter. Nous avons découvert la terre, la vapeur, l’électricité, le radium, – aujourd’hui, nous pouvons désagréger l’atome. Nous avons pris le problème par l’autre bout, et pour comprendre la matière nous ferons sauter le monde. L’homme se confond avec l’univers.
(68) 65. Explication de ce progrès. La théorie de la souffrance.
L’homme qui craint la souffrance ne peut être créateur. Toute création suppose une renaissance. Et toute renaissance est œuvre de douleur.
Douleur physique, car il n’est pas question d’établir une hygiène à l’instant de la découverte. Le feu de la passion emporte dans son élan les misères de la chair mais il use le corps ; et, lorsqu’il est éteint, les misères négligées deviennent plus cruellement sensibles.
Souffrance intellectuelle, car toute œuvre prend naissance dans le doute. L’inventeur est pareil à quelqu’un qui gravit une roche et qui avance pied à pied sans savoir si sa main ne va plus rencontrer l’anfractuosité providentielle.
Les morales précédentes étaient trop égoïstes, trop préoccupées du plaisir et du bonheur de l’homme pour autoriser d’audacieuses recherches dont on ne sait pas, alors même qu’on les tente, jusqu’où elles peuvent conduire et l’esprit et le corps ([8]).
Il fallait, pour que fut possible cette recherche ardente, une morale qui fit de la souffrance un moyen de salut.
(69) 66. Négation du temps et de l’espace.
Les sensuels sont esclaves de l’espace, les intellectuels du temps. L’âme ignore l’un et l’autre.
Spirituellement, l’univers devient une espèce de chaos sans durée sur lequel l’âme a tout pouvoir. La Anciens avaient trop le respect des choses extérieures (jusqu’à les diviniser) et les Grecs trop la volonté d’un ordre pour ainsi pétrir au gré de l’amour la matière et les éléments.
La certitude que tout était possible dans le monde réel transforma certains hommes en creusets à passion. On voulut découvrir les mers, les terres et le ciel. On voulut fabriquer de l’or. On voulut, dans tous les domaines, aller jusqu’au bout de l’imaginable, approfondir les secrets des consciences, guérir les moribonds, et vaincre la durée.
Sur l’assurance que la Foi lève les montagnes, on voulut tout réinventer, l’art de la guerre et la politique, les aptitudes du corps et le langage. La sagesse tempérée des Jeux Olympiques grecs devint la furie des records sportifs qui laissent à trente ans le champion exténué. Et les petites batailles pour le sort d’une province devinrent des guerres mondiales.
L’ECHEC
(70) 67. La douleur n’est pas vaincue.
Et voilà que le temps arrive où cet effort aussi se solde par un échec.
Pas plus que les morales précédentes, celle-ci n’est venue à bout de la souffrance physique. Elle a du, par lassitude, l’admettre comme moyen de rachat. Mais, en fait, elle l’a rendue plus inévitable encore.
La morale est impure. Ce dont témoignent :
Dans l’Evangile : les étonnantes paroles du Christ : “Ce qui souille l’homme ce n’est pas l’aliment mais la parole seule”. Le crucifix.
Dans le christianisme : les ascèses, les lois monastiques édictées à l’encontre de la plus élémentaire hygiène.
Dans le catholicisme : la confession, comparée à la purification par l’eau des Anciens.
Dans la vie moderne : l’interdiction des soins corporels excessifs et la terreur de la nudité, dans les pensionnats religieux, l’élimination des problèmes sexuels dans les livres “bien pensants”, etc.
Cette indifférence à l’égard de la chair, cette volonté d’inadaptation, jointes à l’espérance entretenue de toutes les joies dans le ciel, mène, aussi sûrement que la tempérance grecque, au plus impur des vices physiques.
Cet élan de l’âme à quoi tend toute la morale, dans les instants de “perte de vitesse” se satisfait charnellement sous la forme du pêché dit “mignon” : la gourmandise. L’attrait que la table exerce sur certains prélats, sur le prêtre de campagne…
(71) 68. L’esprit est atrophié.
Pas plus que la morale intellectuelle celle-ci n’est venue à bout de la misère humaine. Mais par la foi en une “récompense” divine, elle a développé dans l’esprit une intelligence incertaine, un besoin vague “d’autre chose” qui n’est que de l’envie.
La morale est illogique (irrationnelle), ce dont témoignent :
Dans l’Evangile : l’Enfant prodigue, l’ouvrier de la douzième heure, l’agneau perdu, etc…
Chez les mystiques : Savonarole, Saint-Jérôme et sa crainte des livres impies, etc…
Dans l’Eglise catholique : les mystères. La mise à l’index de toutes les œuvres contraires au dogme, etc…
(72) 69. Le désespoir.
Enfin et surtout, en plaçant l’homme sur le plan du devenir, cette morale lui interdit à la fois la jouissance de l’instant et la satisfaction de sa propre continuité. L’homme n’est plus que par son mouvement. Dans les heures où le corps et l’esprit, par fatigue, ne peuvent plus suivre l’âme, la morale laisse l’homme en proie à une souffrance pire que le doute et la douleur : le désespoir.
Je prononce et j’écris à dessein ce mot parce que, depuis quelques années, les moralistes chrétiens prétendent opposer leur morale à l’effrayante incohérence des œuvres modernes. Ils dressent Jésus contre Sartre et Camus. Ils disent : “voilà ce qui attend les incroyants. Il faut croire ou désespérer”. Mais ce qu’ils taisent c’est que personne jamais n’a entendu dire que Socrate ou Moïse fut mort de désespoir. Le désespoir est une souffrance absolument inconcevable pour quiconque n’a pas été baigné par le courant spirituel. Et c’est une des gloires de Rimbaud d’avoir osé écrire : “Prêtres, professeurs, maîtres, vous vous trompez en me livrant à la justice. Je n’ai jamais été de ce peuple-ci ; je n’ai jamais été chrétien ; je suis de la race qui chantait dans les supplices…”. Sa gloire et son tourment, car il était chrétien et n’était pas de la race de ceux qui ne vivent que pour la vie, n’était pas une brute.
(73) 70. Introduction de la métaphysique.
Quelqu’un a-t-il parfois rêvé de cette hypothèse : que le Christ, au lieu de donner les clefs à Pierre, les ait données à Jean qui ne vivait que d’amour ?([9]). Mais il fallait, encore une fois – la dernière – que l’homme-loi l’emporte sur l’homme-désir. Il fallait, une fois encore, que l’invention d’un dieu faussât le problème humain.
(74) 71. Aboutissement de la morale : le bigot.
Dégénérescence qui a pu faire dire à Nietzsche : “Religion d’esclaves”, jugement combien erroné lorsqu’on considère les réalisations de la morale, cette découverte de la passion ! Mais combien vrai lorsqu’on étudie le chrétien moyen de nos jours. Il ne lui manque que l’essentiel de sa morale : le sacrifice. La loi d’amour exige le don. En refusant le don, l’homme a dénaturé les vertus spirituelles.
L’espérance n’est plus qu’une prostration stupide dans l’attente du miracle. Devant moi, une mère s’écriait sur le cadavre de sa fille : “Mon Dieu pourtant j’ai tellement prié !”. Cette pauvre femme ne savait pas que l’espérance doit être action. Des miracles, nous en voyons chaque jour : dans l’activité du laboratoire, dans la lutte de l’être contre sa maladie, dans l’ascension des hauts sommets. Mais pour ressusciter un mort, quel don de soi prestigieux, quelle offrande de passion doit être nécessaire dont cette mère n’avait ni l’aptitude, ni la volonté !
La Foi qui donnait à Thomas d’Aquin une philosophie, guidait Pasteur dans ses recherches, amenait les martyrs à vaincre sans tuer, qu’est-elle devenue ? Une phrase dans un livre.
Le bigot – c’est ce vieillard à demi-sourd et plus qu’au quart aveugle qui dit “Mon Dieu ! Mon Dieu !” toute la journée et cultive en lui une âme inutile, ou plutôt, car il n’a plus d’âme, le creux de son cœur où il la situe – où elle fut avant de s’être liquéfiée dans toutes ces larmes qui, pour tout et pour rien, humidifient ses yeux.
CONCLUSION
Tournons la page. “Monsieur Prudhomme est né avec la Christ”. ([10])
Cinquième partie
LES FONDATIONS
I
INTERPRETATION DE L’ECHEC DES MORALES
(75) 72. Faute des hommes-loi.
Si maintenant j’étudie, avec le recul nécessaire, les échecs des trois grandes morales, il m’apparaît qu’ils sont si semblables dans leurs conséquences que je suis en droit de leur donner une même cause.
Cette cause, des hommes la cherchent depuis plusieurs siècles, des êtres que leur caractère “dionysiaque” amenait à se méfier des lois. Il était naturel qu’ils imputassent l’échec des grandes morales humaines à l’introduction en elles de règles dogmatiques.
Telle fut l’origine du mouvement d’analyse subjective qui, parti de la Renaissance, se prolonge jusqu’à nous et s’oppose en tous ses termes à la méthode ancienne de synthèse objective.
(76) 73. Primauté de l’homme-chercheur.
Parmi ces hommes qui furent légion, trois paraissent avoir joué les rôles de chefs de file et mériter, à cet égard, une étude particulière :
DESCARTES crée le subjectivisme intellectuel et bat en brèche le “monde des idées” de Platon.
Jean-Jacques ROUSSEAU crée le subjectivisme sensuel et bat en brèche le monde social dont l’ancêtre fut Moïse.
LUTHER crée le subjectivisme spirituel et bat en brèche le monde théologal.
Qu’ont apporté ces hommes à la libération de l’homme ?
(77) 74. Descartes : l’analyse subjective intellectuelle.
Descartes avait préconisé, pour vaincre les difficultés logiques, “de les diviser en autant de parties qu’il serait nécessaire pour les résoudre”.
Jamais conseil ne fut mieux suivi. Nous avons vu les sciences se préciser ; de la médecine, naître la chirurgie, l’esthétique, l’étude des maladies ; de cette dernière, la psychiatrie, la neurologie, les spécialisations de l’œil, du cœur, des poumons. De la physique sont sorties l’optique, l’acoustique, la dynamique, l’électricité, etc. Et chacune de ces études croit représenter le monde. Pour le biologiste, le problème est tissu organique ; pour le mathématicien, il est nombre ; pour le physicien, il est énergie ; pour le psychologue, sentiment. Mais cela n’était rien encore : dans chaque science, des centaines de chercheurs réordonnent chacun le monde. Pour ce biologiste, la vie est aquatique ; pour cet autre, aérienne. Pour ce psychologue, toute connaissance vient de l’expérience et pour cet autre, de la raison. Tour à tour, l’univers est résolu dans le sens : d’un aspect trompeur de la réalité, de l’expression d’une règle intérieure, d’un élan vital, d’une représentation. Où deux mots se heurtent, une théorie naît.
Les parties ne manquent pas : nous demandons un tout.
Descartes était parti du doute. À la fin de son ère, c’est au doute que nous sommes revenus. le dogmatisme de Platon ou l’aveu d’impuissance d’Einstein ? Je refuse de choisir.
(78) 75. Rousseau : l’analyse subjective sensuelle.
Le plus sincère, Jean-Jacques, fut de tous ceux qui crurent servir la morale, l’homme qui l’a le plus desservie. Le plus innocemment fautif. Chantant la passion sans règle et la seule conscience intérieure, il a créé l’esprit de révolte et l’égotisme satisfait. Sans donner les moyens de se construire une conscience, il a donné la règle de n’écouter qu’elle.
Sa “Nouvelle Héloïse” est la grande responsable du mouvement romantique français où l’homme n’a jamais été si loin de se connaître. Tandis que les foules, armées de son “Contrat Social” et lasses d’une morale sans justice, prétendaient instituer une justice sans vertu.
Quant à sa théorie de “l’homme naturel”, qu’en dire ?
“Vérité en deça des Pyrénées, erreur au delà”. Montaigne, bien avant Pascal, s’était diverti à établir le catalogue des coutumes. Le catalogue, depuis, a triplé de volume. les habitants de la Terre de Feu et de l’Extrême Nord n’ont-ils pas aussi leur témoignage à apporter ? Et les polyandres de Gobi ? Et les faciles jeunes filles de Tahiti ? Et les cruels papous ? Et les tendres autochtones de Sicile ? Est-il une faute, un crime, – y compris celui de manger la tête de son père, – qui ne soit glorifié en quelque point du globe ? Ici, le voleur est porté en triomphe et là jeté aux fers. Ici, une femme vivante suivra sur le bûcher le corps de son époux et là une femme changera, dans le cours de sa vie, jusqu’à vingt-cinq fois de mari légal.
Où est dans tout cela la “morale naturelle”, la “voix de la conscience” ? En quoi le dévot qui croit obtenir son salut en jeûnant le vendredi est-il moins naturel que le nègre d’Afrique qui prétend l’obtenir en jouant aux osselets avec le squelette de son ennemi tué ?
Les suicides et les morts violentes dont les œuvres de Jean-Jacques ont été responsables répondent à cette question.
(79) 76. Luther : l’analyse subjective spirituelle.
J’ai assisté, il y a quelques années, au prêche d’un adepte d’une secte protestante ; je ne sais plus laquelle. Cela se passait dans l’arrière-salle d’un café. Étaient venues là, surtout, des vieilles femmes, épileptiques, mangées de tics, que l’adepte devait guérir, après son prêche, par l’imposition des mains. Nous chantâmes des cantiques et lûmes l’Évangile. Il n’y eut pas de guérison. Une femme me dit qu’elle en avait vu, à d’autres séances. Il est possible qu’il y en ait eu : partout où l’homme croit, il y a miracle. Là n’est pas la question, mais que je sortis de ce lieu découragé. Il me semblait que j’y avais vu ce qu’il peut y avoir de plus affreux en ce monde : une foule de désespérés jetés de doctrine en doctrine, revenus aux superstitions les plus humiliantes de l’âge du bronze, de ces hommes qui raillent la croyance en l’Immaculée Conception et tremblent de devoir passer sous une échelle.
Telles ont été les conséquences lointaines des premières hérésies. Tels sont les êtres que Luther a le droit de reconnaître pour les siens.
(80) 77. L’argument de la durée.
Qu’écrire d’autre sur ces recherches ardentes, sinon que leur peu de durée témoigne contre elles. Descartes est encore vivant qu’on discute son argumentation sur la pensée des bêtes. Lors de l’affaire des Princes, Luther se dément lui-même. Le XVIIIe siècle avec Fontenelle et Bayle, Buffon et Montesquieu, Diderot et Condillac, semble connaître le dernier point de l’enchevêtrement. Mais le XIXe le dépasse : sur Gœthe inachevé, Kant pose son postulat ; Nietzsche détruit Schopenhauer qu’il adorait. La France entend, au même instant, les voix contraires de Babœuf et de Chateaubriand, de Maistre et de Musset, de Lacordaire et de Fourrier, de Renan et de Hello. Tandis que, de Darwin aux Victoriens, les philosophes anglais se taillent des univers où, tour à tour, l’homme est singe et roi.
Il y a quelques années, on pouvait voir Alain se contredire d’un ouvrage à l’autre. Les livres de philosophie étaient devenus si nombreux et si vains que nul ne les lisait, hormis des étudiants hagards. Ceux qui font métier de penser ne s’entendaient plus sur rien si ce n’était la négation de la morale.
(81) 78. L’amoralisme.
Cette attitude, assurément, se comprenait. Sur l’ébauche d’une morale universelle, les hommes-chercheurs, comme les hommes-loi, se cassaient les dents. Et ces deux seules méthodes étant connues : le subjectivisme analytique et l’objectivisme synthétique, on ne voyait rien au delà.
Il apparaissait ainsi que la cause trouvée aux échecs des trois grandes morales n’était que secondaire et qu’il existait une cause organique dont le mystère demeurait entier.
Autrement dit, il était possible que le Mont Sinaï fut responsable de la faillite de la morale physique, mais il apparaissait aussi que cette morale se fut effondrée sans Moïse ni Mahomet parce qu’elle n’était qu’une morale sensuelle. Il était possible que le Lycée fut responsable de la faillite de la morale intellectuelle, mais il apparaissait aussi que cette morale se fut effondrée sans Platon ni Aristote parce qu’elle n’était qu’une morale rationnelle. Il était possible que les Conciles fussent responsables de la faillite de la morale spirituelle, mais il apparaissait aussi que cette morale se fut effondrée sans Saint Paul ni Augustin parce qu’elle n’était qu’une morale mystique.
Une telle position nous introduisait à l’amoralisme.
(82) 79. Etat présent de la morale.
Aussitôt, on proclame le problème résolu, et chacun se jette sur ce nouvel os. Il n’était à cette solution qu’une brèche : c’est que l’amoralisme n’existe pas. L’homme n’a jamais été moins libre qu’aujourd’hui. De la tutelle de l’Israëlite, du Grec et du chrétien à l’esclavage de l’homme moderne, il n’y a d’autre différence qu’entre celui qui n’obéit qu’à une morale et celui qui obéit à toutes.
L’amoralisme, ou ce qu’on a appelé de ce nom, n’est, au vrai, qu’une confrontation de morales. Soit qu’il s’agisse d’un conflit permanent entre la morale rationnelle et la morale mystique, comme dans le Faust de Gœthe ; soit qu’il s’agisse, comme dans les œuvres de Nietzsche, de ce même conflit retourné ; soit qu’il s’agisse, enfin, comme dans “L’Immoraliste”, “Les Caves du Vatican”, “Les Nourritures Terrestres”, “La Porte Étroite”, du conflit habilement nuancé entre une morale mystique et une morale sensuelle, cette fameuse destruction est très loin de détruire.
Je ne sous-estime pas la nécessité où nous étions de lire de tels ouvrages. Cette confrontation a plus servi la cause de l’humanité que dix mille ans de moralisme formel. Mais enfin, quel que soit le mérite qu’on reconnaisse à ces découvreurs courageux, il faut dire qu’il n’est pas celui dont ils se paraient, tout au contraire ; et que nulle thèse, si dogmatique fut-elle, n’avait offert à l’homme des images plus cruelles de sa dépendance morale. Loin de prouver que l’homme pût vivre sans éthique, ils ont démontré clairement qu’une règle lui est nécessaire, et que son malheur est né de la pression sur lui de trop de règles contradictoires.
(83) 80. La cause organique.
Ces travaux et ces œuvres ont eu, au moins, une conséquence : la démonstration de la cause organique à quoi était dû l’échec des morales. Cette cause est que, dans leurs applications, sinon dans leur dogme, toutes les morales édifiées ne situaient l’homme que sur un plan. Découverte d’une portée incalculable, puisqu’elle conduit à poser le problème de La Trinité de l »Être Humain
(84) 81. Au fond de l’Inconnu pour trouver le nouveau…
Certes, il est évident que, dans l’état actuel des connaissances, le héros, le sage et le saint ne peuvent coexister dans le même individu. Mais le rapprochement de ces trois sommets et le sentiment qu’au regard de cette Trinité, le héros, le sage ou le saint paraîtrait inachevé, pour tout dire : inhumain, sont déjà d’immenses conquêtes.
Que, pour réaliser une telle perfection, soit nécessaire la transformation, le renversement des principes, des dogmes, des croyances, des habitudes de vivre et de penser ; et qu’il y faille une soudaine évolution, non seulement de la philosophie, mais des sciences appliquées, des conditions de vie, de l’économie politique et de la conception générale de l’homme, nul plus que moi n’en est persuadé.
Reste à savoir si le moment n’est pas venu, en effet. Et si ce que d’aucuns appellent l’impasse des recherches humaines ne constitue pas la route inédite qui, par les voies du ciel, des murailles et des fleuves, nous introduit à la
Quatrième dimension.
II
UN ÉLÉMENT NOUVEAU : LE TEMPS
Ignorer, c’est ne connaître que l’apparence. Dans ce sens, j’ai le droit d’écrire que les moralistes ont toujours ignoré le Temps.
(85) 82. Les vieilles catégories : Passé, Présent, Avenir.
Celui qui juge de l’extérieur des choses méconnaît les choses. Celui qui dit : “Le soleil se lève, monte, descend, se couche” et ne voit rien au delà ignore ce dont il parle. Ainsi, celui qui dit : “Le Passé, le Présent, l’Avenir” ignore le Temps ou ne le connaît que dans la mesure, très exactement, où connaît le soleil celui pour qui l’astre est un cercle jaune ou rouge qui se rapproche et s’éloigne de la terre.
Expliquez à cet homme que le soleil n’est pas un cercle, qu’il n’est ni jaune ni rouge et que, s’il n’est pas immobile, son mouvement n’est pas celui qu’il imagine, il criera au mensonge, au paradoxe, à la fantaisie. Il dira que vous niez le soleil. Pourtant le soleil existe, mais sous une autre forme et d’après d’autres lois. mieux : ce n’est que son apparence vaincue qu’il revêt, vraiment, une existence. Et ce qui semblait le prouver était précisément ce qui le détruisait (car n’est-ce pas détruire un être que le restreindre à son image ?).
C’est ainsi que le présent, le passé et l’avenir sont des illusions nées de la troisième dimension. Et c’est ainsi que ces illusions, jusqu’à nos jours, ont entretenu notre ignorance du Temps.
(86) 83. Le Renouvellement et le Changement.
Pour l’homme physique, le temps possède deux aspects : “Ce qui était là et s’y trouve encore”, “Ce qui n’était pas là et y apparaît”. Il ne connaît le passé que par le renouvellement : “J’ai déjà fait tel geste, respiré telle fleur”. Il ne connaît l’avenir que par le changement : “Je n’ai pas…, etc…”. Quant au présent, il l’ignore puisqu’il y vit sans cesse. Ou plutôt, le présent lui-même n’emprunte que l’un ou l’autre des deux aspects.
S’il connaît le passé, ce n’est que dans la présence par la tradition. Et c’est dans la présence qu’il connaît l’avenir par le pressentiment. Cela vient de ce qu’il ne sait que deux existences : lui – et l’autre ; et l’Autre est toujours celui qui est là.
(87) 84. La Représentation et l’Evolution.
Le monde intellectuel est différent. Pour l’esprit, le temps est essentiellement ce qui se continue ; c’est à dire, puisque le présent est discontinuité et l’avenir inconnu, ce qui est du passé. Mais, parce que le passé est le monde de l’esprit, l’esprit ignore le passé en tant que tel. Et celui-ci ne lui apparaît jamais que sous la forme d’une représentation (percevoir, c’est se souvenir) ou d’un travail de construction, nécessairement évolutif.
Par la représentation, l’esprit prend conscience du présent ; par l’évolution, il comprend l’avenir. Il ne peut être question, ici, bien sûr, que de son propre passé et de son propre avenir, puisque l’esprit ne connaît que deux existences : lui en tant que sujet et lui en tant qu’objet, et que l’un et l’autre ne sont pensables que si, déjà, ils sont dans le plan de la continuité.
(88) 85. La Situation et la Projection.
Pour l’âme, enfin, le Temps c’est ce qui devient et donc, puisque le passé est révolu et le présent statique, l’avenir.
L’âme, vivant dans l’avenir, ne connaît de lui que deux aspects : ce qui le porte en germe et ce qui l’a prévu. La situation et la projection apportent à l’âme le témoignage constant et sans cesse nouveau de ce qui sera. La situation lui donne la valeur actuelle de ses aptitudes, la projection, la valeur arbitraire de son vouloir.
Mais l’un et l’autre sont des vecteurs. Et, comme tels, leurs existences demeurent liées à leurs élans. Je veux dire qu’un vecteur sans but ne s’imagine pas. Et dès qu’il y a élan, il cesse d’y avoir lui ou moi. Il y a toi vers qui je vais. C’est ainsi que l’âme ne connaît que deux êtres : le point de départ et le point d’arrivée.
(89) 86. Essai d’humanisation du Temps.
La Présence. La Continuité. Le Devenir.
L’être n’existe que par des contraires qui coexistent en même temps que lui. Les êtres simples n’ont pas d’autre existence : ce ne sont que des créations de l’esprit.
Le Temps est parce qu’il n’est pas simple.
La Présence n’est qu’une discontinuité qui devient : le devenir la discontinue et la continuité l’immobilise.
La Continuité n’est qu’une présence qui devient : le devenir “l’absente” et la présence l’immobilise.
Le Devenir n’est qu’une présence qui se continue : la présence le discontinue et la continuité l’absente.
L’image classique du fleuve illustre cette complexité. Le temps est un fleuve dont la continuité est le lit, le devenir le cours, une vague la présence. Il reste bien entendu que ceci n’est qu’une image. Mais assez riche en ce sens que le cours du fleuve et ses remous ont créé son lit, que le remous naît de la contrainte du cours par les berges, et que ce cours lui-même sera formé par les vagues et bordé par les rives. ([11])
Cette simultanéité et cette dépendance entre eux des trois éléments du Temps font non seulement son existence réelle, mais encore, indubitablement, l’existence de tout ce qui est . La pierre, la fleur, l’animal, l’homme n’ont d’existence que temporellement, et les échecs répétés des morales, quelles que soient les causes secondaires qu’on puisse donner, n’ont d’autre origine que la création de mondes actuels, arbitraires ou dynamiques où le temps n’a pas place.
(90) 87. Illustration : le Temps Créateur.
La première preuve de l’existence est la complexité, la seconde est la création. De sorte que toute existence apparaît comme une complexité active. Et les deux termes sont si étroitement liés que, dans le monde intellectuel où les êtres simples apparaissent sous forme de fictions, les fictions ne portent un germe créateur que dans leur dualité (ou antinomie). Loi énoncée tout au début de cet ouvrage sous l’appellation de loi d’obstacle.
Après avoir prouvé l’existence réelle du Temps par sa complexité, il me faut donc la prouver à nouveau par sa valeur créatrice.
Les exemples connus : le métier à cartons perforés inventé en quelques années par Basile Bouchon, Falcon, Vaucanson et Jacquard ; Romas et Franklin découvrant presque le même jour le cerf-volant électrique ; Newton et Leibnitz trouvant simultanément le calcul infinitésimal, etc…, ont, depuis longtemps, illustré la formule populaire : “Il y a quelque chose dans l’air”. Il semble de plus en plus certain que les idées de Rousseau, de Voltaire, d’Alembert , de Diderot furent, malgré leurs contradictions ou à cause de ces contradictions même, la création du temps 1730-1760. Nous avons eu l’esprit 1830, l’esprit 1900. Inutile d’insister, tout exemple que je pourrais donner serait moins probant que celui qui se développe sous nos yeux.
Ne voyons-nous pas, au même instant :
l’existentialisme
des philosophes, ayant rejeté toutes les vieilles doctrines, se solidariser dans cette attitude de A. Camus : “L’absurdité est une passion, la plus déchirante de toutes” et chercher, avec Sartre, “une dualité entièrement fictive entre le moi d’une part et des structures parasitaires d’autre part” (Gabriel Marcel) ?
le surréalisme
des écrivains conduire le roman dans un univers comportemental et des poètes dans un monde surréaliste, dans le but avoué de partir d’un réel morcelé à l’extrême, par conséquent absurde, pour donner de la vie une illustration plus proche de la vérité ?
la physique nucléaire
des savants reconnaître, avec Louis de Broglie, que l’idée de “complémentarité” introduite par M. Bohr dans la physique nucléaire pour expliquer la double nature corpusculaire et ondulatoire des atomes conduit à penser “qu’une même réalité peut se présenter à nous sous deux aspects qui, au premier abord, paraissent inconciliables, mais n’entrent jamais en conflit direct. Quand, en effet, l’un de ces aspects s’affirme, l’autre s’estompe dans la mesure exactement suffisante pour qu’une contradiction soit toujours évitée”, ce qui est la destruction même du premier principe sur lequel est construit notre univers actuel : A.=.A, et fait pénétrer la science, comme les lettres et la philosophie, dans le champ de l’absurde ?
le Marxisme
des politiciens se dévouer à une doctrine qui allie contradictoirement des mesures révolutionnaires et des théories utopiques, introduisant cette même absurdité dans le domaine politique ?
Ne comprend-on pas, enfin, que ces positions recouvrent :
1°) l’angoisse d’un temps où ne sont plus applicables des méthodes périmées et le désespoir de vivre sans méthode ;
2°) le désir d’écarter des murs, de changer de sphère ; l’attente du prodige ;
3°) la découverte accélérée de secrets étranges et l’invraisemblance de cette découverte ;
4°) le souci de ne plus travailler pour “l’élite”, mais pour tout homme qui vive.
Et, surtout, animant ces différentes tendances, la théorie encore inconsciente de coexistence des contraires.
Et ne semble-t-il pas vraiment que le Temps est venu ?
III
LA METHODE DES SURCAUSES
“Tout est la vie – la vie dans la vie – la plus petite dans la plus grande et toutes dans l’esprit de Dieu”.– Edgar Allan Poe
“Les philosophes n’ont fait jusqu’ici qu’interpréter le monde de différentes manières. Il s’agit maintenant de le transformer”. – Karl Marx.
“Pourrons-nous connaître la réalité physique d’une façon objective, c’est-à-dire indépendante des moyens employés pour la connaître ?…A cette question, la réponse donnée par la Physique actuelle est négative” – Louis de Broglie
(91) 88. L’esprit du siècle.
Cette confrontation des tendances modernes de la poésie, de la science, de la politique et de la philosophie nous annonce, tout autant qu’à un carrefour, quatre poteaux qui indiqueraient que les quatre routes mènent à Rome, d’une part, que l’avenir est en germe dans tous les esprits et qu’il serait vain de songer y échapper ; d’autre part, que, pour comprendre cet avenir et accomplir le chemin promis pour y atteindre, toutes les méthodes connues sont inefficaces.
Règne de l’absurde, dira-t-on avec mépris : c’est l’attitude de l’homme-loi, le “rien ne va plus”, l’opposition farouche des hors-siècle. Ce qui est absurde dans un monde à trois dimensions ne l’est plus dès que trouvée la quatrième. L’absurdité qui donne les joyaux Valériens, permet la désintégration de l’atome, fait évoluer l’Europe vers un régime où démocratie, aristocratie et autocratie existeront simultanément, une telle absurdité vaut bien qu’on s’y arrête, non seulement parce qu’il serait vain de s’y dérober, mais parce qu’il apparaît que d’elle seule dépend la libération de l’homme.
(92) 89. Les exemples illustres.
D’ailleurs, nous n’inventons rien.
Certes, l’échec de la science 1900 et celui de la morale conventionnelle nous autorisent à nous défier de leurs méthodes. Des principes qui conduisent aux bûchers de Florence et à l’Inquisition espagnole, à la roue de la place de Grève et la guillotine n’aideront jamais au progrès de l’humanité. Pas davantage, une méthode qui conduit aux super V3.
Et, cependant, n’est-il pas étrange que, malgré ces terribles erreurs, l’humanité soit en progrès constant ? La Morale que nous évoquions par le massacre des Albigeois, n’oublions pas que nous lui devons Socrate et Jésus. Et cette Science que nous accusons, avec justice, de millions de morts, c’est à elle cependant que nous devons, entre autres choses, le vaccin et l’électricité, le phonographe et l’infrarouge, le radium et l’aéroplane.
Il n’y a pas là contradiction. Les méthodes de recherche des causes et de souci des conséquences, prises isolément, sont mauvaises et doivent être rejetées. Ce n’est ni à l’une ni à l’autre que nous devons Socrate et la dialectique, Edison et l’électricité. Ce n’est à aucune des deux que nous devons les résultats immenses du Progrès.
Je prétends que ces hommes, si peu nombreux qu’on les compterait sur ses doigts : “Euclide, Pythagore, Archimède, Paracelse, Léonard de Vinci, Newton, Pascal, Volta, Pasteur, Ampère, Edison, Curie…” et ces autres, moins nombreux encore : “Confucius, Socrate, Jésus…” ont appliqué, chacun dans son domaine, une méthode que personne, pas même eux, n’a songé à codifier. Cette méthode consiste dans l’explication de l’acte par ses conséquences, ce qui est aussi loin de la justification de l’acte par ses conséquences que de son explication par ses causes.
Edison découvre le secret de la lampe électrique en cherchant un filament (fibre de bambou) tel que sa carbonisation soit assez lente pour autoriser la lumière. Celui-là et pas un autre. Le Tungstène qui remplace cette fibre fut obtenu d’après la même méthode, par un progrès de la technique dans le sens de la réalisation recherchée. ([12])
Or cette technique que j’oppose à la morale dogmatique et à la science causale, nous la trouverions non seulement à la base des grandes inventions de ce siècle (la découverte par Louis Lumière du dispositif qui, permettant d’appliquer la persistance de l’image dans la rétine, autorise le cinématographe) mais aussi à la base des grandes découvertes morales.
Le Christ cherchant le remède aux maux spirituels des hommes refond l’univers par la découverte (ou l’invention) de l’amour. Mais l’amour est une clef de cire qui s’adapte à toutes les serrures.
Je nomme Méthode des Surcauses cette méthode de synthèse subjective et je m’en explique.
(93) 90. Méthode synthétique.
La première nécessité de la synthèse est qu’elle seule tend les énergies vers un but précisé ; la seconde est qu’elle seule hiérarchise les conjectures mentales autour d’idées maîtresses ; la troisième est qu’elle seule présente l’intérêt pratique parce que seule elle est constructive.
(94) 91. Méthode subjective.
Cependant le philosophe ne peut construire utilement qu’en ne débordant pas le cadre de ses expériences. La vérification immédiate de ses théories, lui seul est en mesure de la faire sur lui-même. Il faut qu’il apprenne à sourire des formules ; qu’il les contredise l’une par l’autre, jusqu’à ce point où l’antinomie, flagrante, apparaît et devient absurde ; qu’il laisse dormir, alors, l’inexplicable en lui sans choisir délibérément un seul des deux termes aux dépens de l’autre. L’intuition jaillira quand il s’y attend le moins, éclairant les deux termes, faisant sourdre de leur choc la flamme qui sera sa vérité.
Enfin, il faut que nul ne dise : “cette cure m’a sauvé. Elle te sauvera”, mais qu’il dise : “Voilà quel était mon mal et voilà comment je m’en suis guéri. Et maintenant, quel est le tien ?”. Le Christ ne parlait pas à la femme adultère comme au sage Nicomède. Et Gide écrivait ce mot que nous devons méditer : “Que mon livre t’enseigne à t’intéresser plus à toi qu’à lui-même.”
Le moraliste que nous souhaitons, c’est le “moraliste indélicat” qui n’applique pas pour lui les règles qu’il enseigne. Mais seule la connaissance approfondie d’un être peut autoriser cet oubli de soi. Et c’est ainsi que nous pouvons retrouver à la base des techniques – l’indispensable amour. Alors seulement une théorie – toute théorie – prendra un sens humain.
(95) 92. Servir.
Telle fut la méthode du bon rebouteux, la méthode de Socrate, la méthode de saint François de Salle et de saint François Xavier.
Telle est la méthode que j’ai souhaité employer. Plus mon éthique sera formelle comme une géométrie et proche de moi comme un poème, moins je serai éloigné de mon dessein qui fut de la rendre intelligible, aisée à concevoir et simple à pratiquer.
IV
CHAPITRE DES DEFINITIONS
(96) 93. Défense préliminaire.
L’Ethique dont je tente de jeter les bases repose :
1° Sur l’exclusion de toute métaphysique, mon étude n’étant pas Dieu mais l’homme.
2° Sur la méthode d’investigation des Surcauses (je fabrique tel remède “parce qu’il” guérit), ayant revendiqué le droit pour le philosophe d’utiliser les moyens employés par le physicien, le médecin, l’ingénieur.
3° Sur le concept de la Trinité Humaine, induit :
A – De l’étude des trois grandes morales et de la constatation qu’elle ont étudié chacune un aspect différent de l’homme.
B – De la conscience journalière de vivre sur trois plans, dont l’un est une réalité de présence, le second une notion de continuité, le troisième un élan de devenir.
4° Sur l’étude de cette Trinité à la fois dans ses éléments et dans les cycles qui concourent à l’interréaction entre les éléments ; cycles que j’imagine au nombre de deux, sur l’évidence où je suis que toute vie est renouvellement ensemble que changement, évolution en même temps que représentation, projection mais situation.
ICI COMMENCE LE CHAPITRE DES DEFINITIONS ([13])
(97) 94. Les lieux.
Ils sont :
la présence ou monde du je-lui, dont la dualité apparente est changement et renouvellement.
la continuité ou monde du je-moi, dont la dualité apparente est représentation et évolution.
le devenir ou monde du je-tu, dont la dualité apparente est situation et projection.
Images :
1° J’ai devant les yeux un mur tapissé de vert : renouvellement. Un rayon de soleil vient y faire courir une tache d’or : changement. Mais cette tâche et cette tapisserie ont ceci de commun qu’elles ne cessent pas d’être si je ne les regarde. Mon bras en interceptant le rayon ne détruit pas le rayon mais l’absente de mon regard. Je puis, en fermant les yeux, sans détruire réellement la tapisserie, l’abolir de mon lieu de présence : monde du je-lui.
2° Cette tapisserie et cette tache habitent mon esprit sous forme de représentations, en même temps que mon esprit se livre sur elles à l’opération évolutive que je décris (jugement, imagination, synthèse). Mais cette représentation et cette évolution ont ceci de commun qu’elles n’ont pas besoin du monde extérieur pour subsister. Les yeux fermés, je me représente la tapisserie avec sa tache et dans vingt ans je pourrai les retrouver en moi ; ainsi de ma pensée évolutive. Personne qui ne reconnaisse que j’ai changé de monde et que je me trouve maintenant sur le plan du je-moi : lieu de continuité.
3° Pendant que je raisonne ainsi, un ami entre que je n’ai pas vu depuis trois ans. Imaginez le trouble passionnel qui me saisit : “Qu’est-il devenu ? Comme il a maigri ! Quelle heureuse surprise !” Mais en même temps : “Et cette pensée proche de son éclosion ? Ce rythme harmonieux qu’une distraction peut me dérober ?” Alors, tendresses, questions à la fois ardentes et contraintes : “Qu’il me reste longtemps ! Qu’il s’en aille bien vite !” Situation, ce conflit entre la surprise de l’amitié et la pression de l’œuvre. Projections, des souhaits si contradictoires. Mais situation et projection ont ceci de commun qu’elles ont besoin pour être : de moi et de l’objet de mon amitié, de moi et de l’œuvre. Personne qui ne sente que dans ce dilemme l’esprit ni le corps n’ont place directement et que je ne suis plus qu’une âme embarrassée. Je viens de pénétrer dans le monde du je-tu : lieu de devenir.
Je nomme :
Présence, le lieu de la vie sensuelle.
Continuité, le lieu de la vie intellectuelle.
Devenir, le lieu de la vie passionnelle.
(98) 95. Condition et libération.
En chaque lieu, la dualité précédemment établie constitue une double condition. Chaque lieu tend à s’accomplir dans le sens d’une double libération.
Images :
1° Dans mon exemple de la tapisserie, renouvellement et changement sont exactement dosés pour permettre la libération par l’acte (ici, conscience). Il n’en aurait pas été de même si j’avais évoqué un changement trop violent tel qu’un grand froid ou une brûlure.
2° De même, mon second exemple était un exemple de libération d’un lieu de continuité, par arbitraire (ici, volonté de l’œuvre). Il n’en aurait pas été de même si j’avais évoqué une représentation contraire à l’évolution de ma pensée, telle que deux faits antinomiques.
3° Dans mon troisième exemple, au contraire, la situation et la projection s’offrent comme des conditions dans un lieu de devenir. Je m’en libérerai en équilibrant mes aptitudes (l’élan d’amitié) et ma volonté (l’œuvre) dans le sens de l’une quelconque des deux passions, à condition de n’être plus “je”, mais l’œuvre ou l’ami.
C’est ainsi que :
La Présence est passive ou agissante.
La Continuité dépendante ou libre.
Le Devenir dirigé ou spontané.
Je nomme :
Etat la Présence passive.
Conjecture la Continuité dépendante.
Impulsion le Devenir dirigé
Telles sont les trois dualités conditionnelles de l’homme.
Les Etats correspondent aux apparences temporelles du Renouvellement et du Changement. Ils sont l’Accoutumance et l’Appétit (ou Attention).
Les Conjectures correspondent aux apparences temporelles de la Représentation et de l’Evolution. Elles sont la Conscience et l’Intelligence.
Les Impulsions correspondent aux apparences temporelles de la Situation et de la Projection. Elles sont l’Aptitude et la Volonté.
Je nomme :
Acte la Présence agissante.
Arbitraire la Continuité libre.
Mouvement le Devenir spontané.
Telles sont les trois dualités libératrices de l’homme.
Les Actes correspondent aux apparences temporelles de la Représentation (lieu du je-moi) et de la Situation (lieu du je-tu) et, par conséquent, sont libérateurs du lieu de Présence. Ils sont la Conscience et l’Aptitude.
Les Arbitraires correspondent aux apparences temporelles du Renouvellement (lieu du je-lui) et de la Projection (lieu du je-tu) et, par conséquent, sont libérateurs du lieu de Continuité. Ils sont l’Accoutumance et la Volonté.
Les Mouvements correspondent aux apparences temporelles du Changement (lieu du je-lui) et de l’Evolution (lieu du je-moi) et, par conséquent, sont libérateurs du lieu de Devenir. Ils sont l’Appétit et l’Intelligence.
Ce qui m’autorise à définir :
Accoutumance : l’état d’arbitraire.
Appétit : l’état dynamique.
Conscience : la conjecture actuelle.
Intelligence : la conjecture dynamique.
Volonté : l’impulsion arbitraire.
Aptitude : l’impulsion actuelle.
et à émettre l’axiome I : “Toute libération d’un lieu est condition d’un autre.”
(99) 96. Cycle essentiel et cycle accidentel.
Un tel axiome exige, pour se concevoir, l’existence constante d’une double interréaction entre les trois lieux ; interréactions auxquelles leur constance donne les apparences de deux cycles. Tout se passe, en effet, comme si :
1°) D’une part, le changement, la représentation et la projection étaient dans un rapport constant de modifications accidentelles.
2°) D’autre part, le renouvellement, la situation et l’évolution étaient dans le rapport constant de structures essentielles.
Ce pourquoi je nomme :
Cycle essentiel, le cycle : accoutumance, aptitude, intelligence.
Cycle accidentel, le cycle : appétit, conscience, volonté.
Cette combinaison de deux cycles, de trois spires chacun, se rencontrant en trois lieux différents, de façon qu’en chaque lieu, deux spires donnent naissance à deux autres, est évidemment impossible à représenter par une figure géométrique dans un univers euclidien. La coupe que je dessine ici ne prétend donc pas à la représentation exacte des trois lieux humains (dans la réalité, les conditions “Intelligence” et “Volonté” n’ont pas, en absolu, une valeur plus grande que les autres) et ne permet que de comprendre l’interréaction des conditions libératrices.
Quant à la figure exacte que je souhaite, il me faudrait, avant de la réaliser, savoir comment représenter dans un univers à trois dimensions : 1) Que les trois spires d’un même cycle sont, en absolu, d’égales longueurs, et que le cycle, cependant affecte la forme d’un huit (ou d’un cercle ou d’une ellipse). 2) Que les deux cycles sont d’égales longueurs et de forme identique et cependant se coupent en trois points.
(100) 97. Le bien et le mal.
Ceci explique la diversité très grande des morales et donne un sens nouveau à ces vieux mots : le Mal et le Bien que se renvoient les sectaires des morales opposées.
Nous avons vu, en effet, au cours de cette étude, les moralistes physiques, admettre, sinon glorifier, l’orgueil et la colère, alors que les intellectuels considèrent la colère comme l’un des obstacles à la sagesse et les mystiques l’orgueil comme une des causes de l’égoïsme.
Nous avons vu les moralistes intellectuels accroître par leurs vertus intellectuelles, la luxure et l’avarice, alors que la luxure est un obstacle à la pureté et l’avarice la seconde cause de l’égoïsme.
Nous avons vu les moralistes spirituels vivre et faire vivre leurs disciples dans une insatisfaction de l’heure qui mène tout droit à l’impureté de la gourmandise, à l’insanité d’une envie rentrée, que Taine qualifiait de “délire chronique de la persécution”.
Mais nous l’avons dit également, ces Morales se tournaient vers les conséquences et non vers les causes. Il ne peut donc nous étonner que ces divergences proviennent de conceptions différentes de la libération humaine.
Pour le sensuel, cette Libération ne peut être que jouissance ; pour l’intellectuel, science ; pour le spirituel, amour. Or, nous savons que celui qui vit dans la présence et pour la seule plénitude des sens, ne sera jamais un sage ni un saint. De même que l’apôtre sous-estimera son corps et son esprit. De même encore que le Sage laisse dessécher son âme et s’atrophier sa chair.
Telles ont été, au cours des âges, les conséquences les meilleures de ce terrible dilemme inventé par l’homme : le bien et le mal.
En réalité, ces mots n’ont de sens que dans l’un quelconque des trois lieux et ne recouvrent une valeur réelle que s’ils signifient : équilibre et déséquilibre (égalité ou inégalité). Le mal n’est plus qu’un manque, ou un excès.
D’où l’axiome II : “La libération d’un lieu ne s’accomplit que par l’équilibre de ses conditions.”
Cet équilibre est Assimilation, si les conditions sont statiques, Hiérarchie si les conditions sont conjecturales, Sympathie si les conditions sont impulsives.
(101) 98. L’Accomplissement.
Il apparaît que chacun des trois lieux obéit à une loi qui lui est propre, chacune de ces lois n’étant qu’une des expressions de ce troisième axiome :
III – De la conception à la libération les trois étapes sont d’acceptation, d’équilibre et de parité.
A) Dans le lieu de Présence :
Je nomme Adaptation l’acceptation de la dualité changement-renouvellement, Assimilation son équilibre, Concordance la parité du je-lui.
L’Inadaptation mène à l’inassimilation, donc à la douleur
B) Dans le lieu de Continuité :
Je nomme Sélection l’acceptation de la dualité représentation-évolution, Hiérarchie son équilibre, Organisation la parité je-moi.
La Trivialité mène à l’éparpillement, donc au malheur.
C) Dans le lieu Devenir :
Je nomme Soumission l’acceptation de la dualité situation-projection, Sympathie son équilibre, Altérité la parité je-tu.
L’Insoumission mène à l’apathie, donc au désespoir.
(102) 99. Les Lois.
Les lois sont :
1°) Loi de Présence : J’assimile ce à quoi je m’adapte.
2°) Loi de Continuité : Je hiérarchise en moi ce que je sélectionne.
3°) Loi de Devenir : J’aime en fonction de ce que je donne.
(103) 100. Le Besoin.
Le Mal est, dès lors, ce qui s’oppose à l’accomplissement, c’est-à-dire à la métamorphose de la condition en libération.
Celui qui s’abandonne à ses accoutumances ou à ses appétits, sans chercher à les adapter les unes aux autres ;
Celui qui s’abandonne à sa conscience ou à son intelligence, sans chercher à les sélectionner l’une par l’autre ;
Celui qui s’abandonne à ses aptitudes ou à ses volontés, sans chercher à les soumettre les unes aux autres ;
Est responsable de sa douleur, de son malheur et de son désespoir.
Je nomme cette paresse : le Besoin.
Les besoins sont :
La gourmandise, la luxure, la colère, l’envie, l’orgueil, l’avarice ; ceux qui s’y abandonnent sont :
Des inaccoutumés ou instables, des inappétants, des inintelligents, des inconscients ,des abouliques, des impuissants.
(104) 101. La Sensation.
Je nomme Sensation l’état actuel.
Les conditions statiques sont l’accoutumance et l’appétit.
1) Le déséquilibre des états donne naissance à la douleur par inassimilation.
A) Si le déséquilibre se présente sous la forme :
Accoutumance > Appétit
Il y a douleur par inappétance.
Exemple : la vingtième cigarette ; l’acte sexuel renouvelé trop fréquemment par habitude ; le “fourmillement” dans les mains, les jambes ; les habitudes dites “mauvaises” d’être assis, couché, et, d’une manière générale, tout besoin d’une même chose physique.
Je nomme Luxure l’inadaptation des états par excès d’accoutumance.
B) Si le déséquilibre se présente sous la forme :
Appétit (ou attention) > Accoutumance
Il y a douleur par inaccoutumance.
Exemple : la faim, la soif, le froid vif, la brûlure, la blessure, l’abus des mets, des boissons, des parfums à l’instant où cet abus se fait sentir… Et d’une manière générale, tout besoin d’une autre chose physique.
Je nomme Gourmandise l’inadaptation des états par excès d’appétit.
2) L’équilibre des états donne naissance à la sensation d’assimilation ou plaisir.
Cette sensation s’accomplit en concordance, qui est la forme actuelle de la libération.
Les deux concordances possibles sont :
A) La libération du lieu de présence en lieu de continuité par la conscience.
B) La libération du lieu de présence en lieu de devenir par l’aptitude.
(105) 102. L’Entendement.
Je nomme Entendement la conjecture arbitraire.
Les conditions conjecturales sont la conscience et l’intelligence.
1) Le déséquilibre des conjectures donne naissance à la notion de malheur par éparpillement.
A) Si le déséquilibre se présente sous la forme :
Conscience > Intelligence
Il y a malheur par inintelligence.
Exemple : On m’oppose des arguments inattendus, contraires à mes principes… ([14])
Je nomme Colère la trivialité des conjectures par excès de conscience.
B) Si le déséquilibre se présente sous la forme :
Intelligence > Conscience
Il y a malheur par inconscience.
Exemple : Le chimérique, le “spleen” Baudelairien, le trop connu…
Je nomme Envie la trivialité des conjectures par excès d’intelligence.
2) L’équilibre des conjectures donne naissance à l’entendement hiérarchisé ou Bonheur.
Cet entendement s’accomplit en organisation qui est la forme arbitraire de la libération.
Les deux organisations possibles sont :
A) La libération du lieu de continuité en lieu de présence par l’accoutumance.
B) La libération du lieu de continuité en lieu de devenir par la volonté.
(106) 103. La Passion.
Je nomme Passion l’impulsion dynamique.
Les conditions impulsives sont l’aptitude et la volonté.
1)Le déséquilibre des impulsions donne naissance au désespoir par apathie.
A) Si le déséquilibre se présente sous la forme :
Aptitude > Volonté
Il y a désespoir par aboulie.
Exemple : Je dois faire cela et n’en ai pas le courage. Je pourrais rompre et reste enchaîné – ou, au contraire, je pourrais m’attacher tel être et ne fais pas la démarche qu’il faudrait faire…
Je nomme Orgueil l’insoumission des impulsions par excès d’aptitude.
B) Si le déséquilibre se présente sous la forme :
Volonté > Aptitude
Il y a désespoir par impuissance.
Exemple : Je veux guérir un être cher qui va mourir ; je veux être libre et je suis en prison. Je veux être riche et je suis pauvre, en bonne santé et je suis malade…([15])
Je nomme Avarice l’insoumission des impulsions par excès de volonté.
2) L’équilibre des impulsions donne naissance à la passion sympathique ou joie.
Cette passion s’accomplit en Altérité qui est la forme dynamique de la libération.
Les deux altérités possibles sont :
A) La libération du lieu de devenir en lieu de présence par l’Appétit.
B) La libération du lieu de devenir en lieu de continuité par l’Intelligence.
(107) 104. Le Désir.
Des deux axiomes :
I – Toute libération d’un lieu est condition d’un autre.
II – La libération d’un lieu ne s’accomplit que par l’équilibre de ses conditions.
Je puis construire le premier théorème de la Nouvelle Ethique :
“L’équilibre des conditions d’un lieu est lié aux libérations des deux autres lieux qui provoquent ces conditions”.
Ou, plus simplement : Théorème I :
“La libération d’un lieu est liée aux directions données aux libérations des deux autres lieux.”
Je nomme Désir cette direction des libérations, qui s’exprime par une tentative vers l’équilibre, à partir de l’adaptation, de la sélection ou de la soumission.
Les désirs sont :
Désirs d’Adaptation
L’Harmonie : Libération du lieu de continuité dirigée arbitrairement vers le lieu de présence pour équilibrer l’excès d’appétit (ou Gourmandise). Adaptation arbitraire des appétits par l’accoutumance. Vertu intellectuelle primant le renouvellement sur la projection.
L’Attente : Libération du lieu de devenir dirigée dynamiquement vers le lieu de présence pour équilibrer l’excès d’accoutumance (ou Luxure). adaptation dynamique des accoutumances par l’appétit (ou Attention). Vertu spirituelle, primant le changement sur l’évolution.
Désirs de Sélection
La Juste Conscience : Libération du lieu de présence dirigée actuellement vers le lieu de continuité pour équilibrer l’excès d’intelligence (ou Envie). Sélection actuelle de l’intelligence par la conscience. Vertu sensuelle primant la représentation sur la situation.
La Croyance : Libération du lieu de devenir dirigée dynamiquement vers le lieu de continuité pour équilibrer l’excès de conscience (ou Colère). Sélection dynamique de la conscience par l’intelligence. Vertu spirituelle primant l’évolution sur le changement.
Désirs de Soumission
La Puissance : Libération du lieu de présence dirigée actuellement vers le lieu de devenir pour équilibrer l’excès de volonté (ou Avarice), soumission actuelle des volontés par l’aptitude. Vertu sensuelle primant la situation sur la représentation.
Le Courage : Libération du lieu de continuité dirigée, arbitrairement, vers le lieu de devenir pour équilibrer l’excès d’aptitude (ou Orgueil). Soumission arbitraire de l’aptitude par la volonté. Vertu intellectuelle primant la projection sue le renouvellement.
Mais la double interréaction (ou cycles) qui autorise ce théorème, va nous permettre de le préciser.
Sachant que la situation, l’évolution et le renouvellement d’une part, la représentation, la projection et le changement d’autre part, sont entre eux dans un rapport constant, je peux écrire que primer la situation sur la représentation, revient à primer l’évolution sur le changement, et encore à primer le renouvellement sur la projection. C’est-à-dire, par exemple, que l’excès de volonté peut être neutralisé, aussi bien par une libération du lieu de présence en aptitude que par une libération du lieu de continuité en accoutumance. Mais il ne peut être neutralisé par l’intelligence qui est libération du lieu de devenir, cette libération n’étant pas réalisable tant que l’excès de volonté ne sera pas neutralisé. Ce qui formule le second théorème :
Théorème II :
Tout besoin peut être neutralisé par deux libérations d’un même cycle, la troisième libération de ce cycle étant celle du lieu même où s’exerce le besoin.
et permet de classer les désirs et les besoins en deux catégories :
A) Les besoins essentiels : la luxure, l’envie, l’orgueil, auxquels s’opposent les désirs accidentels : l’attente, la juste conscience, le courage.
B) Les besoins accidentels : la gourmandise, la colère, l’avarice, auxquels s’opposent les désirs essentiels : l’harmonie, la croyance, la puissance.
(108) 105. Applications.
Les applications de ces règles élémentaires sont trop nombreuses et trop variées pour être même suggérées ici. Elles sont aussi nombreuses que les cas d’égalités et d’inégalités qui peuvent exister entre A, A’, A”, B, B’, B”.
Ce nombre nous est donné par la formule mathématique :
(1x2x3x…xn) + (1x2x…x(n-1)) + (1x2x…x(n-2)) + (1x2x…x(n-n))
soit, pour les six conditions humaines : 873 combinaisons, dont 720 cas d’inégalités ; 150 cas d’égalités et d’inégalités ; 1 cas d’égalité. Cette formule permet de comprendre, sans l’intervention du Diable, “qu’il y ait beaucoup d’appelés et peu d’élus”, “qu’il soit plus difficile de faire le bien que le mal” et toutes autres expressions morales dont s’est bercée naguère la paresse des hommes. ([16])
(109) 106. Affectivité et accomplissement.
Il me reste à parler d’un très ancien mystère, l’un des plus irritants : la nécessité de la souffrance.
Comme nous avons vu pour le Temps, pour le Bien et le Mal, que ces illusions recouvraient des réalités, ainsi le dogme de la “nécessité de la souffrance” correspond à une réalité que les législateurs n’ont pas su découvrir.
Si en effet l’affectivité et l’accomplissement sont liés, ce n’est nullement dans le sens : souffrance moyen de rachat.
Qu’il y ait accomplissement ou non il y aura souffrance, car la souffrance n’est proprement causée que par un changement de lieu, donc par une libération.
La volonté, bonheur arbitraire sera désespoir dans le lieu de devenir, si elle n’y est dans un rapport de soumission avec l’aptitude.
L’accoutumance, bonheur arbitraire sera déplaisir dans le lieu de présence, si elle n’y est dans un rapport d’adaptation avec l’appétit.
La conscience, plaisir actuel sera malheur dans le lieu de continuité si elle n’y est dans un rapport de sélection avec l’intelligence.
L’aptitude, plaisir actuel sera angoisse dans le lieu de devenir si elle n’y est dans un rapport de soumission avec la volonté.
L’appétit, joie dynamique sera douleur dans le lieu de présence s’il n’y est dans un rapport d’adaptation avec l’accoutumance.
L’intelligence, joie dynamique sera doute dans le lieu de continuité si elle n’y est dans un rapport de sélection avec la conscience.
Il apparaît donc que celui qui ne tenterait aucune libération ne devrait pas souffrir. Mais ceci n’est que théorique, en réalité nulle vie uniquement conditionnelle n’est concevable puisque une condition d’un lieu est toujours libération d’un autre. Il se produirait donc (et c’est ce qui se produit effectivement) que l’homme serait libéré, malgré lui, à tout instant de sa vie. Il n’est pas question de choisir entre être libéré ou ne l’être pas, mais de choisir entre les libérations possibles. Et c’est ce choix, non l’autre, que je nomme Vertu.
(110) 107. Les Vertus : la loi de Gratuité.
Il apparaît, en effet, que le double jeu des cycles dans les trois lieux se présente comme un cercle vicieux. L’homme ne se libère d’un lieu que pour tomber dans d’autres conditions. Il n’échappe au désespoir que pour connaître la douleur ou le malheur et sa vie s’écoule dans ce combat perdu d’avance. Si telle était la réalité, elle aboutirait au pessimisme justifié de Sartre : elle prouverait l’absurdité de la vie.
Or, nous savons que des hommes échappent à ce conflit. Sans rappeler de plus hauts exemples, nous connaissons tous des savants, des artistes, des pères et des mères de famille qui se sont libérés de ce tragique dilemme. Certains d’entre eux sont mahométans, d’autres chrétiens, d’autres encore matérialistes et nous ressentons comme une évidence que leur confession métaphysique n’intervient qu’indirectement dans leur équilibre (même lorsqu’ils se feraient tuer pour prouver le contraire). Il nous faut donc admettre qu’il existe un moyen de s’arracher au cercle. Reste à savoir si ce moyen lui-même ne peut pas faire l’objet d’une loi théorique.
Nous avons vu que les conditions en elles-mêmes, ne font pas naître la souffrance : la douleur, le malheur et le désespoir ne sont provoqués que par leur déséquilibre, c’est-à-dire l’excès de l’une ou l’autre des conditions. Supprimez l’excès : vous supprimerez le déséquilibre. La Nature nous offre mille exemples d’une prodigalité sur laquelle les biologistes ne cessent de méditer ([17]). Cette loi de gratuité que nous découvre l’étude des bêtes et des plantes, pourquoi ne serait-elle pas aussi une loi humaine ?
La libération d’un lieu serait ainsi, non double, mais triple : libérations cycliques, au nombre de deux et libération hors cycle où s’épuiserait l’excès même de la libération. Nous aurions alors, contrebalançant la loi conditionnelle d’obstacle, une loi de libération, dite de Gratuité qui s’énoncerait ainsi :
L’équilibre des conditions d’un lieu peut s’obtenir par une parfaite gratuité dans les libérations des deux autres lieux.
(111) 108. La Pureté , l’Evidence et le Sacrifice.
Dans le lieu de présence, trois libérations :
L’Acte conjectural ou Conscience ; l’Acte impulsif ou Aptitude ; l’Acte gratuit.
Dans le lieu de continuité, trois libérations :
L’Arbitraire statique ou Accoutumance ; l’Arbitraire impulsif ou Volonté ; l’Arbitraire gratuit.
Dans le lieu de devenir, trois libérations :
le Mouvement statique ou Appétit ; le Mouvement conjectural ou Intelligence ; le Mouvement gratuit.
Je nomme
Pureté, l’acte gratuit.
Evidence, l’arbitraire gratuit
Sacrifice, le mouvement gratuit.
Ils se réalisent tous les trois en œuvres :
l’œuvre sensuelle ou Beauté : concordance absolue du je-lui ;
l’œuvre rationnelle ou Vérité : organisation absolue du je-moi ;
l’œuvre mystique ou Bien : altérité absolue du je-tu.
CONCLUSION GENERALE
À L’INTRODUCTION
Ici s’arrête l’effort ordonné de ma pensée. Des jalons sont posés qui peuvent, il est vrai, ne guider qu’un petit nombre d’ardents. Mais c’est volontairement que je ne ferme pas les portes. Si j’allais plus avant dans mon initiation, ce ne serait plus le siècle qui parlerait ici, mais mon esprit de philosophe. Et le temps des philosophes est révolu. Je n’ai voulu que marquer cette époque où nous sommes. Si j’avais pu aller moins avant, je l’eus fait, car le peu que j’ai dit représente, je le sais, une théorie et cela seul éloignera de moi des hommes qui fussenr venus à moi si j’avais eu le pouvoir de parler moins clairement. Mais je n’avais pas ce pouvoir. Et tout a pris naissance en moi, malgré moi-même, au hasard des lectures, des rencontres et des rues, par mes yeux, mes oreilles, mes mains et mon amour et par l’esprit aussi qui compose secrètement en une œuvre arbitraire le langage des yeux, des mains et de l’amour. Il n’y a dans ce livre aucune volonté, si ce n’est celle de parler en homme pour des hommes. Aucun autre souci que de prendre témoignage de l’être le plus entier. Écrire avec plaisir pour son plaisir, avec bonheur pour mon bonheur, ,avec joie pour ta joie.
Il y aura d’autres témoignages. Il ne faut pas que l’artiste construise pour lui seul, que le philosophe pense pour lui seul. Je vois d’immenses laboratoires de la pensée où, penchés sur des livres, où, penchés sur eux-mêmes, les médiateurs, comme les savants de nos jours, travailleront tous ensemble, non plus pour satisfaire un insatiable orgueil, mais pour servir, chacun selon sa mesure, la recherche de la vérité.
Car ce qui manque aux penseurs d’aujourd’hui ce n’est pas une idée mais le temps qu’il faut pour la vérifier. Aucun d’eux n’a eu toutes les maladies, subi toutes les souffrances ; aucun d’eux n’a lu tous les livres, ni n’a vécu toutes les vies dans sa vie. Tôt ou tard, il butte sur cet événement qu’il n’a pas connu. et, dès lors, son savoir est vain. il lui faut où s’arrêter sur cette lisière ou courir le risque de l’erreur. Toutes les théories pêchent par ce manque. Et cela durera jusqu’au jour où, vaincue l’ambition personnelle, les penseurs travailleront, sur un schéma donné dans une nudité toute élémentaire, avec désintéressement.
Alors, mais alors seulement, sera réalisé, grâce à la technique, ce que ne peut accomplir un génie isolé : la libération totale de l’homme.
LES IMAGES MORALES
LA VAGUE
Délicate et creusée en sillons parallèles,
La mouette au vol lent compose avec ses ailes
Une danse identique au jeu de mon essor ;
Ce qui n’est pas s’agite en ce qui est encor
Telle sur ma dentelle une larme d’écume
Tremble de s’égarer au frisson qu’elle assume
Quand, étroite la rive ou le courant trop fort,
Tendant à délirer mon impatient effort
Je me rêve levée en un glacis de marbre
Sur le barrage étroit d’une racine d’arbre.
LE PLAISIR
Tout s’est tu qui n’est pas la chanson de la mer
Ou le cri d’un oiseau dans la torpeur de l’air,
Tout s’est tu qui n’est pas l’écho de la présence
Sur le câble tendu d’un plaisir éphémère.
De hauts sommets pétrissent d’infini
La paix de mon silence.
Des rayons blancs éclairent le parvis
À la place que j’ai choisie.
Ma poitrine s’emplit d’un air chargé de sel.
C’est le soir. Des jardins grand ouverts sous le ciel
Monte un rose parfum de jeunes agonies.
Mes gestes ont gagné leur allure éternelle.
Oisifs, mes doigts s’entraînent au savoir
D’un marbre d’harmonie.
Que manque-t-il à mon désir ce soir,
Sinon le goût des grappes noires ?
Que manque-t-il à mon désir – pur, oh ! si pur ! –
Sinon le goût de ces grappes de raisin mûr
Qu’une treille balance à niveau d’un visage
Qui retarde à loisir l’instant de la capture ?
LE LIT DU FLEUVE
Des siècles ont formé ma trace et mon destin ;
Dans le mouvant miroir dont j’avive le tain
Mon immobilité me précise à moi-même
Qui d’un ouvrage sûr et patient suis l’emblème
Oui, le courant dérobe un calme où je me plais.
Mais aux vagues du ciel s’inscrivent mes reflets.
Vers la place où le vert des feuilles teint mon sable
D’une tremblante vie à moi-même semblable,
Tous gestes en avant ne sont que des retours
Où m’entraîne la force aveugle de mon cours.
LE BONHEUR
Cette ombre sur le mur évoque une féerie ;
Et je pense qu’ailleurs il neige ou pleut à flot.
Mais la lampe illumine la tapisserie
D’un cercle dur comme une volonté chérie
Et ma pensée est dans la tourmente un îlot.
Demain sera ce qu’hier a fait aujourd’hui.
Par le bien et le mal ma raison balancée
Imagine un cénacle au milieu de la nuit
Imagine une forme égale à ma pensée
Egale à la clarté que la lampe abaissée
Promène sur le mur nu comme un cri du vent,
Chaîne où chaque maillon s’inscrit dans le suivant
Faisant sourdre de place en place une lumière
Comme des mains d’enfant sur un cadran solaire.
LE COURANT
Effeuillée au rebord extrême de la cime
La poudre d’eau dissout sa fièvre en ton abîme
O ! Mer dont je ne sais si j’irai jusqu’à toi.
Ce lit nourrit de forme exacte notre émoi
Et la vague ignorante et lasse dès que prise
Libère ton futur de l’heure qu’elle brise.
Mon chemin ne s’arrête à nul pont suspendu :
Quelle attente saurait faire moins éperdu
Ce rythme inassouvi de caresse et d’Empire
Où m’accomplit l’appel océan qui m’aspire ?
LA JOIE
La cadence des pas annonce le présage :
Mille démons ont fui.
Sur l’ombre de la plaine et le vent de la nuit,
Mon allure, la tienne, aimante, pour message…
Ah ! je voudrais mourir pour renaître avec toi !
Mais trop d’âme nous presse,
Laisse enfin, laisse, laisse
L’appareil des tendresses.
Nous n’avons plus besoin que de nous seuls pour loi,
Que de nous seuls pour vivre.
Le monde est prosterné sous la sandale ailée
Que notre désir place au lieu de la vertu.
Encor, encor, veux-tu, de nous deux seuls, de nous deux ivres,
Aller plus loin toujours, au bout du monde aller ?
[1] On m’opposera certainement que, dans une étude des origines de la morale, j’ai parlé de la peur de l’inconnu comme d’un contraire à la sensation active. C’est bien dans le but de vaincre cette antinomie que j’ai cherché des rapports possibles entre la peur et le plaisir.
[2] Nous venons de rencontrer une première antinomie : la peur obstacle au plaisir et la peur-plaisir. Et, déjà, en voici une autre : la loi obstacle à la liberté et la loi chemin de la liberté. Ce genre d’antinomie sera toujours résolu par une simple confrontation des morales, comme, en fait, toutes les antinomies, quelles qu’elles soient :
La loi, pour qui s’y plie, est le terrain favorable à toutes les libertés. Elle ne devient une contrainte que pour celui qui s’y refuse.
[3] Saül fit périr les sorciers. Et l’émir Almohade Yacoub les philosophes. Bien des siècles plus tard les jeunesses Nazies brûlaient sur les places publiques les livres contraires à la doctrine de Rosenberg.
[4] Faut-il citer à l’appui de cette théorie Lesbos et les amitiés spartiates ? Les mots « l’amour grec » ne sont-ils pas entrés dans le langage courant ?
[5] Aristocratie : l’esclave sous le harnais de la meule, tandis que les roues à aubes ne servent qu’à faire sauter sur un théâtre des poupées de bois . (Pierre Devaux)
[6] On ne saurait insister assez
sur le fait que l’Eglise, maintes fois menacée, s’est toujours relevée grâce à des organisations spontanées (Georges Sorel), où les mystiques, – Saint Jean de la Croix, Saint François d’Assise, – ont joué le plus grand rôle. Ainsi peut-on dire non seulement que les morales-lois furent provoquées par des hommes-désirs, mais encore qu’elles furent entretenues par eux.
[7] La coordination de nos connaissances sur les atomes n’a pu se faire qu’au détriment de la clarté de nos représentations. (Louis de Broglie)
[8] Je pense parfois avec nostalgie à cette légende selon laquelle les Romains auraient découvert le secret de l’Imprimerie. Épouvantés par les conséquences qu’ils en prévoyaient, ils l’oublièrent bien vite.
[9] Nous savons, à tout le moins, que les Albigeois n’eussent pas été exterminés.
[10] Rimbaud : L’Impossible.
[11] Lire en annexe , les Images Morales.
[12] Pascal créant la brouette, Léonard inventant le chiffre d’or , Euclide construisant ses axiomes, Nostradamus triomphant de la peste cherchaient , un instrument, un nombre, une formule, un onguent tels qu’ils puissent permettre de porter aisément des fardeaux, de reconnaître la beauté d’une œuvre, de soutenir l’édifice osé des théorèmes, de guérir la peste de Toulouse.
[13] Il va sans dire que les mots que j’emploierai n’ont pas et ne peuvent avoir d’autre sens que ceux que je leur donne par définition, quel que soit le sens que leur prête par ailleurs l’acception populaire, grammaticale ou autre. C’est ainsi qu’il ne faudrait pas confondre le mot : désir tel que je l’ai employé moi-même (avec son sens populaire) dans l’expression ; homme-désir, avec le mot : désir tel que je l’emploierai maintenant.
[14] Ce qui rend difficile la classification de tels exemples, c’est qu’un même événement retentit différemment sur des hommes différents. Par exemple : ma femme me trompe ; si je suis surtout un intellectuel il peut y avoir malheur par inintelligence (colère) ; si je suis surtout un passionné, il peut y avoir désespoir par impuissance à reconquérir ma femme (avarice). Encore remarque-t-on que les deux possibilités dépendent du même cycle, ici le cycle accidentel.
[15] Même remarque que plus haut : l’excès d’intelligence aura les mêmes conséquences que l’excès de volonté. L’homme captif qui se veut libre est celui chez qui l’intelligence (évolution) prime la conscience (représentation), etc.
[16] Le calcul des probabilités ne laisse aucun doute sur la rigueur mathématique de la prépondérance du « mal ». L’exemple le plus simple le montrera. Soit A et B. Nous avons deux cas d’inégalité A < B et B < A contre un seul cas d’égalité : A = B.
[17] Lire les oeuvres de Goethe, de Maeterlinck, de Fabre et de Jean Rostand.
_________________________________________________________________
Les réflexions philosophiques de Jean-Charles Pichon ne furent pas déconnectées de l’actualité. Un de ses grands ennemis fut l’imposture, qu’il ne cessa jamais de dénoncer, comme en témoigne cet extrait de sa seconde autobiographie, « Un homme en creux », publiée chez Stock en 1973.
UN HOMME EN CREUX
(Extrait)
La seule trouvaille en mon étude était ce que je n’y distinguais pas : une définition nouvelle de l’Imposture. Car il est vrai que le comportement social du plus grand nombre se définit toujours comme un choix de la plus grande probabilité : la permanence, l’identité, la figuration d’un monde continu — ou ce que j’appelais d’autre part la construction de la forteresse. Autour du ranch est la pampa, autour du bastion la forêt ; mais l’homme se fie seulement à ce qui perdure (ou lui semble perdurer) : les vieilles habitudes de pensée, les religions désuètes, les doctrines enseignées, contre l’inattendu, l’informe, le hasard. Or, l’Imposture n’est autre que l’utilisation par le joueur, le technicien, de cette préférence-là, dont il ne peut être dupe.
Si j’examine quelques-unes des réussites dont je connais l’origine, le processus, le déroulement et la victoire finale, je vois qu’elles se fondent toujours sur le besoin collectif de se rassurer. Il faut que le best-seller soit l’œuvre du talent, l’exploit l’action de quelque héros, la justice exercée par des hommes intègres, etc. Car il faut que les murs du fortin ou du ranch demeurent peints aux couleurs de la Beauté, du Bien, de la Vérité.
Mais les « chefs-d’œuvre » que j’ai vu surgir en ces vingt ans, de Vipère au poing au Repos du guerrier (pour ne point aller jusqu’à Papillon) sont l’œuvre de cent hasards, non pas de quelque génie. J’avais suivi jour après, au temps des Coquillards, l’élaboration de Vipère au poing et de sa légende. Quant au livre, Bazin (Jean Hervé alors) nous en apportait les feuillets tout chauds pour que nous les corrigions et les refassions parfois. Massat, plus que moi, y travailla. Mais j’y ai travaillé aussi : on peut bien être le maître de Bazin lorsqu’on a été le modèle de Camus. Quant à la légende, il se trouve que j’accompagnai Hervé aux éditions Grasset, mon éditeur, le jour qu’il remit à Jean Blanzat (son roman accepté déjà) le chapitre de la visite de l’oncle académicien et proposa qu’on signe le livre Jean Hervé-Bazin, avant de laisser tomber le prénom et le tiret. Pour notre information, il ne parla que d’hommage à l’écrivain célèbre dont l’œuvre avait nourri ses jeunes années. Tout s’était fait ainsi, par touches successives, au hasard de l’improvisation.
Plus tard, lorsque Julliard lança « la plus jeune romancière de France », j’ai su — et je n’étais le seul — quelle femme de lettres, presque inconnue encore quoique d’un sérieux métier, avait « revu » Bonjour tristesse et quel lecteur de chez Julliard le roman suivant. Et je sais, pour en avoir reçu la confidence de l’auteur même, quelle galéjade était Le repos du guerrier, écrit en quinze jours par vengeance du refus d’un ouvrage magistral, d’une autre force et que Christiane, maintenant, a sans doute oublié.
On dira que l’œuvre littéraire se prête à ces jeux, et je ne cache pas les miens. Mais voici mieux. Quand l’affaire Bombard éclata, je n’avais aucune raison de mettre en doute l’exploit du naufragé volontaire. Puis, un dimanche (je crois) que j’étais de garde au Parisien, Le Toumelin demanda un rédacteur et je le reçus. Il affirmait que Bombard romançait son récit et « qu’il n’était même pas capable de se diriger en mer ». Les expressions techniques m’échappent aujourd’hui, mais Le Toumelin m’avait convaincu et, le lendemain, j’obtins de Claude Bellanger qu’il m’envoyât en reportage sur les traces de l’aventurier.
Je commençai mon enquête à Boulogne-sur-Mer où tous, médecins et pêcheurs, considéraient Bombard comme « le plus grand farceur de tous les temps ». Je n’en donnerai que ce témoignage : à l’hôpital Saint-Louis, le « docteur » était parvenu à servir deux années en qualité d’interne, bien qu’il ne fût qu’en troisième année de médecine et n’eût donc pas le droit de prétendre à ce poste. Il avait cependant réussi à faire patienter deux ans le directeur de l’hôpital avant que la mèche ne fût éventée. Il n’avait d’ailleurs pas poursuivi ses études et, en 1953, le « docteur » était encore un étudiant de quatrième année.
Apprenant qu’il signait son livre à Lille, j’y montai et rencontrai le Naufragé dans une librairie de la ville. Cent lecteurs faisaient la queue à la porte de la boutique, mais Bombard les abandonna quand je lui eus dit quelques mots. Dans un café proche, je lui rappelai quelques-unes de ses farces d’étudiant (il y en avait bien d’autres), démantelai la préface de son livre (son récit abusif de certain naufrage, entre autres, qui eût assis sa vocation) et lui servis enfin la démonstration technique de Le Toumelin. Il hurla que je n’avais pas le droit de le ridiculiser et que, si la presse l’ennuyait trop, il se ferait naturaliser Anglais sur-le-champ. Je poursuivis mon enquête.
Plus tard, à Monaco et Monte-Carlo, dans la bibliothèque du musée océanographique, je retrouvai le livre que Bombard avait utilisé abondamment, dans sa prétendue étude du plancton, puis je rencontrai Palmer, le compagnon de Bombard dans son premier voyage, d’un bord à l’autre de la Méditerranée, et j’obtins du Panaméen, après quelques verres de vin blanc, un récit de cette odyssée bien différent de l’histoire publiée.
Pour n’en donner que cet exemple, comme je disais à Palmer : « Tout de même, vous avez dû connaître la faim ? », il me répondit : « Jamais. — Vous pêchiez — Non. — Alors ? — Le caisson de conserves. — Mais il était scellé ! — Nous avons fait naufrage (au large des Baléares). — Oui. — On a récupéré tout le matériel. — Je sais. — Mais pas le caisson de conserves. »
Il me rapporta bien d’autres anecdotes, non moins savoureuses que celle-là. Si bien que je m’attachai à l’inquiéter et le « mettre en boule » en lui parlant des sommes fabuleuses que Bombard tirait de son ouvrage, de ses conférences et même d’un film qu’il projetait de faire tourner sur les lieux de son exploit. Fou de rage, enfin, et ivre, Palmer jura qu’il écrirait son propre récit de la traversée méditerranéenne. Je n’en demandais pas plus, je revins à Paris.
L’enquête se poursuivit à La Rochelle, où séjournait la très célèbre aventurière Conchita, puis à Tanger, un peu plus tard, quand je fus libre. Une sorte de démon me poussait : il me fallait savoir. Le problème était simple, d’ailleurs, mais je ne le compris pas tout de suite. Je m’attardais à vérifier de menus détails : par exemple, était-il exact que Bombard, à son départ d’Afrique, eût refusé de prendre un poste émetteur sur son Hérétique ? Ce l’était. Pourquoi ce refus ?
Bizarrement, le « docteur » Bombard lui-même m’avait tout révélé, à Lille, si grande était sa crainte que l’énigme fût résolue. « Je sais, m’avait-il dit, on dira que le Maheva a quitté Tanger et Casablanca, et même Las Palmas, en même temps que moi et qu’il aurait pu me prendre à bord. Mais le Maheva n’est pas arrivé aux Bermudes en même temps que moi : il allait vers le nord. Ainsi, tout tombe à l’eau. »
Il me fallut trois mois pour comprendre que le problème était de découvrir un autre navire dont la route eût croisé celle du Maheva et qui serait arrivé au large de la Barbade en même temps que l’Hérétique. Quand je l’eus découvert, je sus que je tenais la solution, car le capitaine de ce yacht, le Nymph Errant, était l’ami de l’éditeur de Bombard, de Carbuccia, qui, étrangement, avait signé le contrat pour le récit du voyage avant que celui-ci n’eût été entrepris.
Depuis le début de mon enquête, à cause de cette étrangeté, de Carbuccia m’intéressait. Lors du reportage dans le Midi, j’avais rôdé autour de sa villa et, même, je m’étais mis à l’eau, bien que je ne fusse pas un excellent nageur, pour vérifier, dans le ton des romans noirs, si, de son port privé, quelque yacht n’aurait pu ravitailler Bombard en mer. Palmer rit bien de cette hypothèse, plus tard : la réalité est plus simple. Mais le Nymph Errant offrait une piste sérieuse. Il me fallut quinze jours pour apprendre que Conchita possédait une photo qui montrait l’Hérétique transbordé d’un bateau à l’autre au beau milieu de l’Atlantique, et, sans attendre de l’avoir vue, gonflé de l’orgueil idiot de la solution trouvée, je remis tout le dossier à Claude Bellanger, certain de ses éloges. Il ne m’en fit aucun.
Derrière le Naufragé volontaire, à l’époque, il y avait non seulement les Editions de Paris (et un politicien très influent), mais la firme hollandaise qui fabriquait le canot, la marine nationale, dont certains membres supérieurs avaient flairé la bonne affaire, France-Soir, qui publiait le livre de Bombard en feuilleton, je ne sais quoi encore : tout le monde suivait. Où la peur ne régnait, l’intérêt était roi. Palmer, ayant achevé son livre, le proposait au Parisien, comme il me l’avait promis. Il demandait un million, que le journal lui refusa ; les Editions de Paris le lui donnèrent, à condition que l’ouvrage ne parût jamais. Quant à la photo, pour laquelle on demandait le million de francs aussi, je l’eus enfin entre les mains, mais je n’en pouvais rien faire.
J’avais tort de m’entêter. En septembre, Bellanger prit sur lui de m’en convaincre. Il me dit que j’étais un très grand romancier mais un journaliste détestable. Il me fallait quitter mon emploi. Ou je le faisais de mon plein gré, en touchant une indemnité qui m’était due et avec l’assurance d’être employé très vite par des journaux amis, ou bien on trouverait la faute professionnelle qui m’exclurait des cadres.
Je n’avais pas écrit de roman depuis mai 1952 ; je voulais ma liberté, en effet, pour écrire. J’acceptai la formule de la démission. L’indemnité me donnait un trimestre d’existence. Je n’en employai que la moitié à composer les Clés et la prison, où je contais certains de mes souvenirs de reporter et prédisais la mort mystérieuse de ma femme. Avant la fin de novembre, je repris la route. Mais j’abandonnai le rêve de révéler Bombard et je ne le regrette pas.[1]
Une première fois, déjà, je n’avais pas trahi. Quand, pressenti par un Bazin d’Alsace, un journaliste était venu me voir pour que je confirme le premier nom de mon vieil ami, j’avais refusé. Ce n’était pas que Jean Hervé avait été mon compagnon ; mais il écrivait de bons livres. Puis, il devenait, lui-même, un « prince », dont je savais les générosités (envers Massat, envers Cathelin). Que m’importait le jeu qui avait permis cela ?
De même, quand, au lendemain de la catastrophe d’Ethel, où l’on avait trop cru en la stabilité de l’Hérétique, un journaliste de Match vint me demander les éléments de mon enquête sur Bombard, je refusai de les lui donner ou de les lui vendre. Car, déjà, l’homme n’était plus ce qu’il avait été. Le désespoir le lavait, dont témoigne un suicide avorté de justesse. Depuis des années, à la télévision, à la radio, j’entends et je vois un homme sincère, lucide et brave, révélateur de bien des ombres et légendes, sinon de celle-là, qu’il ne veut pas éclaircir. S’il le faisait, à quoi ne pourrait-il prétendre ? Mais sa célébrité lui permet le courage, ce qui n’est pas rien : écouterait-on aussi attentivement le sage, sans cette part d’ombre que se réserve le héros ?
Passe pour Bazin, Sagan, Rochefort, Bombard — Charrière ! Ils n’ont fait de tort à personne (je suis convaincu que la catastrophe d’Ethel aurait eu lieu de même, que les voyages de Bombard fussent réels ou non). Y ont cru ceux qui voulaient bien y croire. Mais une grande erreur judiciaire ? Ne faut-il pas intervenir alors ?
J’en ai connu plusieurs : l’affaire Marguerite Marty, le capitaine Blanc de Carcassonne, Marie Besnard, Paule Guillou. La première s’est bien terminée : par un acquittement du jury ; les autres ont été dramatiques. J’ai vu donner des conclusions précises par des experts qui n’avaient pas examiné l’organe (les intestins ou le foie) de la prétendue victime, des juges d’instruction haineux ou intéressés, car le juge n’en est pas moins homme, des présidents de cour d’assises incapables de comprendre ce qu’ils lisaient et voyaient, pour cause de vieillesse, des enquêteurs nommés pour étouffer l’affaire. J’ai tout vu ; mais rien d’aussi parfait, dans le genre ignoble, que l’affaire Dominici.
Elle avait éclaté en août 1952, alors que je n’étais pas reporter. Mais, pendant toute l’année suivante, j’en avais reçu des échos. Puis, il y eut ce court voyage dans le Nord, où j’en appris bien plus que je n’aurais dû en savoir. En novembre 1953, libre de tout engagement et mon dernier roman achevé, je repris l’enquête à mon compte et me rendis moi-même à Lurs. L’enquête dura seize Jours. Quand je revins, j’avais résolu l’affaire. Je le dis au directeur de Carrefour, Amaury, qui me crut. Je le croyais également et j’en demeure persuadé.
On sait le drame. Drummond, sa femme et sa fille Lisbeth avaient été assassinés sur la Grande-Terre, à un kilomètre de Lurs, par un ou des inconnus. La Grande-Terre appartenait à la famille Dominici. A l’époque dont je parle, on accusait Gustave Dominici, l’un des fils, parce qu’il reconnaissait avoir, le lendemain du crime, vers cinq heures du matin, trouvé la petite Elisabeth encore vivante sur le sentier qui menait au pont. On s’étonnait beaucoup que les Drummond eussent choisi pour camper cet endroit, entre une voie ferrée et la route parcourue de jour comme de nuit, dans un pays sauvage, plein de retraits et d’asiles. On n’y comprenait rien, après un an. Mais, dans la version officielle, l’Anglais était une sorte de savant et de héros, ancien haut fonctionnaire du gouvernement britannique, chargé de la branche « parachutages » en 1944. Nul ne mettait en doute son intégrité. Or, j’avais appris dans le Nord que ce saint vivait du chant.
De collègues plus vieux que moi dans le métier, comme le grand reporter Salardenne, et par mes propres recherches au cours de mon année de reportages, j’avais pu vérifier que l’Anglais, en effet, passait toutes ses vacances, avec sa femme et sa fille, dans des régions (Hollande, Alsace) où de fortes sommes d’argent furent parachutées aux Centres de Résistance, entre les mois d’avril et de juillet 1944. Puis, il avait toujours très peu d’argent sur lui et, après le triple meurtre même, on n’avait retrouvé d’autre argent — dans les affaires d’Elisabeth — qu’un billet de cinq mille francs, bien que l’hypothèse du vol n’ait pas été retenue. Conclusion hasardée : Drummond comptait trouver sur place les subsides nécessaires à son séjour en France. Elle me semblait confirmée par la visite éclair de Scotland Yard, le lendemain du crime, à la police de Marseille. Consigne : bouche cousue.
A Digne j’appris, comme prévu, que plusieurs millions parachutés en juin 1944 n’avaient jamais été retrouvés, que plusieurs notabilités avaient effectivement acheté de nombreux terrains à la Libération et que certains de ces enrichis, en compagnie de Clovis, un fils Dominici rejeté par sa famille, avaient largement festoyé le lundi même du meurtre. A connaître ce gens, car je les visitai tous, je ne doutai plus de leur réaction si un maître chanteur était venu les trouver, huit ans après le parachutage, prétendument requis par son gouvernement pour recouvrer l’argent dilapidé ou découvrir ce qu’il était devenu.
Mon enquête me donna cinq certitudes. 1°) Le campement des Anglais ne s’était pas dressé sur la Grande-Terre, mais à un kilomètre de là, sur un petit pont qui séparait le mont de Lurs du mont de Gonagobie : des témoignages de chauffeurs de camion, tout au long de la nuit, confirmaient ce point, ainsi que le demi-témoignage du supérieur de Gonagobie, un brave abbé terrorisé par l’ampleur de la tragédie, mais lié, disait-il, par le secret de la confession. 2°) L’Anglais avait eu rendez-vous, à Digne, après une « corrida-bidon » qu’il dut quitter avant la fin, avec un messager chargé de lui donner rendez-vous, précisément, dans ce monastère, mais qui, l’attendant sur le chemin de Gonagobie, l’avait détourné de sa route pour l’amener à la maison où les meurtriers continuaient de boire. 3°) Ceux-ci étaient au nombre de sept (ou de six, je n’étais pas sûr du septième), enivrés à la fête pour se donner du courage. Ils avaient, par accident peut-être, blessé Drummond à la main avant de le tuer avec le même fusil ; mais l’Anglais n’était mort qu’une demi-heure plus tard, en même temps que sa femme, assassinée deux kilomètres plus loin (sur le pont de Gonagobie). 4°) La fillette, gardée en vie d’abord, n’avait été assommée que plus tard et transportée moribonde jusqu’au bas de la Grande-Terre, où le campement des Anglais était réinstallé tout au long de la nuit, selon un rythme que racontaient les passages des camions. 5°) La police paraissait avoir reçu quelque ordre de négliger tous les indices révélateurs : le silence du chien la veille au soir, le nombre des douilles retrouvées (qui ne correspondait pas au nombre des coups tirés), le sang de lapin répandu, le déplacement des corps, les contradictions sans nombre touchant la présence des Anglais sur la Grande-Terre la veille au soir, etc.
Malheureusement pour la police, Gustave Dominici (inquiété par un éboulement) était vraiment sorti de sa ferme très tôt le matin, alors que la mise en scène s’achevait. Il avait ainsi appris toute l’histoire et menaçait de dire la vérité s’il venait à passer en assises. Du coup, le « témoin noir » qui l’avait reconnu, disait-il, sur la route, au milieu de la nuit, n’était plus sûr de son témoignage et le tribunal correctionnel réglait provisoirement l’affaire en condamnant Gustave à deux mois de prison pour « défaut d’assistance à personne en danger ».
En ce mois de novembre 1953 où se situe mon enquête, on arrachait au vieux Dominici, Gaston, de bien étranges aveux, contredits par les faits[2] ; un an plus tard, on le condamnera à mort. Avec lui on ne risque rien : il ignore tout. Au procès, le président fera scandale en ne laissant même pas Gustave répondre au cri de son père : « Tu sais que je suis innocent ! Dis ce que tu sais ! » Mais, dépassé sans doute par l’énorme imposture, le président s’oubliera jusqu’à faire remarquer au « témoin noir » qu’il ne peut pas avoir pris pour ce vieillard de petite taille, le grand et fort Gustave. A quoi le témoin, sans se troubler, répondra, en plein tribunal, qu’il sert la police depuis trop longtemps pour craindre quelque représaille et que, d’ailleurs, il porte la Légion d’Honneur. Quant aux douilles insuffisantes, au chien silencieux, au rendez-vous de Digne, aux témoignages chauffeurs, au père bénédictin, aux millions disparus et au sang de lapin, etc., il est bien évident que personne n’en parlera (ni même de l’affolement des femmes Dominici, découvrant un campement et trois cadavres, là où la veille au soir il n’y avait rien eu).
Jean Giono publiera seulement son beau livre, où il démontrera que les vingt mots de français des paysans de la Durance ne leur permettent pas de se défendre devant un tribunal (ce qui est vrai) et l’on n’osera pas, tout de même, exécuter le vieux Dominici, coupable au regard de la loi de trois assassinats, dont celui d’une petite fille. La peine de mort sera commuée en prison à vie et le général de Gaulle graciera le vieil homme. Il s’en reviendra mourir chez lui, dans cette même ferme qui, vingt ans plus tard, devenue un restaurant fameux attire, me dit-on, les touristes. Mais le gouvernement de la Ve République ne remettra pas en question l’un des grands crimes de la IVe, car les Républiques changent — et les Empires — mais les impostures deviennent de l’Histoire.

Illustration Pierre-Jean Debenat
[1] Mon dernier travail de 1953 est une étude chiffrée sur les différences de vitesses du canot de Bombard. En Méditerranée, de Monaco au « naufrage » des Minorques : quelque 220 milles en 17 jours (du 25 mai au 11 juin), soit 12 milles par jour. De la rencontre de l’Arakaka (49°50) le 10 décembre à l’arrivée au large de la Barbade (58°20) le 22 décembre, 550 milles en 12 jours : 45 milles par jour. Un yacht parcourt ses 100 milles quotidiens ; mais, depuis son départ de las Palmas le 6 novembre jusqu’à son arrivée à la Barbade fin décembre, en même temps que Bombard, le Nymph Errant avait effectué un voyage beaucoup plus long, touchant deux fois à la Barbade et descendant jusqu’à Antigua entre-temps.
[2] Pour ne citer que ces deux contradictions : c’est en voyant lady Drummond se déshabiller que le vieux bonhomme aurait perdu la tête. Or, le cadavre de lady Drummond a été découvert vêtu. Puis, comment concilier le crime d’un sadique voyeur avec l’assassinat de la petite Elisabeth, trois ou quatre heures plus tard ? Mais ce sont tous les indices retenus et tous les témoignages admis qui présentent ce caractère d’invraisemblance.
Jean-Charles Pichon
________________________________________________________________
Il se posa longtemps la question de l’engagement et de ses limites. Voici un texte publié en 1947, dans le N° 46 des « Cahiers de Paris », qui avait pour thème la liberté.
Pour servir à une Apologie
de l’Engagement
I
Qu’importe qu’un homme, pendant toute sa vie, légitime son inaction et ses doutes par le mot : liberté, alors que la continuité de l’histoire suffira à ramener de telles prétentions à leur juste valeur, à dévoiler sous « l’objectivité » la paresse, sous la « clairvoyance » la lâcheté ?
Aucune erreur, aucun crime, n’est jugé si sévèrement par l’histoire que l’erreur et le crime de ne pas prendre parti. Un Auguste, un César, voire un Caligula ou un Saint-Dominique ont leurs détracteurs mais leurs partisans. Un Richelieu, un Talleyrand sont admirés et défendus pour le moins autant qu’ils sont honnis. Mais celui qui vit en dehors de son temps, qui refuse de choisir, l’histoire ne le condamne ni ne l’absout, parce qu’elle ne le connaît pas, que pour elle, il n’a pas eu d’existence.
Je m’arrête à cette objection qu’on ne peut manquer de me faire que, après tout, l’opinion de l’histoire n’importe en aucune façon, que l’homme libre l’est pour lui d’abord et non pas pour les « mercenaires » de l’avenir. Certes, et je l’entends bien ainsi. Mais veut-on me dire, alors, par quelle comparaison, quel barème ou quelles conséquences le fait de la liberté peut être déterminé et ses applications déduites ?
Si tout homme est libre qui se croit libre, nul ne l’est plus vraiment que le Fou qui n’imagine même pas d’autre liberté que la sienne. Et si l’on me dit que, tout au contraire, l’homme libre est celui qui connaît et juge toutes les conditions qui lui sont faites, dans tous les sens, (ce qui est mon sentiment), nous bien obligés d’admettre que, dans la mesure où cet homme est « normal », doué de raison et de sens critique, il doit être amené, tôt ou tard, à comparer ces diverses conditions, c’est-à-dire — enfin — à en choisir l’une plutôt que l’autre.
Si l’on m’objecte que, effectivement, telle devrait être l’attitude de l’homme parfait mais qu’un tel être n’existe pas et que, dans la majorité des cas, l’esprit placé entre diverses conditions possibles sera retenu de choisir entre elles, c’est-à-dire corrompu dans son sens critique, par telle hérédité, tel besoin plus ou moins inavouable, tels intérêts tout puissants, je serai de l’avis de mon objecteur mais lui demanderai de me consentir, en échange, qu’un tel esprit est tout sauf libre, qu’il l’est en tout cas bien moins que celui que ni l’hérédité, ni les besoins, ni les intérêts n’ont retenu de choisir.
II
Il apparaît que, contrairement aux dires de certains psychologues, la liberté n’est à aucun degré une affaire de pensée — pour la raison très simple qu’il n’y a pire esclave que l’esclave de son imagination, (je n’en veux pour preuve que l’imagination excessivement fertile des fous — et, dans une certaine mesure, des malades), mais qu’à l’inverse l’esclavage social, physique ou moral, ne s’explique et ne se justifie (par rapport à soi-même) que par cette « évasion du réel » qu’est la pensée.
Si une démonstration n’a pas besoin d’être longuement exposée, c’est bien celle-là. Puisque, aujourd’hui même, la psychanalyse n’a rien trouvé de mieux, pour libérer l’infirme moral de son complexe, que de chasser ce complexe de sa pensée la plus inconsciente et de le traduire en acte. De même que l’obsédé sexuel, s’il pouvait « penser en actes », sur le plan du réel, de son obsession il serait délivré, de même s’ils pouvaient « extérioriser » leurs imaginations, bon nombre de nos théoriciens de la gratuité seraient délivrés de leur esclavage.
L’homme qui « pense » sa liberté sans l’agir est comparable à la borne du chemin. Ou, du moins, il lui serait comparable s’il ne se trouvait pas, toujours, d’autres hommes pour extérioriser, en ses lieu et place, une pensée improductive et la faire servir à leurs fins propres. Je me souviens, en écrivant ces lignes, d’un des derniers articles du regretté L.-P. Fargue, dans lequel ce « théoricien de la gratuité » défendait pour le poète le droit de penser et d’écrire ce qui lui passait par la tête, sans se soucier des applications politiques ou sociales qui pouvaient en être tirées. La réponse lui parvenait dès la semaine suivante, sous la forme d’un article qui développait le sien aux fins politiques que l’on devine.
La liberté n’est pas une affaire de pensée. Et dire qu’elle est affaire d’action serait une proposition à peine suffisante. La vérité est qu’elle est affaire de création. Rien d’autre.
Affaire de création parce que la liberté ne peut s’atteindre hors de l’efficace. Mais ce concept d’efficacité recouvre celui de « Bien et de Mal » dans la mesure où tout être précisément n’envisage l’efficace qu’en opposition à son contraire et ne peut choisir sans exclure.
C’est par le biais de la Responsabilité ainsi, que le problème de la liberté rejoint celui de la Puissance puisque l’homme n’est libre par rapport à l’Objet que lorsqu’il a consenti à agir sur lui dans le sens d’une décision volontaire. Qui dit : liberté, alors, dit : maîtrise et, parce que nulle maîtrise n’est si complète que celle du créateur sur ses créatures, en dernier ressort : création.
Il serait temps que nos moralistes comprennent que la liberté n’est pas une réalité psychologique mais morale ; qu’elle implique le choix et non son refus ; et qu’elle suppose préalablement, dans quelque domaine que ce soit, un « impératif catégorique » faute de quoi, jeu de l’esprit, elle ne présente pas plus d’intérêt qu’une hache sans fil, un miroir sans tain, une roue sans essieu.
III
Il me fallait établir solidement ce point pour démontrer la vanité de ceux qui prétendent fuir la responsabilité dans le verbe. La solution de l’esthète n’en est pas une : s’il refuse de se croire responsable par ses écrits des crimes du monde, il en est au carrefour de Sartre ou de Malraux.
L’inconvénient du tain, de l’essieu ou du fil est que toute forme d’action aliène la liberté, soit en la mutilant, soit en la transformant, soit en la reproduisant (cette dernière aliénation n’étant pas la moins redoutable). Se connaître responsable, c’est rompre — puisque toute responsabilité, comme toute liberté, ne se définit que par ses limites. Seul sens dans lequel peut s’entendre sans dégoût l’axiome vulgaire : la liberté de chacun finit où celle des autres commence.
Cela est si vrai que, dès que l’homme se met à rêver d’une liberté universelle — entendez : sans limite — il tombe dans le démembrement et l’absurde ; le sentiment de responsabilité se transformant, dans cette réalité fluide, en sentiment de culpabilité, comme les feuilles du saule, dans l’eau, se voient à l’envers.
Imaginer se devoir à tous c’est ne plus se devoir à personne, c’est s’interdire toute action particulière, si libératrice qu’elle semble pouvoir être, parce qu’elle sera, dans une proportion égale, destructrice de liberté. Si donc personne n’est coupable (ne mérite d’être rejeté hors de la liberté), comme il faut à toute force une victime pour justifier le chaos — d’autant plus chaotique que je tends à l’universel — le coupable sera moi et coupable envers tous : envers l’ennemi d’être obligé de le combattre, envers l’ami d’être obligé de le trahir.
A n’avoir pas voulu choisir que gagnerai-je ? Sinon de multiplier par deux mes chances d’erreur ; ou, plutôt, là où il n’y avait pas d’erreur possible, d’en avoir mis partout ?
Cela est clair. On m’objectera cependant : « il n’y a pas lieu de poser la question sous cet angle. L’homme de Kafka ne prétend pas au gain. Il voit que le monde est mal fait et souffre de la fissure qu’il y constate. Sa clairvoyance seule est en cause. » Examinons.
— Il a découvert qu’il n’existe en soi que depuis qu’il s’est détaché de sa mère ? Que son éducation n’a été que d’habitudes désapprises ? Que, s’il choisit un amour, il lui faudra en sacrifier cent ? Qu’enfin, quelque acte qu’il accomplisse, il exclut en le faisant l’acte auquel il a renoncé ?
— Précisément. C’est là ce qui le désespère. Car il voudrait comprendre pourquoi il en est ainsi.
— Pourquoi il n’est pas, en même temps, sa mère et lui ? Pourquoi il n’est pas un mauvais garçon ensemble qu’un honnête homme ? Pourquoi sa fiancée, si elle est blonde, n’est pas brune ? Pourquoi s’il dit « oui », il ne dit pas « non » ? Apparemment, parce qu’il est différencié. Mais, s’il ne l’était pas, il ne serait pas et ne pourrait se poser de telles questions.
IV
Mais je n’ai pas la prétention d’en venir si promptement à bout. L’illusion de la culpabilité est de tous les temps, parce qu’elle est celle du Nombre : les pauvres hères qui travaillaient à la construction des Pyramides n’auraient pas accepté de laisser leurs os dans le désert, si des Prêtres n’avaient su l’entretenir en eux. Le danger de la métaphysique est le même que celui de l’universalité : la perte d’une conscience libre.
Parallèlement à ce courant générateur de mauvaise conscience s’établit nécessairement un courant contraire, « récupérateur d’énergie », où la mauvaise conscience elle-même aura son rôle (passif, donc d’autant mieux utilisable) : actuellement, la solution fasciste.
Entre ces deux positions, celle de se charger de « tous les péchés du monde », et celle de se prétendre de la race sans péché, le « vieux républicain » — dernière métamorphose de l’humaniste — va de l’une à l’autre d’un mouvement incessant. Il se scandalise : non seulement le fanatique est de mauvaise foi mais encore il a toujours raison ! Il ne comprend pas qu’il n’a raison que parce qu’il est de mauvaise foi et que le fait d’avoir ouvert le monde en deux — de s’être donné une probabilité de croyance de moitié, la plus grande possible — est le secret de sa force. Ou plutôt, il comprend vaguement que cet imaginaire « Nous » recrée la responsabilité par le truchement du « solidaire ». Il sait que cette limite donnée à l’imaginaire est d’une telle nécessité que pas un fondateur, pas un parti, pas une philosophie n’y a jusqu’ici passé outre ; que le « Nous » exige le « Non-Nous » comme l’être la non-substance. Mais aussi cette évidence est le mal constant de l’homme « de bonne volonté ». Son purgatoire et son calvaire. Il lui semble qu’en vieillissant les doctrines perdent leurs ongles et leurs dents et il s’attache aux principes moribonds sans voir que cet assagissement est le signe de leur décrépitude.
De même que le cadavre se dissout en poussière, de même, en effet, les vieilles lois. Seule définition valable de l’existence : différenciation. L’étude de la liberté, ramenée à celles de la responsabilité, puis de la solidarité, se résout enfin en l’étude des limites de l’efficace.
Jean-Charles Pichon (Vers 1950)

Illustration Pierre-Jean Debenat