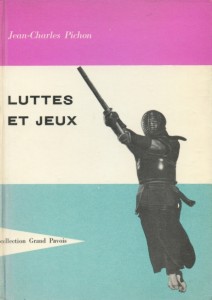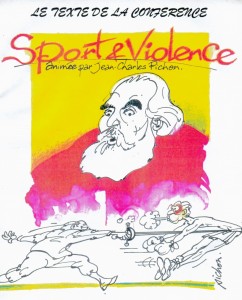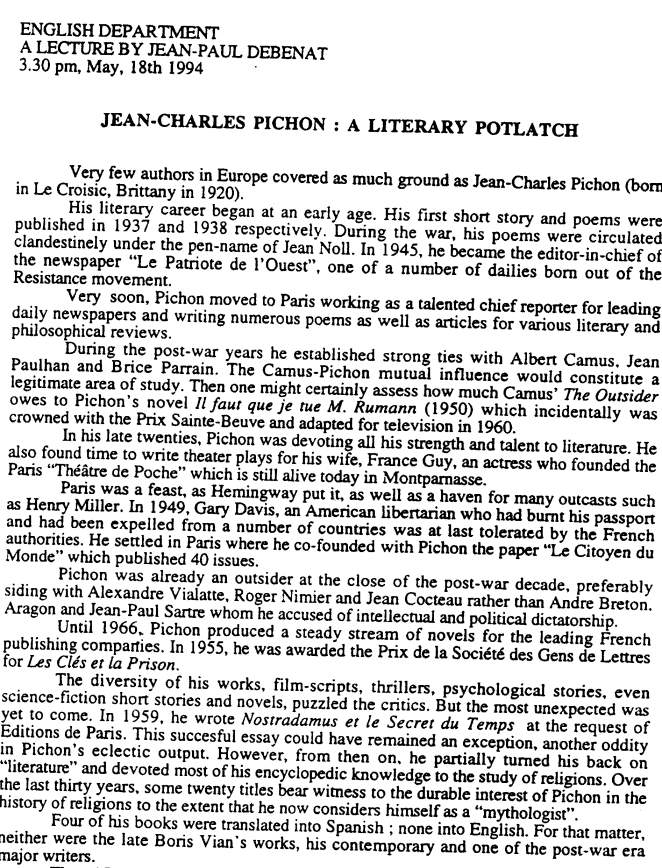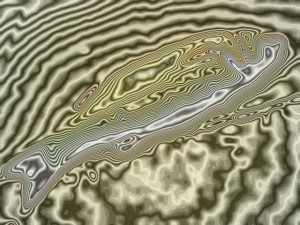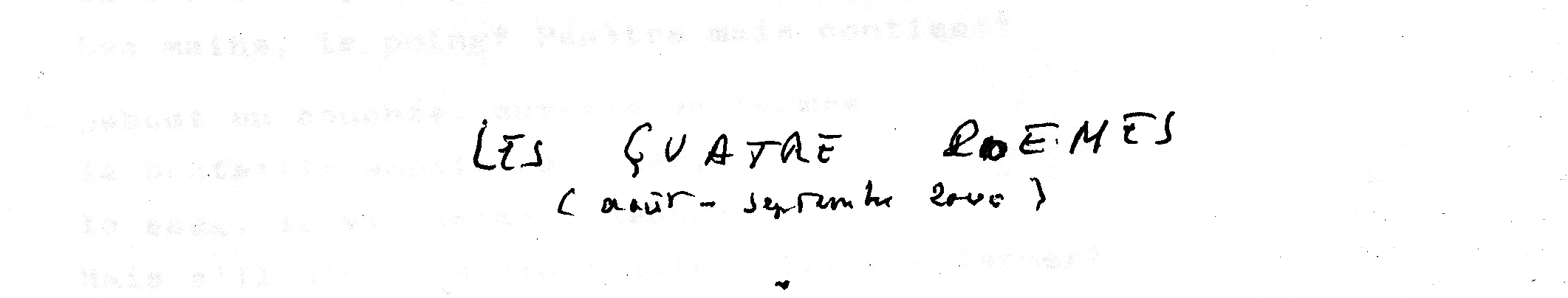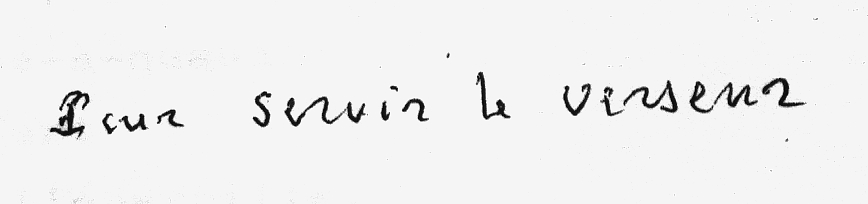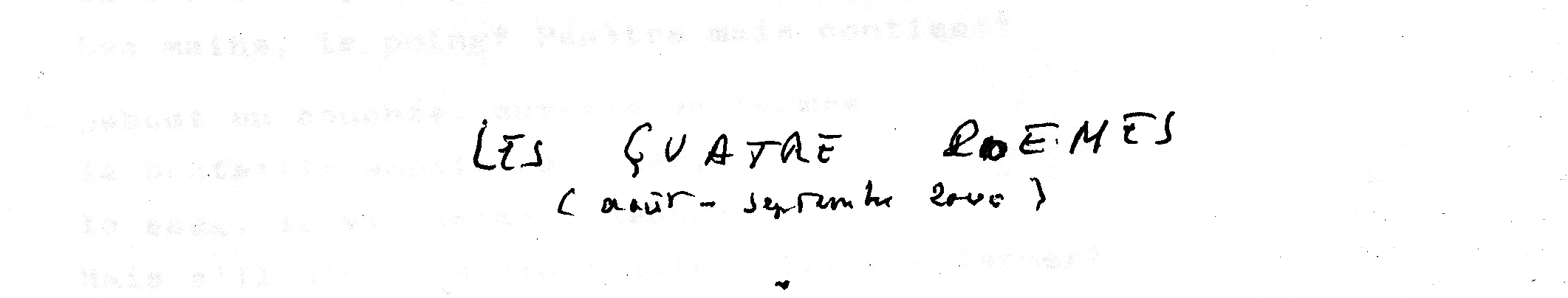
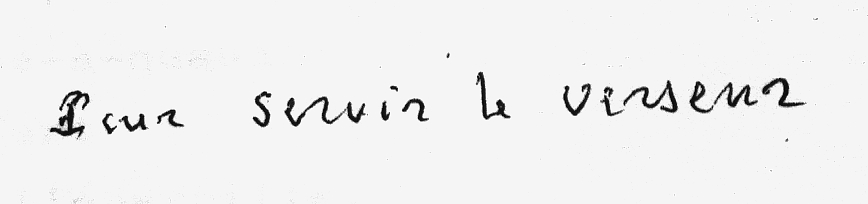
OU BIEN… OU BIEN…
1- Hasardeux nécessaire ambigu le poème
ne sera pas donné sans que le soit tout être
sans que dans l’œuf renaissent
les germes du Verseau.
2- Ils se dénombrent deux. Mais où sont-ils ?
Dedans dehors. Comment ?
Par ouverture ou fermeture. En quelle
figure courbe ou droite ?
3- Mais que sont-ils ? A deviner. Garçon ou fille.
Qu’est-ce qui s’ouvre et se ferme ?
La bouteille, la porte. Unit et désunit ?
Les mains, le poing ? Pénètre mais contient ?
4- Debout ou couchée, ouverte ou fermée
la bouteille emplie ou vidée,
le sang, le vin dedans, dehors.
Mais s’il n’est qu’un seuil qu’ouvrir ? Que fermer ?
5- De porte la poignée a pour fonction l’imposte.
De sabre ou de poignard elle assure la prise
pour manipuler l’arme et resserre les doigts
qui vont miser de grains, d’écus le manipule.
6- Objet ou sujet, mutante
de la queue à la tête et dans le tête-à-queue
la chose frémit. Mais dans le transfert
le Trou Noir la condense et le Bang l’éparpille.

Illustration Pierre-Jean Debenat
7- Chacun des trois dès lors danse un autre quadrille.
Dedans dehors le plein le vide.
Unis ou désunis par la prise ou la mise.
Une flèche dans l’arc, le pénis au vagin
8- horizontale, verticale, oblique aiguille.
Mais horloge un manège ou boussole cet arbre
dans la foire ou dans la forêt qui se proposent,
Loterie ou zodiaque à terme disposé.
9- Par la permanente inversion des lettres
qui sans cesse défait et refait l’univers
de l’unité sans faille au zéro sans repère
et que sans fin je clique interné en ce Net.
11 août 2000
LE JARDIN ET L’ELEPHANT
Pour Geneviève

Illustration Pierre-Jean Debenat
1
Pour l’aveugle affolé le monstre est indistinct,
vaguement circulaire, un serpent, une enceinte,
pour le savant aveugle un cube symétrique.
Mais l’animal se fait infirme au terme
puis un tas d’os quand le quadrilatère
révèle une constante en son désossement.
Lequel est plus réel, du concret, de l’abstrait?
Aucun des deux sans doute ou c’est désespérant:
la chair vit pour mourir, le nombre pour renaître
autrement, indéfiniment
2
L’éléphant va paisible entre les cardinaux,
s’inscrivent au jardin l’année et ses saisons.
Dressé l’animal, couché le parterre,
mais courbe le cycle et droit le massif
ornement de tous les zoos
(que formule de fleurs et de buissons l’artiste,
sinon le blasonneur expert en floraisons).
Quel cycle contiendra la vie de l’éléphant?
On aura dit l’enfance et la jeunesse,
l’adultération, le vieillissement:
au lieu des saisons les quatre âges.
3
Le jardin nous en dit bien plus que l’éléphant,
quoique il puisse de même être carré ou cercle,
que la pousse des fleurs et leur effeuillement
y soient une autre vie et comme en d’autres âges
le rythme assuré des mois.
L’hiver s’y fait trou noir aux germes innombrables
quand le vieillard persiste en son big bang.
Le désert de l’été que peuplent les mirages
semble ne rien devoir au trop-plein de l’enfant.
Dois-je dire un Noël naissance
et le Quinze Août Assomption?
De l’éléphant le parc n’est-il que ce contraire?
4
D’où renaît le jardin? Du pollen que l’abeille
et la brise ont porté de ca de là?
Ou de la mutation chronique
qui de l’hiver, trou noir, fait l’été, ce trou blanc
et de la forme éparse, illusoire, un foetus?
De mille façons ou des douze au moins
l’humanité s’efforce à traiter un problème
dont elle dit traiter.
Longtemps je t’ai ouverte, aimée avec mon sexe,
puis jugée au hasard, cent fois meillleure
que celui qui osait te préjuger,
semblable à moi dans la fraternité du couple,
me contenant ou contenue au gré des heures,
dominante et servante en la splendeur
de l’heure exquise, vierge ou balancier selon,
ma retraite et l’élan à jamais relancé
vers la cible sans nom qui bornait nos regards,
mais toujours une terre ou gaste ou fructifiante
en tes jardins floraux et potagers
ou concise aux balcons des chambres passagères.
Amour, justice, farce ou symétrie,
n’importe quoi en fait – qu’importe?
Car les mots que je donne à nos dialogues
ne sont que pour unir l’éléphant au jardin,
l’éléphant que je suis au monde que tu ornes,
dans l’au-delà du coeur qui nous libère encore,
l’univers inversé, l’inévitable union.
Le 4 septembre 2000 (ton anniversaire)

Illustration Pierre-Jean Debenat
L’UNIVERS DU VERSEAU
(36 dialectiques en 11 points)
I LA BOUTEILLE
1- Je dirai l’univers inversé une amphore
2- pleine ou vide toujours en soi-même autrement :
pleine, de vin, de sang dont je m’abreuve,
vide le vaste espace où le jet se répand.
3- Non plus ceci et ça ou çà et là,
mais là, dehors, dedans, et la sève épandue
toujours ailleurs entre les univers.
II LA PORTE ET LA POIGNEE
4- Ferme, close et debout la bouteille ou la porte;
couché, ouvert, l’hôte parti,
le flacon ou le seuil à nouveau désertés.
5- Une porte ou bien sa poignée ?
Disjointe et béante ouvrant le passage,
Impasse fermée elle réunit.
6- En l’autre mêmement, imposte ou manipule.
Prise de l’épée ou des mains poignée,
mise en garde ou mise à l’écart
le manipule de soldats ou d’herbes rares,
d’écus, d’objets sacrés l’autre poignée.
7- Droite ou circulaire : autrement.
Mais où le domaine et quand l’instrument ?
III LE CADRAN ET L’AIGUILLE

Illustration Pierre-Jean Debenat
8- Dans l’arbre, le manège et le drapeau
le vertical est droit, courbe l’horizontal.
Mais dans la loterie et le zodiaque,
l’horloge et la boussole
l’aiguille et le cadran seront horizontaux.
9- Ni le reflet dans le miroir
ni le mirage par la vitre
ne seront dits réalité
au cadre dépourvu d’aiguille.
10- A tous les duos épuisés
se substitue une autre paire :
du Même la trousse et son inventaire,
vers d’autres cieux tournure et trublion.

Illustration Pierre-Jean Debenat
IV LE JARDIN ET LA BETE
11- Assujettis aux mois et aux âges, qu’importe ?
la Bête se résume à l’entrée, aux sorties
quand l’hiver et l’été m’offrent d’autres jardins.
12- Dois-je aller mon chemin sans chercher à comprendre
ou me nourrir et me vider comme un tonneau ?
Questionner à tout va ou remettre en question
à toute heure le fruit éphémère des sciences ?
13- Je dois sans plus me faire attentif au silence
et dire seulement ce que j’ignore encore
de la divine Alliance.
Le 11 septembre 2000
Sans rire ni raison
(Le poème de l’enfant)
– Dis-moi pourquoi je suis ici le jour
et autre part la nuit?
Pourquoi mon veston il a des boutons
et mon blouson l’éclair?
Pourquoi il neige sur la ville?
Pourquoi la queue du chien est noire
et blanche la queue de la dame
qui sourit au mur du salon?
Pourquoi l’aiguille fait tout le tour de l’horloge
et tremble seulement dans ta boussole?
Pourquoi je dois fermer la porte à clé?
Pour que maman elle entre pas?
Pourquoi je me vois dans la glace
et des tombeaux par la vitre?
Pourquoi tu dois le soir vider le litre
que tu vas remplir le matin?
– Vois-tu, fils, ce litron est peut-être mon âme,
il n’est pas ton habit, ni le rêve l’éveil
ni l’autre part ici, ni la vie dans la mort
ni la mort dans la vie.
Mais ne demande pas pourquoi car, entre nous,
je l’ignore encore.
– Moi, je le sais.
Pour que demain je te questionne encore
et joue encore au jeu de Monsieur Je-sais-tout.
18 septembre 2000

Illustration Pierre-Jean Debenat
L’ABSURDE RAISONNÉ
(de la question au jeu de mots)
1- L’acte et le dit.
Constant et peut-être éternel, le dilemme pour JE est de ne pas trahir le dit par l’acte (une manipulation) et de ne pas déformer l’acte par le dit (une imposture).
2- Le mouvement et la position.
L’un des problèmes (scientistes) de notre époque est celui que posent le mouvement (ses quantités) et la position (sa probabilité). Qui dit mouvement dit sens, qui dit position dit localisation.
3- Les sens disent des actes : des prises : chasser la proie, ou des mises (en lumière, à l’écart) – chasser l’intrus. Une occupation ou une opération.
Les lieux disent les positions : contenant/contenu, dehors/dedans. Comment dire les sens en croyant dire les lieux, ou à l’inverse ? Par la poignée (sa prise) et l’habit (une mise).
4- Leurs sens (sémantiques).
La poignée : qui prend ?
Tu serres la poignée de la porte ou de l’épée.
La poignée serre les mains ou ton trésor.
La mise, en condition ou valeur,
L’habit dit l’habitude et le recouvrement, la coutume ou le costume ?
La poigne et l’habit contiennent et maintiennent.
Mais qu’est-ce qui, hors d’eux, libère et change ? L’inversion des sens de la poigne ou de l’habit, plutôt que l’inversion de la poigne à l’habit, de la mise à la prise.
5- Du contenant au contenu la poigne, du dedans au dehors l’habit. Comme le disait déjà la divine bouteille – pleine ou vide.
6- JE ne peut plus dire le Dit et l’Acte sans dire le maintien et le change. Le discours et le dialogue, le maintien et le change dans le traitement et l’entretien (transitifs ou intransitifs). Le jeu de mots sur traitement/entretien conclut le dilemme sur le dit et l’acte, mais ce n’est pas sans le dédoubler, par les 2 dialectiques internes.
7- Non moins abstraits que la position et le mouvement, d’autres dilemmes : l’espace et le temps, la raison et la foi exigeront d’autres objets : la bête et le jardin, le bouton et l’éclair. Mais ce ne sera pas sans traiter de la bouteille ou la traiter, entretenir ou m’entretenir de l’ouverture, de la fermeture du flacon, de la porte ou de l’habit. Car, là encore, c’est le dilemme interne qui fait le maintien ou le change. Comme dans les questions et les jeux. Ou, entre deux, les 4 poèmes.
Car l’espace et le temps, la question et le jeu, la raison et la foi – et sans doute tout autre dialectique conceptuelle – ne s’inversent d’un terme à l’autre sans se détruire ou provoquer quelque ravage. Mais ils s’inverseront en soi aisément et continûment, sans drame, par le double sens des mots, leur double usage ou l’emplacement des lettres. L’espace par l’étendue et l’intervalle; le temps par le cycle et la direction.
Le jeu par ses instruments et ses phases; la question par ses aspects : quoi ? Comment ? Où ? et par les 2 sens de Pourquoi ? – depuis la cause ou depuis les fins. La raison et la foi, par l’exercice et l’exemple : la religion du modèle divin à l’exercice « spirituel », la science de l’expérience concrète à l’imaginaire isotope.
Les poèmes ne disent rien d’autre, par leurs dialectiques internes, particulières, d’une part; par les sens de « parti » (qu’on prend ou disparu) et de « partie » (d’un tout, à jouer), d’une autre part.
C’est toujours le partiel, le personnel, l’intérieur, le contenu qui fait le change et le maintien, qui œuvre, jamais le général, la diversité, l’extérieur, le contenant. Dieu a besoin de JE, son contenu, à cause de cela, si Dieu est le contenant que la foi imagine. Mais si JE contient Dieu, le nomme, le nombre ou le figure, ainsi que la raison le prétend, c’est le dieu contenu qui, par sa croyance, maintient et change l’univers.
L’homme de foi est acteur, l’homme de raison agi.
Les 4 et les 3
JE peut donc dire qu’une dialectique générale quelconque se positionne entre les termes de deux autres. Comme la foi et la raison entre les questions et les jeux; ou le paradoxe position/mouvement entre étendue et intervalle, aller de la direction et retour du cycle; ou la vie et la mort, la présence et l’absence entre l’incertitude (hypothétique) et l’affirmation catégorique des donnes. Etc.
Car les Droits ne sont horizontaux ou verticaux entre les 4 cardinaux de la croix, sans être diagonaux dans le triangle rectangle isocèle, au 1/8 du carré. Horizontaux et verticaux comme rayons d’un cercle, diagonaux comme rayons d’un autre cercle. Le 1er est inscrit dans le carré; le 2ème le circonscrit. Etc.
Selon que JE invente les dieux (parmi lesquels l’Inverseur) ou que l’Esprit verseur utilise ses serviteurs au maintien et au change de l’univers.
Le jeu est-il toujours possible ? Comment ?
Ne l’est-il pas ? Pourquoi ?
Les 3 en 2
Tantôt, 2 mots étant donnés, contradictoires, ils comporteront chacun les 3 acceptions. Tels, « relation » entre les propositions, « passage » dans le mouvement.
Relation dit un récit ou un rapport, nominé ou nombré;
Ensemblier dans un système, le mot dit l’équivalence ou l’ordre; systématique dans un ensemble, il dit le dehors ou le dedans (de quelque système dans l’ensemble);
Au terme, le mot dit un relais (l’union) ou la relaxe (la désunion).
Passage dit le carrefour : un passage à niveau, ou le combat : un passage à tabac. S’il dit l’opposition entre les passagers. Mais, s’il se fait lui-même passager, il dira le peuplement dans la position : une rue passagère – ou une vitesse en mouvement : un vol passager.
Borné à son acte : passer, le verbe dira le don, l’ajout : je te passe le ballon, ou le retrait : je passe mon tour, je te passe tes travers.
En jouant de « passant », je dirai celui qui passe ou cela par quoi on passe quelque chose, le passant du pantalon. La passe dira un orifice (une serrure ou un moment d’amour payé) ou le passe, la clé.
On remarquera qu’alors, la dialectique première s’est dédoublée en 4.
La relation joue entre des « articles » : masculin/féminin, abstrait ou concret, à faire (dans la bricole ou la brocante).
Le passage exige des axes : l’accès (la crise ou l’accession), l’accueil ou son refus de l’hôte reçu ou recevant, l’accent mis sur l’accès ou sur l’accueil. Nous serons passés ou nous aurons relationné par d’autres comptes : les 4 dans les 3.
De la même manière, lorsque je dis les 3 préfixes hors du mot : PRE, ce qui fut avant, PRI, ce qui domine, PRO vers l’avenir, il me reste à dire l’élection du Président, l’héritage du Prince, la technicité du Pro (fessionnel) – leurs 3 primautés.
Puis, aux Préfixes ou Primautés, je ne puis m’empêcher d’adjoindre quelque Pro généralisé, comme en promesse, projection, projet.
Ici encore, la dialectique première s’est faite quadrilogie : le dehors, le dedans, le plus (opposé au moins) – ou le plus et le moins, l’avant, l’après. Sinon, bien sûr, l’avant, l’après, la réussite, l’échec. Les 4 se feront 6, 12 ou 8, 16 aisément.
Mais la quête d’une synthèse entre le vocable et le nombre n’aboutira jamais qu’à une multitude de figures, dans le champ de la probabilité.
Soit, en jouant des figures (contenue, contenante, horizontale, verticale) :
A B
contenant contenu droit courbe
C
vertical ou debout horizontal ou couché
ou à l’inverse, car l’oblique peut jouer des 2 sens.
Ou bien, jouant des dialectiques internes :
a (droit) b (courbe) a (contenant, -) b (contenu, +)
c c
(l’hypoténuse, le rayon (la moyenne ou le seuil
dans le triangle ou le cercle) entre les extrêmes)
N=n+1 2n=N+1
Même si la « matrice » de Mandeleief joue de 2n², elle ne donne que des isotopes fictifs, très vite démentis par la réalité. Parce que l’expérience dément qu’on puisse porter l’exercice jusqu’à l’exemple réel à l’infini. Le système à l’ensemble.
Même si « l’exercice spirituel » d’Ignace de Loyola prétend introduire le mouvement dans le modèle ou l’exemple sacré, par le fractionnement de N par n, l’invention d’Ignace ne peut que réduire le réel au dogme, enrichi du catéchisme, du séminaire, du rite adjoint, etc. – jusqu’à la négation de la croyance, de la foi première. Car le support de la foi est l’exemple divin, le Modèle, inaccessible, non pas un exercice, quel qu’il soit.
A partir de 2 dialectiques données (4, si j’en fais le produit : 2X2 ou la somme 2+2), je ne peux qu’hasardeusement remonter à la dialectique première ou autre – ou mensongèrement, lorsque le plus grand nombre (la foule) y croit : cela ne dure jamais longtemps : le temps d’un spectacle admis. Et cela quels que soient les relations entre les articles ou les passages par les axes.
Mais JE peut jouer des 4 Parts (le parti à prendre, le parti qui n’est plus là, la partie du tout, la partie à jouer). Ou des 4 Coups : le coup et les coupezs, le cours et le coût. Pourrai-je jouer des 2 sans projeter un joint entre eux – par le JE contre l’autre, le projet à l’encontre de la cause, le genre, le génie (ou le gène), autres que les espèces ou aspects ? Afin d’instituer les 4 dans les 3 : les Parts, les Cou (p ou t)s et les Joints ? Comment puis-je dire les 2 et ses multiples en 3 ? Evidemment par un calcul tout autre. Plus étrangement, ce sera par des figures, des nombres et des vocables tout autres. Non plus par le dit et l’acte, la position et le mouvement, le moins et le plus, mais par le Même et l’Autre.
Voyons.
Les 4 dans les 3
Je n’en ai guère donné qu’un exemple, ludique et contingent plutôt que démonstratif et convainquant : les 2 tableaux (tavelle, tapon) et les 2 tablatures : l’étable et l’établi d’une part, les 3 Tables de l’autre : des lois, de couleur et ronde. Car les grands machinistes ne s’ hasardent pas, alors que le jeu des 3 dans les 4 les acharne : les 3 tribus en chacun des 4 cardinaux depuis Moïse jusqu’à Ezéchiel, ou les 3 arts dans les 4 sciences Boèce, sinon les jeux complexes des 4 dans les 7 (l’Apocalypse) ou des 4 dans les 10 : les Ages grecs et les Yuga.
Contingent, hasardeux, ludique, le calcul des 4 dans les 3 doit être dit aussi paradoxal. Parti de lui en 1944, par quelque juvénile ardeur, je n’y reviens qu’aujourd’hui, jouant des Paradoxes.
En 1944, les 4 étaient : l’expansion/la condensation, la condition/la libération. Les 3 nombraient les Personnes, les Lieux et les Vertus :
1ère : Je-moi, l’entendement, le Vrai;
2ème : Je-toi, la passion, le Bien;
3ème : Je-lui, la sensation, le Beau ou l’Harmonie.
En chacun des 3 lieux, les flèches conditionnelles (expansion/condensation) se font libératoires (condensatrices ou expansives tout autrement).

- Illustration Pierre-Jean Debenat
6 facultés reliaient les lieux et constituaient l’appareillage, que j’ai nommé depuis facultant ou facultatif. Vers 1988/89, reprenant la machine ancienne, je lui ai opposé les « factrices », que m’avaient découvertes vingt études sur les machinistes passés et présents. Puis, il me fallut encore 5 ou 6 ans pour concevoir que la 3ème sorte de machines, « sacrées », tentait seulement d’unir ou d’associer les deux premières : le « Livre de l’homme qui a vu », le Pentateuque, l’Apocalypse, le Coran.
Or, les 3 types de machines comportent une part de paradoxe (lié aux « parts » et au « para » : à côté, similaire, protecteur ou hostile).
Mais il m’aura fallu encore ces deux années (juillet 98/juillet 2000) avant de nombrer précisément les paradoxes et de les nombrer 4, comme les « parts » et les « para ».
a) le 1er paradoxe. Il en contient 3 qui englobent les 4.
– JE ne peut aller que du contenant au contenu, jamais du contenu au contenant (où le contenu est déjà);
– le contenu excède toujours le contenant, par la condensation, la densité, les jeux de la somme et du produit, etc;
– JE ne peut donc aller que du moins au plus : la grande loi progressiste et rationnelle.
Les 4 dialectiques sont :
– le contenu et le contenant,
– le dehors, le dedans,
– le vide ou le plein
– le plus et le moins.
b) le 2ème paradoxe.
Il semble ne jouer que de 2 dialectiques : de position ou de mouvement.
– Relationnel entre des positions, il dit l’union et la désunion.
– Dynamique, il formule le passage ou l’impasse.
– Mais, la jonction dit à la fois l’union et l’impasse; la disjonction, ensemble le passage et la désunion. D’où la 3ème dialectique : ouverture/fermeture.
Devenu une loi rationnelle, le 4ème paradoxe est nommé loi de polarité. Il s’énonce : l’opposition entre 2 pôles unit les corps; leur similitude les sépare.
L’union et la désunion, le passage et l’impasse, l’ouverture et la fermeture, le +n et le – polaires ou polarisés me redonnent les 4 dialectiques dans les 3 : position, mouvement, polarité.
La similitude fait la disjonction, la contradiction l’union.
L’union fait l’impasse, la désunion le passage.
c) Les 3ème, 4ème, 5ème paradoxes. A l’infini ?
Dès 1954, un 3ème paradoxe (le 1er pour moi) m’avait été révélé par l’observation de la terrine de pâté dans le four.
Logiquement, jouant des autres ou des choses discontinues, le contenu est dans le contenant.
Mais, dans la chose même (la terrine ici), la face contenue dans le four englobe la face contenante du pâté. L’objet contenu englobe l’objet contenant.
Le paradoxe ici se démontre à l’infini. Le JE contenu dans un espace ou dans un temps, une étendue ou une durée, mon CORPS, englobe évidemment le JE contenant de son entendement, de sa passion, de ses sensations (par les sens sensitifs) et, notamment, de toute appréhension (saisie ou peur) qu’il se fait de l’univers.
Contenu le système solaire dans la Voie Lactée englobe évidemment le même système contenant de ses planètes et de son astre. La chambre contenue dans la maison est plus vaste que ce que mon regard perçoit : la partie de la chambre contenante du lit et d’un fauteuil, d’une commode et d’un pouf ou de mon bureau, des livres et des papiers, etc.
Mais il n’est pas de loi rationnelle pour dire le paradoxe de la terrine car toute raison se volatilise ici. Le paranoïaque aussi croit qu’il contient le monde – et tous les déments officiels, généraux, juges, professeurs, présidents. Et de même l’amant (comblé ou rejeté), le savant imbu de son système. Dirai-je ces JE rationnels ? Ils le prétendent, c’est la preuve de leur folie.
Depuis 1 ou 2
Car une raison digne de ce nom constate seulement l’évidence la plus claire du monde.
Si JE part d’une dialectique, il peut toujours tirer 2 dialectiques de ses 2 termes. En toute certitude, il dispose de ces 3 : A, B, C :
A
b c
B C
1 2 3 4
Les 4 (1, 2, 3, 4) sont contenus dans les 3 (A, B, C) et même dans l’unique : A.
Mais, si JE part de 2 dialectiques : A et B, il ne peut qu’accidentellement, au terme d’un nombre presque infini de probabilités, trouver la dialectique C, unifiante, restauratrice. Une vie semblable à l’humain, à l’animal, à la plante peut avoir été ou naître demain sur Mars : elle n’est sûrement pas aujourd’hui. Une vie semblable à celle de la matière (en sa dispersion entropique) peut exister parmi les milliards de planètes et d’astres épars dans notre galaxie; et peut-être un autre mortel dans les milliards de milliards de corps qu’on suppose à l’ensemble des galaxies. Si une étincelle ou une goutte de pluie porte en elle le germe d’un autre univers, ce doit être au terme de quel Big Bang ? Du 2 et de ses multiples JE ne peut tirer – à jamais – que la probabilité la plus infime, ainsi que Pascal l’a compris.

- Illustration Pierre-Jean Debenat
Que deviennent alors le 3 et le 4 ? Ils subsistent encore, en leurs relations ou par leurs passages de l’un à l’autre. Comme des personnes aux cardinaux (concrets les 3, abstraits les 4), ou comme des paradoxes, des parts ou des paras aux machines (de l’abstrait au concret).
Comme dans le plus logique et ludique des tableaux, dans le schème alterné des 4 verticaux et des 3 horizontaux. Mais pourquoi ne serait-ce pas à l’inverse ? De quelle importance, en fait ?
Le plein ou le vide réalisés, JE oublie la Bouteille : il ses désespère de l’un ou de l’autre – ou tend vers l’un ou l’autre (par l’appropriation de la raison ou par l’appropriement de la foi).
La position et le mouvement nommés, il oublie portes et poignées;
l’horloge ou la boussole créées, le cadran et l’aiguille;
le couple survivant, la Bête et le Jardin;
le dialogue permis (entre le père et le fils), la fermeture-éclair et le bouton qui ouvrent et ferment l’habit. L’absente elle-même n’apparaît plus qu’en filigrane, comme l’Etre dans la bête et le jardin, l’Ille dans la quille et la bille, un dieu dans le plein et le vide, le dieu de la bouteille (Dieu) dans le vide et le plein.
LE QUATUOR DOXAL DES POEMES
Les questions Les titres et les donnes Les parts et
et l’enjeu (verbales) la partie
Pourquoi 1 : Ou bien… Ou bien… hypothétique : quel
dans quel but ? parti prendre ?
Qui ? Quand? Le poème d’anniversaire la partie à jouer
Quoi ? Où ? Le tour du Verseau les parties du tout
(les présences)
Pourquoi 2 : Sans rime ni raison La partie ailleurs
(qu’en sera-t-il ?) (l’absence) catégorique négatif
Les 6 en 4 Les 9 en chacun des 4 : Les 24 et les 36 :
4 X 6 = 24 9 X 4 = 36 24 + 36 = 60
4 + 6 = 10 9 + 4 = 13 24 X 36 = 864
Ici et maintenant, les 3 phases du Jeu sont horizontales, qui peuvent être les 3 aspects : figures, vocables, nombres, les 3 sens : sensoriels, sémantiques, directionnels, et les 3 lieux ou milieux : moyeu, moyenne, entour. Mais aussi bien les 3 personnes, les 3 vertus de Platon ou les 3 arts de Boèce : grammatical le Je-moi, dialectique le Je-toi, rhétorique le Je-lui.
Les 4 plans de questions, les ‘ parts et les 4 poèmes, verticalement, disent tout autre chose, que JE formule aussi bien par les 4 éléments, cardinaux, opérations de l’alchimie, instruments de la quête.
Ou les 3 par les Tables : des Lois, la Ronde ou des couleurs,
les 4 par les 2 tableaux (tavelle, tampon), l’étable et l’établi.
Les 3 seront, sont, furent universels et éternels, mais inversibles – par le pendule et le pendant;
les 4 sont éphémères et limités en leurs systèmes, mais JE peut toujours les positionner, dans une direction ou l’autre de la roulette, car ils ne sont jamais, les 4, ni tous concrets ni tous abstraits, ni tous actuels ou virtuels… Partout et toujours l’un des 4 au moins sera abstrait ou virtuel – absent dans l’espace ou le temps, dans le jardin ou la bête, dans le boutonnage ou dans la fermeture-éclair.
Le plus souvent, 2 des 4 ne seront pas ici et maintenant.
Le seul avantage des 4 poèmes est leur simultanéité (fictive ou contingente, tout hasardeuse). Ou dans la pendule, cependant – par la rotation du cercle, dans l’illusion que je puis saisir le courbe, la spirale, le cercle sans avoir dit le droit, l’hypoténuse et le rayon, sans avoir dit la triangulation de l’Etre. Dire, inventer, établir les 4 verticaux dans le mépris des 3 horizontaux. Jouer des choses qui s’offrent ou non, dans le rejet, l’oubli ou l’ignorance des aspects de la chose ou de mes 3 personnes. Une erreur fatale ou inévitable puisque le schème ci-dessus (les 4 et les 3) ne traite pas de leur somme : 7 et de leur produit : 12.
Aux 4 poèmes dialectiques la mémoire du Je-humanité et sa projection la plus aventurée ne peut qu’adjoindre un 5ème (conceptuel, imaginaire) que je dis de l’espace et du temps et délirer dans le 6ème, jusqu’au dérisoire du bouton et de l’éclair. La saisie rationnelle du 7 lui demeure interdite, hors des Livres Sacrés : les 7 jours de Moïse, les 7 églises de l’Apocalypse – a fortiori celle des 12, hors du panthéisme zodiacal, qu’aucun rationaliste ne peut admettre. Car une direction y dément l’autre ou tel aspect, d’opposition, un autre aspect de conjonction, ou la position des signes, des dieux, leur mouvement éternel.
JE devrait savoir questionner, mais c’est ce que l’homme de foi, dogmatisé refuse. Il devrait pouvoir jouer, mais c’est cela dont le scientiste s’indigne. Le dogmatique prétend la question hérétique, maudite. Le systématique prétend le jeu indigne de lui, contingent, dérisoire. Le premier réfute l’appellation « tyran » que le dogme impose. Le second hait l’appellation « clown » dont le système l’orne. Le premier tue le questionneur et le second le joueur – pour la même raison : le refus de l’Autre, le plus secret, caché en leurs entrailles, car, au départ, l’homme de raison a questionné, l’homme de foi a joué – mais, à l’inverse, l’homme de foi questionne éperdument, l’homme de raison joue – de quelques mots, nombres ou figures : c’est cela même dont ils haïssent le souvenir, l’ayant proscrit. Car le dogmatique assure que son dogme répond à toutes les questions; et le scientiste que son système est trop sérieux pour être un jeu. Ils refusent tous deux l’Inversion – l’univers même du Verseur.
L’identification du réel et de la chose leur est devenue partout et toujours impossible. Sinon ici et maintenant, dans le relief d’humain (vestige/remblais) qui demeure en chacun d’eux. Toujours et partout, le Doute. « Et si JE était libre ? » dit le prêtre. « Et s’il ne l’était pas ? » dit le professeur. Ils s’étreignent alors et unissent leurs mains. Exactement comme la femelle et le mâle – abstraitement à l’église ou la mairie, concrètement en la couche commune.
Jean-Charles Pichon