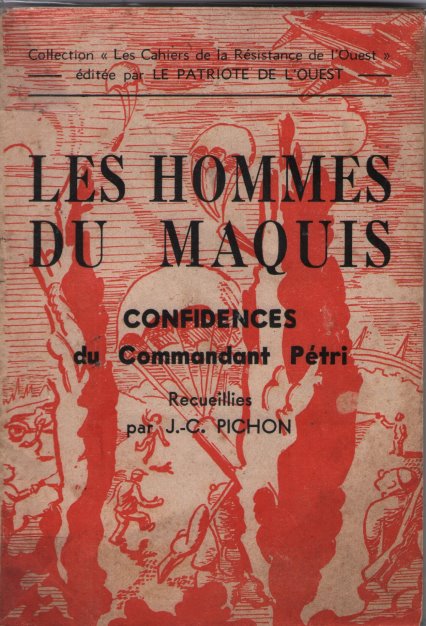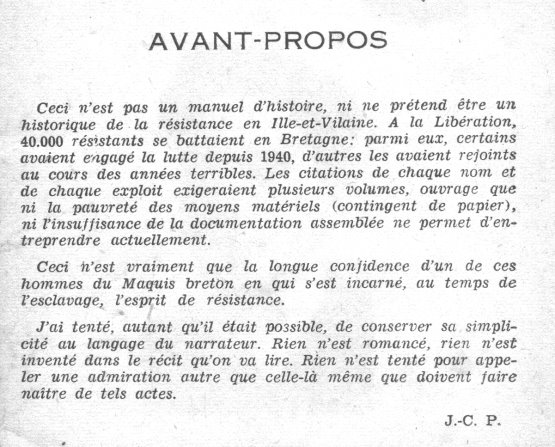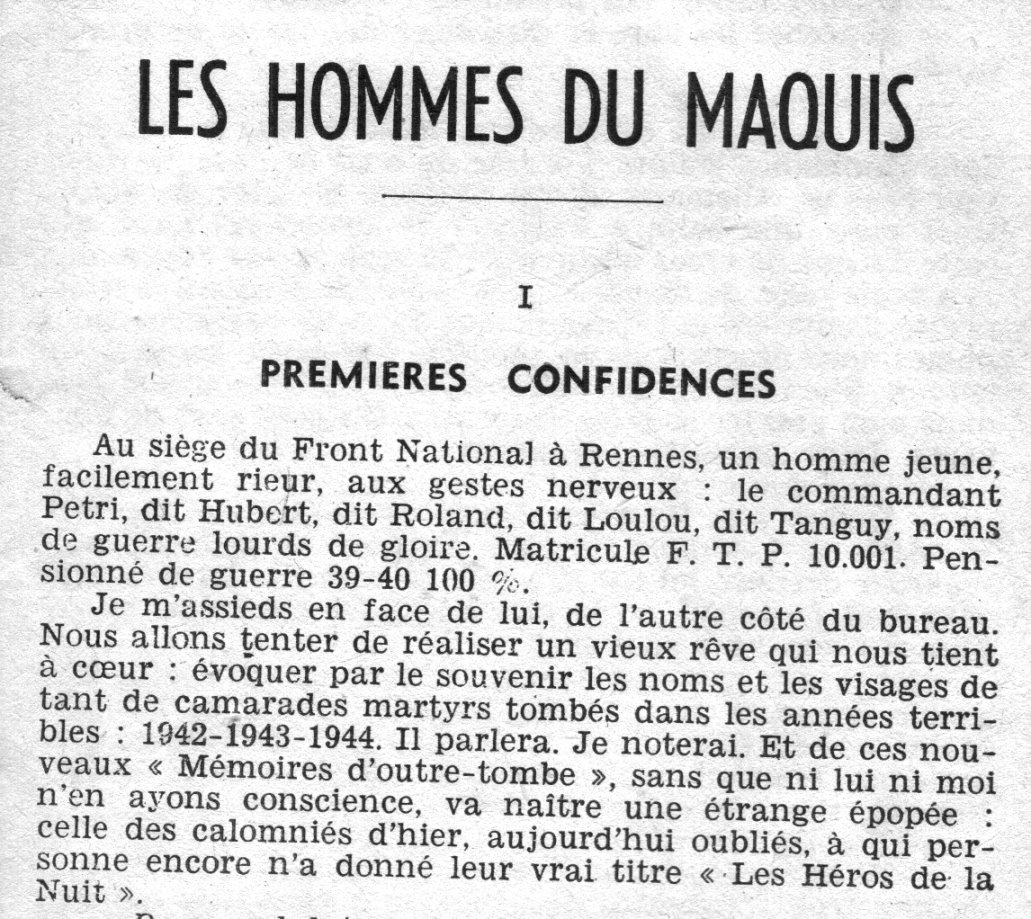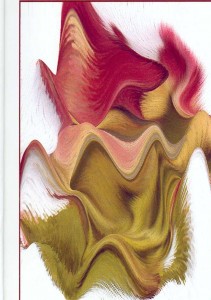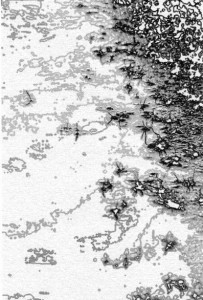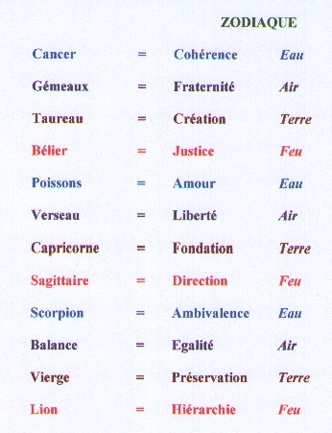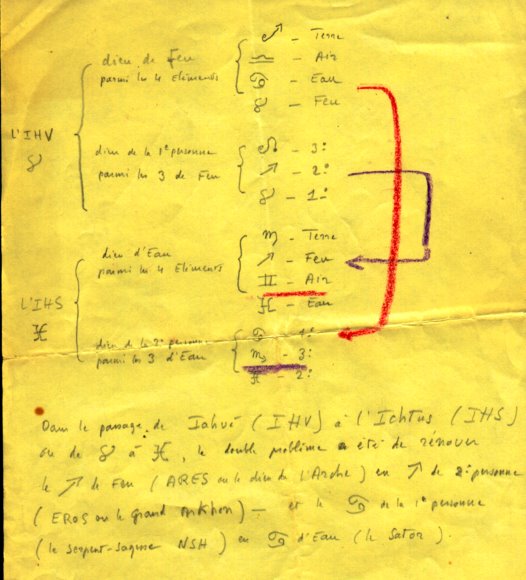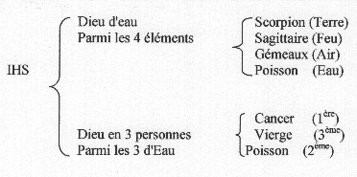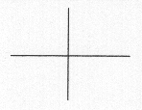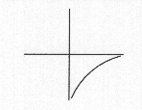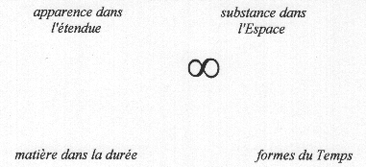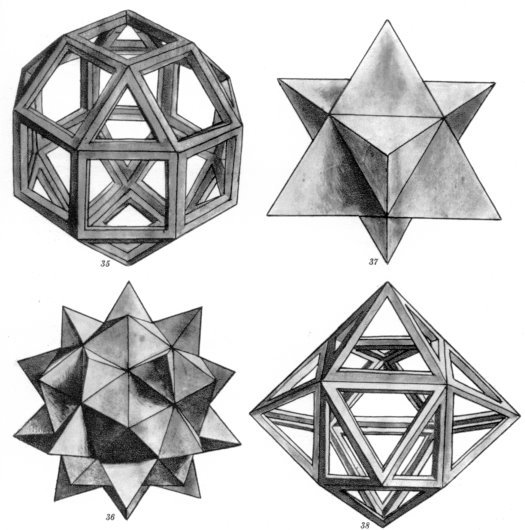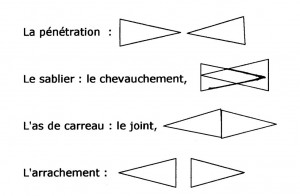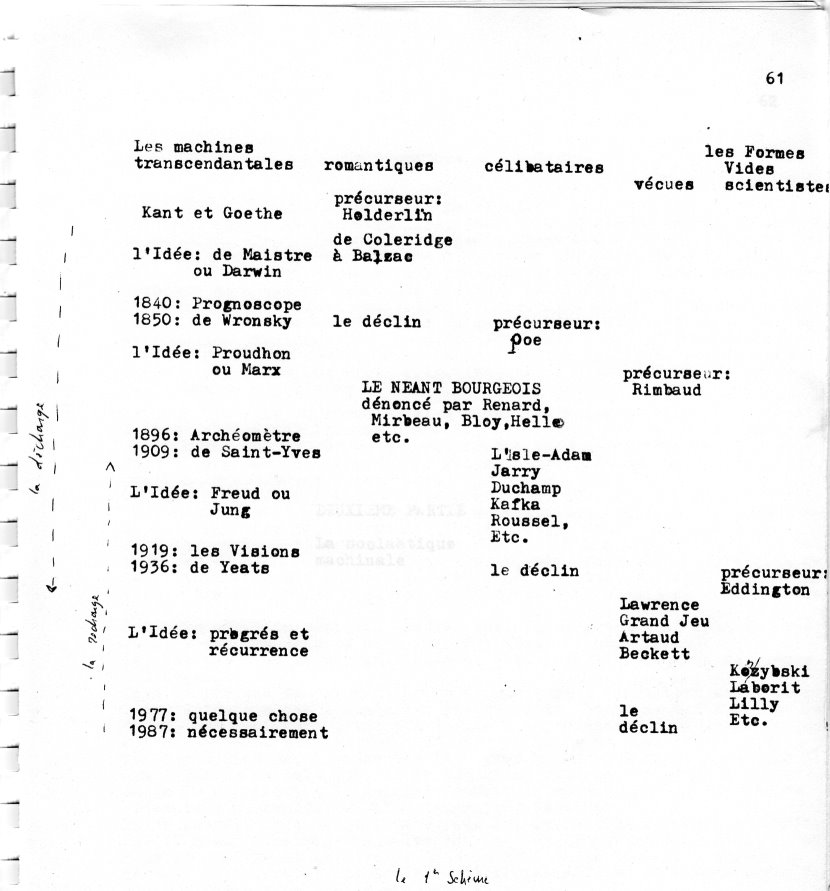LE PETIT METAPHYSICIEN ILLUSTRÉ
SOMMAIRE
La mise au point
En guise de préface (1977)
Préambule – LES DEUX ACTEURS – la rentrée en soi – le principe de causalité – le principe d’identité – le gagnant – LA DESIGNATION – la sortie de soi – le morceau de viande rouge – 1984.
Première partie : Une confection d’inventaire
I LE PROCES
La complétude et le maintien – l’accomplissement – le même et l’autre – partition et parturition – les trois et les quatre – éléments et qualités – complétude, opacité, récurrence.
II LA FIGURE
Pourquoi un inventaire? – la définition – histoire des inventaires – le motif et le joint – l’inversion – les dernières figures – la caverne et l’autel – le suffrage et l’écart.
III LES LOIS
Leur trilogie – les lois de la polarité – les lois de la finalité – les lois de localisations – thermodynamique et information – une génération inventive.
IV LA FORME VIDE
L’attrait de l’abîme – brimborions et pendeloques – la 1ère application : le même et l’autre – la 2ème application : le contenant et le contenu – la 3ème application : ordonnancement et passage.
V LES MANEGES
La disposition – les visions – note – des projections et des relations – le premier schème.
Deuxième partie : la scolastique machinale
I LA PROCEDURE
L’anguille et la civelle – la mère CMISA – je pense, donc je suis – les inscriptions – les descriptions.
II LES VALENCES
Lettres ou nombres? – le mode et la relation – les trois valences – des rapports primitifs – les deux mues – moins et plus – les points et les tirets.
III L’UNITE
La soif et la mesure – avant et après – la moyenne – les matrices – la moyenne sectorielle – l’unité définie – l’amalgame.
IV LES DIMENSIONS
La symétrie – matériau, proportion, niveau – les matériels – proportions et liberté – l’Espace et la durée – les associations – l’unité potentielle – contenance et liberté.
V LES RELATIONS
De la coexistence des systèmes mathématiques – définitions de l’infini – les relations d’équivalence – de l’unité originelle – insuffisance des relations.
VI LA VIS SANS FIN
Le contenant et le contenu – la marmite libératrice – la gestion ou jection – l’écart et sa correction – le passage et sa clusion – suite – les descriptions et les actes – l’horizontal et le vertical.
VII LES DEUX UNITES
Les jugements et les lois – l’articulation – la réduction – pourquoi le vocabulaire? – les suspens – applications.
Troisième partie : les verdicts zodiacaux
I LE VOCABLE VIVANT
La crise des vers – les étoiles de midi – l’enroulement – trois formes vides – les vivants et les morts – une notation chronologique.
II LES ACTEURS
L’horizontal et le vertical – le rôle et l’emploi – la station et l’état – le principe et le drapeau.
III LE SUCCESSIF ET LE SIMULTANE
La presse – le PAN – la primauté – la projection – le voyage – les sens.
IV LES MOYENS
Le voyage précisé – les opérations – les pas – la complexi-fiction – l’instance.
V LE VERDICT ZODIACAL
Le prévenu et l’inculpé – la partition – la parturition – l’appareil – l’accusation – la précession – la culpabilité.
VI UNE FIGURE TEMPORELLE
La prétention inévitable – l’analemme – la bande de Moebius – le palimpseste – le jeu des vocables.
VII CONTRE DUMEZIL
Pourquoi ce détour? – les deux parts – la maladie – le Grand Guerrier – le Sagittaire – la règle du jeu – éternité du zodiaque – le labyrinthe.
Quatrième partie : l’objet-dieu
I LE SERPENT VERT
Au-delà de l’artifice – des chronologies – Märchen – commentaire – l’antérieur et le contenant.
II DU POISSON AU VERSEAU
La relation et la projection – les sept voyages – les personnages – les deux successions – la troisième croix.
III LES TROIS MORTS
La mention et l’usage – lectures longue et courte – l’Apocalypse – a) des voyageurs et des temps – b) des phases de l’unique – les trois morts.
IV POURQUOI LES SEPT
De l’opacité des machines célibataires – le discours renaissant : mantic consugens – le Temps et l’étendue – l’étendue et la durée – la durée et l’Espace – l’Espace et le Temps – les 2n (le récit et la séquence).
V LES BIBLES DE PIERRE
L’édification – la bible d’Amiens – d’un dieu l’autre – les nombres mutants – le problème des chronologies – les illusions – la représentation.
VI LES SOULAGEMENTS
Le problème – la monture – l’émargement – l’emprunt et la restitution – les niveaux – la diagonale – pour continuer – la diagonale et ses jeux.
VII VADE MECUM
le double mensonge – le procès, le voyage et la vie – l’objet kantien – les dialectiques factrices – les trois centres – la danse des nombres – l’inexprimable.
Les cinq poèmes et leurs tables
1 – En Un
CONSTRUCTION DE LA MACHINE
2 – Hybrides
CONNAISSANCE DE L’OBJET-DIEU
3 – Le dialogue
EN CETTE HEURE DU SERPENT
4 – L’arbre : un poème de nombres
UN ARBRE PLANETAIRE
5 – Les délivrances
La mise au point
Partout dans le monde il y a des gens qui ne feraient pas de mal à une mouche et qui pourtant torturent leur compagnon ou leur compagne, détruisent des réputations et mènent les meilleurs au suicide, vendent et achètent les armements qui accomplissent les génocides.
Il y a des hommes qui ne diraient jamais un mensonge, par exemple : je vous aime, quand ils n’aiment pas et qui pourtant vivent dans le mensonge. Ils disent : la vérité est supérieure à toutes les religions, lorsque leur religion se nomme Vérité. Ils disent : Dieu est toute bonté, ce qu’il est non moins évidemment que toutes les peurs et tous les courages, toutes les sciences et tous les jeux, toute l’ironie du monde et sa prise au tragique. Et l’envers du Bien, s’il est Tout.
Il y a des femmes aussi qui agissent comme ces hommes et tiennent les mêmes discours. Plus nombreuses, peut-être, puisque elles meurent moins jeunes.
C’est pourquoi on se gardera de telles affirmations douteuses, proférées comme en marge de sa propre existence, et plus généralement de toutes les formules qui, à vouloir trop dire, ne disent rien. On traquera Dieu avec des nombres, avec des noms interchangeables et des figures géométriques, ou bien on laissera les dieux tranquilles, car ils n’ont pas pitié du chasseur malheureux.
Un jour de septembre 1985,
où j’ai commencé d’écrire ce livre
sans savoir si je le finirais.
En guise de préface
(1977)
Le préambule
Les Athéniens ne voulaient pas croire que l’Amour désirât le Bien; ils voyaient en lui l’amant de la Beauté. « Quoi donc! leur dit Socrate, L’Amour n’est-il pas beau? – Assurément, il l’est. – Est-ce qu’on désire ce qu’on a? ».
Des ironies furent autres, telles que de Jésus: « Que celui d’entre vous qui n’a jamais péché jette la première pierre » (puisque vous me parlez de justice). Ou bien: « Quelle figure orne cette pièce? – Celle de César. – Rendez donc à César ce qui lui appartient » (puisque vous me parlez de la dette). Telles que de Cues, inventant son principe de Contradiction aux extrêmes, ou de Rabelais, de Nietzsche, enseignant le Gay Sçavoir. Mais ce rire dionysiaque, ce fatal retournement aux jointures des extrêmes, ce renversement du mythe qu’entraîne sa « mention » sont encore l’ironie de Socrate, le refus du signifié, l’appel au signifiant.
Le « Personne » d’Ulysse ou son naufrage ultime, près de l’île voisine d’Ithaque, au retour d’un voyage de dix années, sont des éclats de rire, comme les contradictions voulues d’Emmanuel Kant ou les mésaventures de K., qu’il s’agisse du procès inévitable ou du château inaccessible. Bien que Kafka, Kant ou Homère ne soient pas des clowns patentés. La littérature, l’art, la philosophie même sont pleins de ces ironies, car ceux qui vivent dans la mémoire, qui survivent, sont ceux qui ont su les manier.
Le réel non plus n’en est pas avare. Un jeu de mots, parfois, libère de l’angoisse, tel que le double sens du mot sens (un vecteur ou un signifié); ou un jeu de choses relance la quête. En mars 1974, alors que j’hésitais à reprendre la mienne après tant de livres écrits (et si mal lus!), il est possible qu’un tel jeu m’en ait donné le soudain courage. C’était dans la campagne, non loin de Garons. Je gravissais un sentier parmi les vignes quand, tout à coup, un mur m’a barré le chemin. Or, il n’y avait jamais eu de mur en cet endroit: le chemin qui montait n’était pas une impasse. Quelques secondes plus tard, je vis que le mur marchait (comme s’est mise à marcher la forêt de Macbeth). Une minute plus tard, il avait disparu et la voie était libre. Ce n’avait rien été qu’un troupeau de moutons qui traversait lentement un chemin transversal, au sommet de la côte. Dix souvenirs me vinrent alors, d’autres murailles dressées contre ma vie et que j’avais reconnues pour des troupeaux de moutons. Le plus souvent: une foule transversale, acclamant le Maréchal ou le Général, selon le cas, allant de l’est vers l’ouest ou au contraire quand je montais du sud au nord… Mais, toujours, quelle joie, que de déceler l’illusion, que de voir s’effilocher la continuité feinte!
La muraille éclipsée, on se prend à rire. Du rire de Socrate, de Jésus, de Rabelais, de Nietzsche, de Kafka, quand, le concept éclaté, ils ont vu de leurs yeux le chemin se rouvrir, l’horizon se représenter.
Mais, bientôt après, je ne riais plus, défait et démembré moi-même, par la faiblesse, l’incertitude et l’outrecuidance de mes sens (dans le troisième sens du mot, non plus vecteur ou signe, mais appareil). Car, s’ils ne distinguent pas un mur d’un troupeau, que puis-je en attendre? Que demeure-t-il, en fin de compte ou en fin de parcours, de la réalité?
Pour la nommer, la définir et la contenir, je l’ai trahie, elle, le mur-troupeau, la mort-éternité. Ne me suis-je pas trahi en la trahissant, choisissant l’arrêt, trop de fois en ma vie, dans la voie ouverte? Ou, croyant l’épouser, ne me suis-je pas perdu? Ne l’ai-je pas perdue en une autre confusion? Car, en un autre temps, le troupeau est mur aussi, aussi longtemps qu’il passe. Mortel, la mort au bout, je ne suis pas immortel, et le troupeau est fait de ces murs séparés: les individus qui composent la foule.
On peut bien rire, alors. Le rire est épouvantable: il nous jette au néant.
Vivant de cette censure et dans cette confusion, comment puis-je vivre encore? Dire JE? Dire l’univers? C’est le problème que pose ce texte, quelques feuillets extraits d’une quête de quatre ans et d’un millier de pages. Il ne dit que la difficulté de dire, l’objet d’une part, le sujet de l’autre, l’un et l’autre censurés – ou confondus.
Puis, un jour, une idée bizarre m’est venue. Que l’Ecclésiaste n’a pas eu tort d’écrire le verset scandaleux (monstrueux, quand il porte le supplice de Bruno, l’exclusion de Galilée): « le soleil se lève et se couche, la terre demeure immobile ».
Car, c’est de la terre que j’observe l’astre. Comment mon poste d’observation ne serait-il pas stable? Qu’observer d’un poste mobile?
Lorsque tout bouge autour de moi, ne faut-il pas que JE, pour juger du mouvement, se considère comme stable, infaillible, éternel, ou bien qu’il renonce à juger? La notion de stabilité dérange : à la limite, elle rend dérisoire le jugement. Mais la notion contraire fait de JE un imposteur, car il ne pouvait pas juger.
Il n’est pas d’objectivité qui n’exclut d’abord l’objectif (la caméra ou le cerveau, mon lieu d’observation et le temps où je vis). Lorsque Kant a rejeté dans le transcendantal toutes les transcendances, quelque chose le transcende encore: sa pensée. Elle seule n’obéit pas aux règles qu’elle formule (c’est son droit) et qu’elle impose (son crime). Il n’est pas une science ou une théologie qui, levant plus haut un pied, ne s’assure plus fermement de l’autre. Celui pour qui tout bouge s’est situé en dehors, dans le non-mouvement du dogme ou de la loi, avant de l’oser dire.
Ni les nombres savants, ni la folle certitude ne m’aveuglent à ce point. Sur l’ironie de Socrate, sur le mur et les moutons, sur le mot de l’Ecclésiaste se fondent mes ouvrages. Mais il est vrai que, depuis le 14 mars 1974, je danse, l’un de mes pieds s’assure toujours avant le lancer de l’autre.
LES DEUX ACTEURS
1
La rentrée en soi
Je jouerai assez dans ce livre: il n’est que jeu, mais un jeu de bridge ou d’échecs, qui se fonde sur des règles précises, non pas sur la visite de l’ange, qui se situerait hors des règles. Il ne m’est pas entré tout entier dans le cerveau comme Athéna sortit du crâne de Jupiter ou Dionysos de la cuisse du dieu. Je n’ai pas connu la conversion (mondaine) de saint Vincent de Paul, de Cocteau, de Claudel ou de Frossard, au bon moment, ni celle (à rebrousse poil et au mauvais moment) de Dante et de Kâbir, de Daniel, de Ramakrishna, du Bab…
Ou bien je les ai connues, tantôt l’une, tantôt l’autre, vingt fois en cinquante ans, dont plus de la moitié en cet âge incertain qu’on prend pour l’âge de raison et qui s’est prolongé pour moi au-delà de l’adolescence. De sorte qu’elles ne me furent pas des conversions mais, plutôt, des retournements à quelque humus antérieur. Presque impossibles à circonscrire dans le temps…
Impossibles tout à fait, si je n’avais eu mes livres, mes ébauches du Livre, mes journaux. Et, bien sûr, les ouvrages d’autrui, milliers d’ouvrages – ou n’est-ce pas des dizaines de milliers? – qui me forgeaient une âme universelle.
Je ne sais que tirer de mes expériences propres ou de celles d’autrui des traces dont on a dit que je les recensais seulement. Il y a huit ans, mon fils aîné: « Tu te prétends un créateur, mais tu ne crées rien! » Le mot m’a fait mal, JE est ainsi: l’amour-propre a sur lui plus de pouvoir que l’évidence. Mais le mot était exact: on ne peut se dire un créateur lorsqu’on nie le principe de causalité.
Je ne puis non plus m’en repentir.
Si, malgré le refus ou le rejet du miracle (je ne dis pas: son absence, car des miracles me furent donnés, que mes autobiographies recensent), je me considère encore comme conduit, n’est-ce point par la grâce de tous ces plagiats, de mes œuvres et d’autres, dont l’indécence eût dû me détruire, alors qu’elle m’a constitué?
2
Le principe de causalité
Allons plus loin: ce cynisme ne fut pas inconscient, ni hasardeux son fruit. J’avais dix-neuf ans, matelot à Rochefort, quand Nietzsche m’a suggéré le vocable: « moraliste indélicat » pour désigner le moraliste qui ne se préoccupe pas de dire vrai, ni vertueusement, quand le discours profite.
Deux ans plus tôt, mon camarade Ross et moi, nous avions inventé la méthode des surcauses, qui renversait le principe de causalité. Quatre ans plus tard, en 1943, je commençais d’élaborer L’Ethique (la mienne), à laquelle j’ai travaillé chaque jour pendant quatre ans, avant et après sa publication dans la revue Prétextes (créée à cet effet).
J’ai souvent dit par quelles étapes le refus du principe m’a été imposé. Au départ: le refus d’une causalité métaphysique: le dieu « incarné » de Hegel, puis le dieu créateur, séparé du monde, puis le dieu émanant et immanent des juifs, des brahmanes, des législateurs. Plus tard: le refus d’une causalité scientiste, à partir de l’atome originel, du premier soleil, du premier vivant, du premier vertébré, mammifère, homme…
L’idée était en moi dès mon affirmation de 1937: le jour coïncide avec le lever du soleil, par lequel on l’explique. Mais l’explication de l’effet par la cause, inventoriée après l’effet, n’est rien d’autre que le « péché » philosophique, que les philosophes nomment un « cercle ».
Or, non seulement les philosophes (ou, du moins, les plus honorés d’entre eux) mais les savants, qui les dénoncent ont toujours sauvegardé ce cercle, par le raisonnement dit « ad hoc », que le système a exigé. Puisque, au départ, toujours, ils se disent en mesure, sans l’avoir démontré, de créer LE système.
Refusant avec dégoût, en mon année de philosophie scolaire, un principe dont je distinguais le faussage, je refusai d’abord toute philosophie. La poésie me suffisait alors, qui ignore sa cause; plus tard, ce fut la soumission aveugle aux mythes, de la Patrie (en 1939), de l’Amour l’année suivante, de l’Œuvre, de la Liberté, de la Citoyenneté du monde et de l’Egalité (en 1950), de la Famille, plus tard encore. De la Vérité, au passage, et bien sûr de la Fraternité…
En même temps – de 1937 à 1957, pour faire court – je m’efforçais de trouver un chemin contraire à celui de la causalité et de l’entropie. Mais ce chemin eût été de l’avenir vers le passé, de l’inertie (contre la vitesse), de la néguentropie, de la résurrection, du miracle, contre la voie mortelle de la rationalité. Comment le découvrir, alors que tout mourait autour de moi, en moi?
Indiscutables en leur principe, contraires au principe de causalité, la méthode des surcauses, la vocation du moraliste indélicat et toute éthique demeuraient imaginaires, « mythiques »: j’avais pu les construire, admettre et signifier, je ne pouvais les vivre. Ma vie même (c’est JE encore) interdisait qu’ils fussent.
Je créais malgré tout, et malgré moi souvent, hors tout plagiat, un chapitre de roman, un poème, un dialogue, dont le « ton » me surprenait – si surprenant que je ne pouvais le reproduire. J’aimais à la folie ma femme, mes enfants, ne vivant que pour eux et soumis au démon qui me pressait de leur sacrifier même l’égoïsme de mes œuvres. Je combattais, un jour ou l’autre, pour une égalité des droits, des races, des sexes, des âges, sans douter pour autant des âges, des sexes, des races – et m’assurer de l’inégalité nécessaire des droits (le roseau n’a pas les mêmes que le cèdre). Pour une libération surtout je combattais, qui m’eût arraché à ce couple, à cette famille, à cette patrie, à cette humanité, auxquels je sacrifiais ma vie.
Mais ni ces œuvres ni ces amours, ni ces délires justiciers, ni les révoltes les plus vaines, qui constituaient aussi ma vie, ne m’offraient la moindre chance de m’en abstraire. Au contraire, à toutes fois, ils m’usaient un peu plus, m’approchaient de ma mort. Plus j’ajoutais à JE, plus ces ajouts me précipitaient à la destruction de JE. Il n’était aucun de ces détours, effectués ou suivis pour me survivre, qui ne me conduisît seulement à la raillerie ultime du Trou.
Je ne mourais pas, petit à petit comme procède l’abîme, sans que mourût une volonté d’œuvre ou un amour, une soif de justice, une révolte avortée. Je n’inventais rien qui ne fût délire; il n’était pas de délire qui ne fût la mort plus prompte. Je suis mort mille fois, le plus souvent sans savoir de quoi je mourais.
Un autre dit qu’il n’était pas possible d’être aussi sot.
3
Le principe d’identité
Au milieu de l’année 1957, je cessai de créer, et même d’écrire. Comme toujours, ce n’était pas de ma part une volonté délibérée. Grasset me refusait mon dernier manuscrit (une suite de « L’autobiographe ») et, bien sûr, je ne pouvais l’offrir à un autre éditeur. J’étais à bout de forces, aussi.
Je me laissai conduire d’une boîte à l’autre.
Je parle de la manie de boire, qui me vint alors et commença de me jeter, d’un soir l’autre, dans un bar différent – dans le même « enfer bleu »(1). Mais je parle également de la manie de lire qui, pendant près de quinze ans, m’avait abandonné. Car chaque oeuvre parfaite est bien comme une « boîte », où l’on s’enferme huit jours ou dix-huit mois.
Je croyais les avoir toutes faites (comme on fait le tour de sa chambre ou de l’Europe), mais l’ignorance que j’en avais, où j’en étais, m’apparut infinie. Des milliers de livres avaient paru, pendant mes quinze années d’absence: presque tous renvoyaient à d’autres milliers d’autres, dont personne n’avait parlé, dans le milieu ou le « média » qui m’avait recouvert au cours des quinze années.
Ignorant Bataille, Reich, Artaud, Michaux, Borgès, qu’aurais-je su de Sumer, du Rig Veda, des religions amérindiennes, de la prophétie médiévale? Ne sachant rien de Shelley, de Goethe et de Molière que ce qu’en dit l’Ecole, qu’aurais-je imaginé de l’audace baroque, de la science des tragiques grecs? L’ignorance qu’imposent les universités et que prolongent les médias, elle ne tient pas au rejet de quelques oeuvres maîtresses: une aliénation l’entretient, de toute « âme », de Balzac et de Flaubert, de Racine, de Hugo. Mille coupes ne tendent qu’à rompre le fil d’une continuité que l’Histoire n’interrompt pas.
Je ne pouvais, il y a vingt ans, déceler ce fil. Mais la charge des impostures m’épouvanta. Une obsession me tenait, que formulait déjà un roman de 1952, « Sérum et Cie »: l’inexistence de JE, fabriqué de morceaux innombrables. A l’époque, rien de plus qu’une trouvaille littéraire, peut-être un alibi. Je rejetais sur l’AUTRE le mauvais, le mensonge, le crime (que tribunaux et médias ne nommaient pas ainsi): la mort de ma femme France, et sans doute bien d’autres, imposées par mes livres, mes délires, mes absences. Je nommais cet AUTRE Pigobert (Charles), puisque je me nommais Jean-Baptiste Constant Marie. J’y voyais le Pip bardé d’or, le culotté, le botteur de culs, l’infâme, puisque Baptiste était l’Auguste, le sans-culotte ou l’ange tombé des cieux.
Une difficulté demeurait, sérieuse – elle me bloqua pendant dix ans -: faire la part en moi de Jean-Baptiste et de Pig. Ils se révélaient, chacun, une infinité d’êtres.

Illustration Pierre-Jean Debenat
Si je me dénombrais deux, pourquoi pas quatre, seize ou soixante-quatre? Je n’analysais pas mon actif, mon passif, sans y trouver cent éléments divers, a, b, c, d, dont je ne pouvais pas toujours dire lequel était de A, lequel de B. Ce besoin de Baptiste, Pigobert le comblait; ce désir de Pigobert, il arrivait que Baptiste le réalisât. Un cercle rouge a-t-il sa place dans un ensemble de choses rouges ou un ensemble de figures géométriques?
Le choix s’y dissipait seulement, niant le JE, qui avait pu encore choisir. Si le réel n’était que cette diversité, ce puzzle, Pig s’en voulait le recenseur et, par le recensement, le maître. L’Unité dont Baptiste se prévalait, elle n’était que l’élan qui le portait à se détruire. Baptiste – l’homme du baptême – se défendait à sa manière: il disait le puzzle sans fin – et que le carnaval ne mène en aucun cas à l’efficacité: que Pigobert jouât de la mort, cela ne l’empêcherait pas de mourir. Pire: il ne revêtait d’autre masque, d’autre loup que de la Mort elle-même. Le masque interdisait que Pigobert eût un corps.
Mais à chaque expérience nouvelle, le Baptiste seul mourait en moi, sous les coups, les épreuves, les stresses, les entropies: le Baptiste enfant, adolescent, adulté, mûrissant, le chrétien, le catholique enjuivé, le patriote, le poète, le citoyen du monde, l’amant, l’époux, le père, le révolté, jamais las de s’anéantir si l’infini se pouvait atteindre au-delà des fins. Au contraire, le plagiaire, le tricheur, le comédien, le technicien survivait aux fins de ses masques; pire: il s’enrichissait de ses mues, toujours taillées à ses mesures. Aucun drame n’excédait en dramatique le temps perdu, l’ennui de la visite au tailleur. Si JE était ce qui dure, JE était Pigobert.
Comme la recherche d’un sens qui ne fût entropique m’avait rejeté du Sens, la recherche d’une unité qui se tînt hors des boîtes me rejetait de l’Unité. Une troisième réalité s’offrait, ni le sens causal ni l’unité métaphysique, mais le cens des unités qui me composent et qui, réellement, existent à l’infini.
Par ce biais, JE se redonnait une existence; il pouvait choisir de nouveau.
Mais serait-ce l’infinité du Cens ou la constance des Unités?
______________
(1) « L’enfer bleu » : voir dans la rubrique « Nouvelles » le texte portant ce titre.
4
Le gagnant
Dans les quatre ou cinq ans que je dis, où j’abandonnais à la fois le principe d’identité et le principe de causalité pour fréquenter les boîtes (des bars ou des auteurs), je rejetais également Pigobert et Baptiste, bien que le premier conquît encore par son cynisme et sa désinvolture, bien que le second prît des coups. Les autres – des femmes, surtout – payaient, soit que Baptiste les attendrît, soit que Pigobert en jouât.
Mais, en JE, le combat se poursuivait, sans pitié (du côté de Pig), sans faiblesse de l’autre côté.
Si, comme le voulait Pigobert, le cens des techniques nie le principe d’identité, Baptiste n’avait pas d’existence: il se complaisait en l’utopie. Si, comme le croyait Baptiste, le sens de la causalité n’est qu’entropie et s’il interdit d’être, Pigobert ne serait jamais que les masques dont il s’affublait: une chose de carton ou de plastic, par définition négligeable. Ni les échecs du chimérique ne pouvaient troubler le « réaliste », ni les inventions du tricheur ne pouvaient influencer durablement le probe.
Il n’y avait pas de solution.
En fait, je n’avais cessé jusqu’alors, de faire de l’un le contenant de l’autre, ou de prétendre le faire, dans la confusion de leur dialectique avec celles du corps et de l’âme, de la forme et de la substance, puis, en dégénérant, de l’apparence et de la matière.
En mon enfance chrétienne, je n’en pouvais douter: jusqu’en ses rêves charnels et son besoin de souffrir « pour une grande cause », Baptiste était mon âme; Pigobert, donc, mon corps. Les journaux de mon adolescence sont pleins de cette horreur de Baptiste pour le corps « qui l’emprisonne ». Par l’ascétisme, un jour, il espère vaincre la Bête (le Hyde de Stevenson).
Vingt ans d’école, de lycée, de faculté avaient fait de Pigobert un maître de l’esprit scientiste; c’était Baptiste qu’on exilait dans l’irréel, ou dans quelque servage (l’emploi) s’il tenait – on ne savait pourquoi – à subsister. Il n’avait pas rejeté le principe de causalité par amour-propre, esbroufe, esprit de contradiction, mais pour perdurer sous le fardeau immense. Il avait donc aussi une manière de corps, puisqu’il avait tenu.
Plus tard, beaucoup plus tard comme on l’a vu, j’en étais venu à ne pas douter que Baptiste fût mon unité charnelle – après tout, c’était lui le payant, le débiteur payant ma dette, le masochiste – et Pigobert le puzzle, qu’il excellait à reconstruire.
Mais c’était dire que Pigobert ne cessait de sauver Baptiste: sans celui-là, celui-ci eût-il survécu?
Jouant de Pigobert comme d’un esclave utile, je lui donnais tout le possible: l’escrime, la création ludique, le poker, les dames, puisque une technique nouvelle, ou une femme nouvelle lui suffisait.
De ces dons minimes il s’engraissait.
A coups de parties victorieuses, de romans couronnés, de femmes séduites, Pigobert réduisait Baptiste. Deux ou trois années folles eurent raison de l’imbécile. Bien vêtu, bien nourri, largement abreuvé, Pig fut de nouveau le roi, en cette quarantaine qui asseoit l’homme. Le poète, on l’eût laissé crever sans remords, mais on honorait l’homme de lettres, le journaliste, le scénariste. On me demandait des livres, des essais, des articles, le cinéma me découvrit. Mes enfants devenant des hommes et des femmes, je me donnais leur âge. Je perdais plus de temps à chasser les femmes comme on chasse l’importun qu’à les chasser comme la proie.
Pour ce roi, formellement visible, Baptiste ne pouvait être que le sale petit esprit, crédule et tourmenté, dont les vagues révoltes agacent plus qu’elles ne font peur. Il m’agaçait surtout par sa croyance, inébranlable, de m’avoir créé, un jour d’hiver, pour se débarrasser de son mal et de sa peur. Il ne me suffisait pas de l’avoir recouvert de mon mètre quatre-vingt deux, de mes quatre-vingts kilos, de l’avoir ramené à l’état de blafard et fuyant ectoplasme. Il fallait que je l’eusse précédé.
Je rameutai mon enfance: cinq de vie pleine et libre, auprès de l’océan et parmi les rochers. Je me souvins de mes ancêtres, les fiers Bretons, et, par eux, de vingt générations de Celtes captifs des saints Patrick et Guénolé: en moi bouillait le sang des pilleuses d’épaves, exigeait de renaître un cerveau carnivore, au-delà des esclavages. Je méprisais l’alter ego à ce point que je fis appel à lui pour compulser les livres, les manuscrits, pour écumer toutes les bibliothèques. Docile, il m’apportait les documents dont je pimentais mes salades. Je n’avais pas à le combattre: loin de me résister, il admirait ma verve, s’en sachant incapable, il adorait mes ordres. Son maître, son univers, son « père »? Pourquoi pas? Il me donnait l’Unité, que je ne réclamais pas. Elle m’anéantit.
Cela ne se fit pas d’un coup, car je distinguais mal en quoi le Souverain, le Roi, n’est pas nécessairement l’Unique, qu’on peut être celui-là sans être celui-ci. Mais, petit à petit, je cessai d’acheter des vêtements neufs, de pourchasser les femmes, d’écrire des scénarios. Recouvrant une manière d’audace, Baptiste me défiait de m’inventer une « boîte » où je pus, à la fin, entièrement m’accomplir; je ne l’écraserais définitivement, je le sentais bien, que dans un univers construit à ma taille. Il avait raison sur ce point: mes jeux étaient trop courts pour moi, trop dérisoires.
JE avait créé le piège; allié de Jean-Baptiste, il jouissait de l’embarras, de la naïveté du clown. Car JE n’est que jouissance: plus Pigobert que Pig, jamais là où l’on croit, mais toujours à côté, sous l’autre coupe ou tasse, maître es-bonneteau.
Ou bien j’avais choisi Baptiste, peur-être parce qu’il était le vaincu, le plaintif, l’avorton – réduit à ce point qu’il n’osait plus « la ramener » que dans les heures de colique ou de migraine, au lendemain d’une cuite carabinée. Car JE est aussi ce compatissant, qui ne prend jamais que le parti des faibles.
Un jour, fatalement, JE se nomma Baptiste; Pig se retrouva seul, sans un public pour admirer ses mimes et nu, dépouillé de tous ses masques. Lui, le joueur, il se faisait le jouet du quêteur. Son habileté même, ses techniques, il ne les utilisait plus qu’à ordonner, organiser la quête (dans l’illusion béate d’aider à l’avènement de son futur Royaume). Il mit toute son ardeur à me servir, moi, Baptiste, son ancien esclave.
C’est à dire qu’il n’exista plus.
Alors, j’arrêtai le jeu. Je brûlai tous les papiers – des dizaines de kilos – que recouvraient des notes, mes manuscrits d’ébauches, des critiques, des articles; cela fit un grand feu dans la cour de la ferme où Geneviève et moi vivions depuis décembre 1965. Je me croyais assez fort pour admettre à nouveau Pigobert et Baptiste, peu à craindre le premier, presque heureux le second.
Simplement, étais-je encore JE?
II
LES DESIGNATIONS
1
La sortie de soi
Au temps de la victoire – fragile – de Pigobert, j’avais joué, pour accabler Baptiste, des trois dimensions où tout homme se reconnaît. Dans l’espace, un volume, et dans le temps les trois temps: je fus, je serai, je suis. Je rappelais à l’ange, ainsi, sa déchéance; je la lui révélais sans recours: il était cela, précisément, qu’il refusait d’être: une boîte, prise dans un espace/temps qu’il ne pouvait contenir, non plus que l’infini.
Baptiste l’avait admis, car, tout au long de ses quêtes, il avait retrouvé les Trois. Puis, il voyait bien, savait ou concevait qu’il ne pouvait à la fois savoir, observer et créer. Chrétien, Pigobert le recouvrait et maîtrisait (par sa volonté d’éveil); il le précédait aussi, par son celtisme, sa faculté de servir un démon disparu. Soumis à l’Esprit Saint, si ce n’était plus au Christ, Bap humiliait la science, le triste jeu du tricheur. Trop souvent, l’un et l’autre, éperdus de fatigue, de doute et détresse, avaient demandé à quelqu’un d’autre – JE – de régler le différent, par le sommeil le plus souvent, ou par le mot exact, lorsque j’étais en veine.
Mais ni l’un ni l’autre ne doutaient des Trois, l’arme de Pigobert contre cette Unité qui le menaçait de toutes parts, le repos de Baptiste, en la Sainte Trinité d’abord, puis dans les trois jugements de Kant (ou les trois Vertus de Platon, les trois Arts de Boèce, les trois cerveaux de Laborit lorsque j’y vins).
Le recours me gênait pourtant; pour la simple raison qu’il me plaçait, moi, JE, au niveau de mes aides. Je me persuadais sans peine qu’il ne présentait pour Pig qu’une sorte de pis-aller (qu’est-ce que le nombre: 3, en regard de l’infinité des boîtes?) et pour Baptiste qu’un laissé pour compte, ainsi que pour la religion catholique, la mienne, depuis le concile de Trente, traitant de l’Esprit comme d’un passage, nécessaire mais redoutable, entre un Père éternel et un Fils provisoire (ou, du moins, limité, de par ses origines). Moi-même, JE, avais-je une origine? Laquelle? N’aurais-je pas une fin? Je ne me sentais plus, certes, ni du Père ni du Fils. Mais qu’est-ce que l’Esprit allait exiger de moi? JE redoutait le Trois autant que ses séides. Comment, sérieusement, se tenir pour responsable envers une entité – un nombre – qui se révèle à tout moment une imposture ou un rêve?
Il me fallait que le Trois se découvrît réel, pour que je pusse y croire. Ce fut chez un boucher de village, à moins de trois kilomètres du bourg où nous vivions.
Un logicien dirait que, leur combat résolu, par la disparition de Pig, Pigobert et Baptiste ne m’intéressaient plus; ni, partant, JE. ESOPE RESTE ICI ET SE REPOSE: le palindrome parfait. Mais il marche surtout. Pas après pas dans les campagnes, histoire de combler un vide; comme, jadis, contre les vagues et les embruns, ou, dans l’entre-deux, d’une banlieue l’autre, au bord des villes tonitruantes…
Il est surprenant combien une betterave, un kilo de noix, une entrecôte prennent de l’importance pour celui qui a faim. Le Sujet est luxe de riche; le pauvre ne vit que l’Objet.
Nous étions tous deux (Geneviève étant l’Autre) en état de désir toujours; souvent, en état de besoin, hors duquel en effet je n’aurais pas accordé une telle attention au morceau de viande rouge.
2
Le morceau de viande rouge

Illustration Pierre-Jean Debenat
Il est vu par vingt personnes: le boucher, sa femme, son fils, un employé et les clients qui se trouvent là, nombreux car c’est jour de marché, parmi lesquels je reconnais Grincheux, le vieux médecin du coin, l’ennemi de l’Eglise, le Barbouilleur, un bohème, vaguement hippie – le mot n’existe pas encore en France – et une voisine, mère de famille, que deux de ses enfants accompagnent. Il est donc bien réel, quoique vu différemment par les uns, par les autres.
La femme a demandé trois tranches de bavette (ce sera pour ses enfants) et le boucher s’emploie à la servir. Le médecin intervient; il dit la viande peu fraîche, dangereuse et que c’est un scandale de l’avoir laissée, une semaine entière, exposée à tous vents. De sa canne, il désigne un soupçon de verdissure qui zèbre la rougeur: il exagère, je ne pense pas que la viande soit à l’étal depuis beaucoup plus de deux ou trois jours, mais on ne peut lui donner tort; moins que tout autre j’y songe, escomptant que la femme renoncera à l’achat et que, mon tour venu, j’aurai le morceau suspect pour la moitié de son prix.
C’est le Barbouilleur, pourtant, qui suit la ménagère. Elle a de fait renoncé, convaincue par le Doc, qui proteste toujours. Le boucher proteste aussi, que cette viande est fraîche, la plus tendre qui soit. Le bohème interrompt les plaintes et les craintes: « Ce n’est pas pour la manger, dit-il, c’est pour la peindre! »
M’en revenant par les campagnes, j’ai gambergé; ou Pig l’a fait en moi, un instant ranimé par la bagarre; car, le cynisme de mon propos, Baptiste n’y aurait pas atteint.
Jusque vers 1900, sous la double obédience de la science d’observation et de la peinture académique, personne n’aurait songé à la diversité qui a conduit le débat. Bien que l’honnête Maxwell, déjà, ait démontré qu’il n’existe pas une observation sans l’observateur, et bien que des peintres de toutes modes, impressionnistes, raphaélistes, maudits, aient observé, rendu un même objet sous les aspects les plus divers.
Mais, en 1967, seuls des naïfs peuvent vivre dans l’illusion. Un siècle d’impressionnisme, de cubisme, de fauvisme, de peinture abstraite ou symbolique a rendu ridicules toutes les académies. La saisie progressive des champs, des pôles, de la lumière, de la matière a de même annulé l’ancienne saisie scientiste. Et combien de contraintes, de services d’hygiène, d’impositions, de lois, restreignent, depuis un siècle, le libre usage de la fraude?
En ces bouleversements, que pourrais-je dire encore, en toute certitude, de l’unique réalité de ce morceau de viande rouge?
Pour Grincheux, les couleurs et les formes que distinguent les autres spectateurs ne sont rien que des « signes », d’une autre réalité, qu’il nomme « la matière ». Le microbe est seul réel, ou le bacille, le virus, qui l’épouvante. Quelque peu physicien, son réel est l’atome, le noyau de l’atome et toutes les particules qui se déplacent autour, ou les facteurs de ces particules, les relations qui s’établissent entre eux, les traces qu’ont laissé subsister ces rapports, etc. Mathématicien, puisqu’ici, enfin, tout se réduit en nombres, il calculera sur le tableau noir, dans son carnet de notes, la matrice que constituent d’une part la ronde des électrons – ou la durée de vie du microbe – et d’autre part un temps d’incubation ou de nocivité, tout cela étant déduit de l’approfondissement d’un rouge, de la largeur d’un vert, de l’avachissement (et de la réduction) du morceau de bavette. Jouant des trois Epoques, je dirai que Grincheux ne vit que dans le passé, un passé fort récent, mais qui déborde – de peu – son existence propre, où Pasteur, Einstein, Planck lui parlent à l’oreille.
Or, ce qu’il conçoit ou sait n’est pas de l’irréel, puisque une certaine viande intoxique et tue, puisque la croyance en l’atome a détruit, en vingt secondes, deux villes du Japon. Si cela n’est pas réel, qu’est-ce qui l’est?
Pourtant, le Barbouilleur – et je ne sais encore s’il sera un Rubens, un Braque, un Picasso, un Fautrier – ne voit rien de ces molécules, de ces particules, de ces traces. Pour Rubens, le morceau de viande rouge est rose, comme toutes les chairs qu’il peint; pour Braque, il est noir, vert ou jaune, déjà bouffé des vers. Pour Picasso, c’est du taureau, et pour Dali du cheval; pour Fautrier, une manière de feuille, dont les fibres seraient des veinures. Ces perceptions non plus ne seraient pas des erreurs, mais ce sont comme des seuils, qu’il convient de franchir pour atteindre à l’avenir. Peignant les femmes, les hommes de Guernica, Picasso y a vu les membres démembrés, les visages éclatés des futures hécatombes. Peignant la jeune fille de 1910, Soutine recueilli dans sa vision la vieille qu’elle devait être quarante-cinq ans plus tard.
Ici, le boucher, sa femme, la ménagère triomphent, car ils ne vivent pas dans le passé ou dans l’avenir; des signes ou des seuils ils se moquent également, mais ils voient ce qu’ils voient, croient-ils, bien que l’un ou l’autre soient daltoniens, peut-être, sinon presbytes ou myopes. Comme moi, trop de fois, ils ont pris pour muraille un troupeau de moutons ou pour un désir de beauté leur aspiration vers le bien. Ici et maintenant, puisqu’ils se glorifient de vivre dans le présent, la mère de famille voit la joie de ses enfants dégustant la bavette; le fils végétarien ne voit pas exactement le même morceau de viande rouge que son carnassier de père. Ne se fiant pas trop à ses yeux, un autre client que je connais, un retraité, s’est approché de l’étal, pour mieux sentir. Tous ont demandé l’aide d’un « appareil », de leurs sens ou d’une vertu que, le plus souvent, ils n’auraient pu qu’à peine nommer.
Le problème semble insoluble. Il ne l’est pas, car le médecin, le peintre, le boucher ont joué de cartes différentes, où Platon eût reconnu une sorte de vérité, le modèle et l’esthétique, Augustin les trois vies et Boèce les trois arts…
Mais nul ne peut aller plus loin, et surtout pas ramener les Trois à l’Unité.
Car, si le savant prétend ramener l’appareil et le seuil à des signes, il dira que la réalité n’est faite que de points (corpusculaires, énergétiques) et que ces nombres composent non seulement l’être en soi mais la vision ou l’audition (mus, décibels) que chacun en a, ou les stations de l’initiation créatrice (associations, structures), hors desquels rien ne sera ni perçu ni conçu.
Au contraire, s’il prétend ramener le signe et le seuil au seul appareil dont il use, le boucher dira que Grincheux est un peu fou, et que le Barbouilleur l’est tout à fait. Ce disant, il ne prouvera que la faiblesse de ses sens et la médiocrité de ses réactions, impuissants à saisir l’atome et le chef-d’œuvre.
Enfin, le peintre, englobant l’appareil et le signe en sa quête infinie, les considérera tous deux comme des phases, des étapes transitoires vers l’accomplissement de soi ou le non-accomplissement. Il ne décidera pas de l’erreur ou de l’exactitude du signe, de la norme ou de l’anormalité de l’appareil, mais de leur pouvoir de création, de transformation, de mue. Dans les symboles qu’il utilise, dans son degré de myopie ou son aliénation, il ne distinguera jamais que la « disposition » ou la « fonction » qui le font ce qu’il est.
Mais c’est dire, différemment, qu’aucun des trois ne quitte le plan de la dialectique, en dépit de toutes les trinités qui les distinguent (le signe, l’appareil, le seuil). Le savant joue seulement des composants du Signe, le vrai/le faux au plus court, à un autre niveau: l’horizontal et le vertical de la matrice (en ce qui concerne Grincheux: le savoir et l’ignorance). Le boucher calcule en gain ou perte et ne l’avoue pas: il parlera de norme et d’anormalité. Le créateur projette à l’avenir son angoisse, où, par delà le choix entre une couleur et l’autre, s’affirment son horreur et son goût de la mort.
Ma chance, en ce juillet 1967, est que mes constituants ne se combattent plus mais se succèdent. Sur le chemin entre les champs, une brise légère souffle de l’est, Pigobert ayant dit ce qu’il avait à dire, Baptiste prend la relève: il s’y tiendra longtemps.
3
1984
Dix-sept ans ont passé depuis Neuville, sept de puis l’ébauche qui précède (et dont j’ambitionnais déjà de faire le Livre). Vers 1982 – l’année dernière – j’ai recommencé de collationner les pages (1980) écrites en ces sept ans et dont chaque phrase m’avait paru définitive, l’ayant récrite dix fois, sans y trouver le moindre éclaircissement de l’énigme prodigieuse.
Ces participants qui me constituaient (Pig et Bap), réels au point qu’ils avaient failli me détruire – et qu’ils le pouvaient toujours – je n’étais point parvenu, même, à les définir: lequel contenait l’autre? Lequel était le premier? Lequel mon ossature, lequel mon aspect? Lequel mon âme, lequel ma chair?
Cette entité, qu’il me fallait bien admettre (le morceau de viande rouge), la voir et la concevoir, la reproduire en entier, hors de cette saisie-là, du boucher, du Grincheux, du Barbouilleur, elle ne m’était plus que chimère. Entre l’imposture – de me dire Pig plutôt que Bap, ou à l’inverse – et l’illusion de croire que le seuil doit l’emporter sur le signe et sur l’appareil, ou le signe, ou l’appareil, sur les deux autres, je ne suis qu’un néant dans un néant: le néant d’une cohérence indiscernable dans le néant d’une distinction incohérente. Je joue de la réalité d’une inconscience dans la conscience d’une irréalité: Baptiste et Pigobert encore, au plus exact.
Pigobert gagnait, définitivement, comme à chaque fois. Oh! Le vieil homme ne chasse plus les femmes: je n’en ai plus le désir, elles ne viennent plus vers moi. Geneviève est mon univers. J’enregistre les livres qu’on me prête sans y ajouter une phrase, de commentaire ou d’interprétation. Mais, plus que jamais, je joue – éperdument, je recompose des puzzles, j’ordonne mes cartes et mes pions, je ne confonds pas le Roi avec la Reine. J’admets que je ne suis plus qu’un technicien, l’un des meilleurs pourtant, en ma partie. Corporellement, qu’il le veuille ou non, le vieil homme redevient le Baptiste de son enfance. Intellectuellement, c’est autre chose: le peu de clarté que Baptiste attend encore d’un dieu, d’autres écrivains me le donnent, qui m’ont précédé dans la Voie. J’ai recommencé de m’inspirer des maîtres: au nombre des derniers, le philosophe Bergson, l’économiste Herbert A. Simon, le seul métaphysicien conscient de notre époque, l’Allemand Heidegger.
Selon Bergson, l’homme est une machine à faire les dieux. Selon Herbert Simon, cette machine fonctionne comme un « système de symboles physiques », qui tend à la clé absolue, à l’algorithme universel. Elle a pour but, selon Heidegger, de répondre à la seule question: pourquoi cela est-il là plutôt qu’une autre chose?
Pour le premier, ce qui est s’inventorie, pour le second se nombre, pour le troisième s’évade sans cesse d’une explication dans l’autre. Pour les trois, Dieu n’est qu’un objet, mais tout objet peut se faire dieu, serait-il un morceau de viande rouge, en présence duquel Bergson serait comme le Barbouilleur, Simon comme Grincheux, Heidegger à la fois le boucher et le client (la ménagère).
Mais les trois démarches se distinguent en cela, que la première est dissociative: l’homme crée ce dieu-ci ou celui-là, puis, l’un ou l’autre, il le constitue de pièces, de morceaux, comme s’établit un inventaire: le décompte des chemises après celui des chaussettes, le recensement des caleçons après celui des gilets de corps (si l’inventaire est d’une chemiserie).
La deuxième est associative, catégorique. Elle exige l’existence d’une machine telle qu’elle ordonne d’abord ses propres parties, cet ordonnancement étant plus nécessaire à la marche à la marche de la machine que n’importe laquelle des parties. Aux notions de maintien et de complétude qui suffisaient à l’établissement de l’inventaire se substituent les deux notions de l’efficace et de l’inefficace, du pouvoir que j’ai sur l’objet et de celui que l’objet a sur moi. L’Objet n’est plus n’importe quoi, dont rendrait compte un catalogue; il existe hors de moi, et je ne puis que m’y soumettre ou me démettre (de mes pouvoirs d’abord, de mon existence un jour) si je ne m’y soumets pas.
Enfin, la troisième démarche sera tantôt disjonctive, tantôt catégorique, selon que je trouverai à ma question: pourquoi? Une réponse fragmentaire (et claire), comme dans les relations que les objets ont entre eux (le métaphysicien dit: leurs oppositions, mais c’est leur succession); ou une réponse globale (et plus confuse), comme dans la quête d’une nature commune à des objets tout différents (le métaphysicien dit: leur liaison, mais c’est, concrètement, leur simultanéité). Ces choses que je constate, sont-elles des parties, des éléments, d’un Ensemble qui les recouvre, ou ne sont-elles pas, elles-mêmes, chacune d’elles, un Ensemble, dont les autres objets peuvent être les parties, les « cardinaux »?
Toute l’histoire humaine confirme l’hypothèse de Bergson, toute quête analytique et rationnelle explicite la quête de Simon, toute l’angoisse métaphysique de l’homme pose et repose sans fin la question de Heidegger. Mais aussi, les évolutions/involutions des peuples et des empires, des civilisations et des races semblent obéir au schème trilogique qui renvoie d’une démarche à l’autre. Et l’évolution/involution des sciences, ou celle des religions y renvoient tout de même: du panthéisme bergsonien au rationalisme scientiste, ou de celui-ci à un nouveau polythéisme (quelque chose, un monothéisme parfait, qui échappe à nos trois quêteurs, renvoyant, quelque part, de quelque ésotérisme à l’autre, comme du Dieu-Tout à tous les dieux). J’y distingue les étapes, depuis mes années d’école jusqu’à ce temps où je vis, de ma quête hallucinée, selon que Pigobert a joué de contrastes afin de se proclamer ou que Baptiste en a tiré la conséquence d’une soumission absolue.
En quarante années, cinquante textes, depuis La vie impossible et « mon » éthique jusqu’au Livre qu’aujourd’hui, je crois pouvoir écrire… Si je les reprends, les rassemble et, sans doute, les recrée, c’est que je ne crois plus que l’Objet puisse se décrire, se concevoir et s’adorer sans l’approche trinitaire où m’incitent le peintre (et ses figures), le savant (et ses nombres) et l’utilisateur, ses mots, ses justifications.
Mes serviteurs fidèles, le Pig et le Bap, auraient du mal à reconnaître ici chacun son bien. Je donnerai pourtant, parfois, de leurs nouvelles, car ils ne s’oublient pas continûment, ils ne s’abolissent pas l’un en l’autre sans de violents sursauts d’amour-propre, de rage, d’incompréhension. Mais quelle culture, quel peuple, quel empire n’a pas vécu de tels conflits, du début à la fin de son cycle?
Quelle humanité n’y a survécu?
Qu’espérer de plus visible, de plus sage, de plus concret, en cette année de l’Imposture (1984) où triomphe le Grand Frère, le Big Brother, ainsi qu’il fut prévu?
Sur cela se fonder: je vis encore. JE vivra bien aussi longtemps, JE le présume, qu’il pourra jouer des Trois et des Deux – partagés, en autant de dialectiques qu’ils se dédoubleront.
PREMIERE PARTIE
Une confection d’inventaire
Le Procès
1 La complétude et le maintien
La première question sera : pourquoi traque-ton Dieu ?
Depuis quelque sept mille ans qu’ils inscrivent ce qu’ils pensent, les humains n’y ont jamais donné que ces deux réponses :
a) pour combler une absence,
b) pour maintenir en place ce qui est.
Pour les uns, Dieu complète le monde, auquel, s’Il n’était pas, il manquerait quelque chose : le Bien suprême, la Vérité ou l’inaccessible Harmonie.
Pour les autres, il assure le maintien, la maintenance – et c’est à dire la cohérence – de ce qui existe et perdure, survit à toutes les catastrophes.
C’est tout le progressisme des uns, contre, disent-ils, le conservatisme, l’atropie des seconds;
et toute la récurrence des autres, contre, disent-ils, l’entropie où se complaisent les premiers.
A première vue, bien sûr, un état de besoin fait l’attente d’une complétude. Mais, dans la complétude aussi, ou du moins dans sa satiété, s’impose l’exigence de combler quelque vide, dans une saturation d’aventure, de discontinu, ou de distendre la pression de la continuité, de l’habitude ou de la coutume, dans la saturation inverse. On ne se complait pas longtemps dans l’advenu : naît alors la notion d’un dieu patéfacteur.
Différemment, un état de non-besoin, de plénitude devrait lever l’exigence d’un dieu mainteneur, et c’est bien cette exigence qu’impose la peur de le perdre, la peur du lendemain : la croyance au dieu du pain quotidien, au Sauveur, non moins qu’au Législateur, au dieu technicien, aux Gémeaux.
Mais, dans l’état de besoin aussi, on n’aspire pas au miracle patéfacteur sans prier pour que le peu que l’on a soit préservé. Le prisonnier, qui rêve de sa liberté, exige que du moins, en attendant, lui soient laissés la couverture chaude et le broc d’eau fraîche. Le mourant, avant même le vœu de sa guérison, formule celui du soin quotidien : il accepterait mieux de mourir si on changeait sa literie.
L’une et l’autre réponse, ainsi, ne sont pas seulement liées à l’état qu quêteur, état de besoin ou de plénitude. Elles ne sont pas liées au prieur. Il faut qu’elles le soient au prié. Si elles ne tiennent pas aux modes d’être du suppliant, elles tiennent au mode d’être du supplié.
En tant qu’Etre en soi (hors de toute croyance), Dieu aurait ces deux fonctions :
a) compléter le Tout du monde, selon l’expression de Spinoza, afin que la plénitude en soit parfaite,
b) assurer la survie de ce qui existe et se maintient, par une cohérence indestructible (la Pensée de Spinoza ou l’Energie/matière/lumière d’Einstein).
Car, si le monde n’était pas toujours à compléter, il ne serait qu’ancien, advenu, mort. Mais il serait mort aussi, comme vieux, s’il perdait sa cohérence.
Une seconde question dès lors se pose : est-il possible qu’un seul être soit à la fois ce mainteneur et ce compléteur ? L’une des deux fonctions n’exclut-elle pas l’autre?
2 L’accomplissement
En toute religion, le schismatique, le chiite, l’hérétique est celui qui répond par l’exclusion. Aucune orthodoxie, aucun pouvoir central ne voudra douter :
a) que la complétude exige la maintenance, car comment passerai-je du 1/2 aux 3/4, et des 3/4 aux 4/5 si le 1/2, puis les 3/4 n’étaient pas préservés ?
b) que la maintenance exige la complétude, car on ne conserve pas une vaisselle ébréchée ou un vase en morceaux.
Non seulement l’orthodoxe ne conçoit pas un dieu qui ne soit à la fois éternel et parfait, mais il caractérise l’Autre, le démon, le dia-bole, par une éternité d’imperfections (le péché mortel, l’enfer) ou par le caractère éphémère, illusoire, de l’œuvre satanique.
Au contraire, les grands livres sacrés, le Pentateuque, l’Evangile, le Coran, d’où se tirent à la fois l’orthodoxie et le schisme, présentent toujours de Dieu et de l’Autre une approche plus ambiguë. Dans le Livre de Samuel et dans les Chroniques, c’est tantôt Dieu tantôt Satan qui persuade David de recenser son peuple. Ou Jésus maudit l’agent du scandale tout en précisant que le scandale doit venir. Dans le Coran, le dieu, Allah, permet à Iblis d’agir; il le laisse entièrement libre de pervertir les humains; et bien des chiites ne doutent pas qu’à la fin du Temps qui s’annonce, Iblis rejoindra le sein d’Allah.
En effet, le rêve constant de l’humanité est celui d’une plénitude qui se maintient : nulle religion n’embraserait des millions d’hommes si son dogme ou sa tradition ne concrétisaient ce rêve. Au contraire, tout livre sacré se fonde sur le mot – divin – qui l’interdit : accomplissement.
A prendre dans le sens double :
– ce qui se termine, finit : la fin de la maintenance,
– le plus haut point de la perfection : la complétude même.
Par la double vertu du mot, le devenu, l’achevé, le complet, ne peut que se corrompre, se détruire; et, à l’inverse, ce qui se maintient en devenir ne peut qu’être inachevé, incomplet.
Non seulement inconciliables, la maintenance et la complétude, mais ENNEMIES par excellence. Puisque la maintenance de l’incomplétude retarde l’avènement de la perfection ou qu’au contraire, l’incessante destruction, remise en cause de la complétude en interdit la maintenance.
ENNEMIES au point que l’abolition de la maintenance n’est pas une autre chose que la perfection de la complétude et qu’elles se disent toutes deux, l’abolition de l’une, la perfection de l’autre, par le même vocable : Accomplissement.
Car ils ne sont point achevés en toutes leurs parties sans l’être en leur durée : l’œuvre, le cycle accomplis. Zéro en tant que révolu, infini en tant que plénitude. Ou bien, à la jonction de ce rien et de ce tout : le Relief, ce qui demeure d’un mets, ce qui reste d’un repas, le dernier stade de la maintenance, ET ce qui s’élève et surplombe, l’ornementale saillie par laquelle, au bord de l’abîme, s’est annoncée la complétude.
Sur les deux parties en cause dans le procès universel, Dieu et le diable (ou leurs agents : l’ange et le démon), il se déduira sans peine que deux jugements seront portés :
a) la divinité ne peut être qu’une éternelle perfection; en quel cas, le diable ne saurait atteindre à aucune des deux qualités : ni à la maintenance ni à la complétude. En face de l’absolu (le Bien, le Vrai ou l’Harmonie), le mal, l’erreur ou le désordre ne peut être que la vaine rébellion de l’impuissance;
b) l’accomplissement (de la complétude) est aussi la fin de la maintenance et à l’inverse.
Si l’ange fait le maintien des choses (des Lettres, des Signes, des Cycles), le démon, qui combat cette maintenance, se présente comme l’agent du Progrès, comme le crurent, au siècle dernier, les romantiques, puis un Proudhon, un Marx, un Bakounine.
Si l’ange est perfection, le diable est imperfection, mais cette imperfection même (l’erreur ou l’ironie) est le moteur qui modifie les choses en détruisant ce qui fut ou, au contraire, ce qui survit à l’éphémère complétude : le ver éternel, renaissant dans le fruit.
c) A ces deux jugements :
catégorique : la maintenance et la complétude,
disjonctif : la maintenance ou la complétude,
Emmanuel Kant en ajoutait ce troisième : le jugement hypothétique : si Dieu est tout, le diable n’est rien et nous somme dans le catégorique; si le dieu et le diable se complètent, ils ne peuvent se maintenir ensemble, mais à tout moment l’un doit l’emporter sur l’autre, dans une alternance disjonctive.
Or, ici, le procès s’achève, puisqu’il ne comporte pas d’issue.
Plutôt, le Jugement en prend la place, qui ne fera pas un triomphe au dieu ou au démon mais qui reconnaîtra les pouvoirs et les dons, les faiblesses, les limitations de l’un et de l’autre, l’homme entre les deux, parfois, comme la balle de tennis entre les deux joueurs.
Ce jugement/fin de procès peut être celui du dieu, son ultime sacrifice. Non pas le verdict rendu par Pilate mais le mot dernier de Jésus : « Tout est accompli » : consommés, la vie de cet homme-là, et son supplice, mais aussi bien, et par là même, conduit jusqu’à la perfection le destin du dieu.
Ce peut être, au contraire, le jugement du monde par Dieu, le Dernier ou le Grand Jugement qu’annoncent tous les prophètes, « le jour où surviendra l’accomplissement du cycle, le terme de ce temps-là ». Mais, condamné à mort – en tant que démon ou esprit du Progrès – l’autre profil de Dieu acquitte, règle ses dettes. C’est lui, le mauvais côté des choses (selon Marx), qui inverse le temps et remet à zéro les aiguilles de l’horloge, pour un nouveau grand cycle. Non seulement absous, mais lui-même acquitté, déchargé du passé, déclaré non-coupable.
Que le cycle d’un dieu se soit achevé, ou que ce soit le cycle de cette humanité, de cette race, de cette culture, l’achèvement fait plus qu’accomplir les prophètes (en justifiant leurs prophéties), il accomplit le Jugement, par la condamnation du dieu ou du démon, qui, d’une autre manière, fera leur renaissance – dans le cycle suivant.

Illustration Pierre-Jean Debenat
3 Le même et l’autre
L’opinion la plus commune donne à Dieu l’Unité et au Diable (le dia-bole) l’ambiguïté, la contradiction. Mais l’étude des croyances révèle d’autres partages, quelle que soit la croyance choisie.
Si Dieu est Cela seulement, par exemple : le Bien, le Diable n’est pas moins unitaire, par exemple Ceci : le Mal. Il n’y aura Dualité, dialectique ou duade, que des deux parties ensemble.
Si Dieu se fait catégorique : ceci et cela, maintenance et complétude, le démon n’est plus rien, qu’une imperfection éphémère. La duade est en Dieu et le diable inexistence :
2 + 0 = 1 + 1 = 2.
Ni le dieu catégorique ni le dieu disjonctif ne font du démon un dia-bole; mais le premier en fait le néant, le second en fait une autre unité.
Pour que le démon soit le Diable (par exemple, le Progrès même, en sa maintenance de l’acquis, sa mémoire informatique, et sa volonté de mieux-être, de consommation accrue, de société ascensionnelle, et de complétude numérique), il faut que Dieu ne soit plus rien, comme en effet, précisément, dans les époques rationalistes, athées de l’Histoire. Alors seulement se constitue la 3è égalité, ou le 3è jugement :
0 + 2 = 2.
Le polythéisme, qui divinise les démons (et les annule comme diables), le monothéisme qui, de gré ou de force, fait du Diable un égal de Dieu, comme on le voit dans le Coran, et l’athéisme qui annule Dieu en dialectisant le démon ne sont pas autre chose que la forme métaphysique qu’une foi – ou non-foi – donne aux Trois Jugements.
Nous retrouverions ceux-ci, de même, au terme de toutes les quêtes philosophiques ou scientifiques de notre époque, comme on le vérifie par la proposition de la dialectique la plus simple : AB.
Nominativement : le Même et l’Autre.
Si je les distingue, je devrai dire que A est la chose en soi, la chose même et B, ce qui est en dehors du Même : l’autre chose.
Si je ne les distingue, il me faudra dire, soit que l’autre chose ressemble à la chose en soi, B à A : je dirai que c’est la même chose;
soit que la chose en soi se fait l’autre chose ou que A se fait B c’est à dire « autrement ».
Mais aussi, selon un autre langage, si je distingue A de B, je pourrai les localiser, comme l’un à l’est ou à l’ouest, au nord ou au sud de l’autre. Si je ne les distingue pas, ou mal, il me faudra définir ce qui fait leur cohérence, par exemple : la semblance ou la métamorphose.
C’est à dire que divers, in conciliés, je les localiserai dans un unique ensemble C; unifiés, conciliés (en C), je tenterai de reconnaître – ou seulement de dénommer, ou de nombrer – la fonction de A et la fonction de B, en tant que « même chose » l’un, « chose autrement » l’autre, ou « chose autrement » le Même et « même chose » l’Autre.
4 Partition et Parturition
Il n’est pas une définition qui ne comporte ambiguïté, duade. Il n’est pas de dialectique qui ne comporte trilogie, trinité. L’important est de s’en convaincre d’abord, avant toute quête ultérieure.
Voici le mot : partition. Il dit la division, le partage, comme de 1 en 2 ou de A en a’ a ». Mais il dit aussi l’ensemble (par exemple des parties d’une composition musicale). Car il n’y a pas de partage sans localisation des parties, ni de localisation sans un lieu, un ensemble déterminé. En héraldique, (les partitions de l’écu) et en musique se partage le mot : partition.
Une loi : le partage/partition se fait toujours dans (in) un ensemble déterminé, qui est lui-même « partition ».
Vois le mot : parturition. Il dit l’accouchement de la mère, ou animale ou humaine. C’est à dire le rassemblement en un nouvel être, un nouveau vivant, des parties naguère distinctes de l’ovule et du spermatozoïde, de la femelle et du mâle. Or, ce rassemblement se fait du dedans vers le dehors (ex ou off). Il est une mise au monde, une mise au jour.
Une autre loi.
Or, partition dit à la fois : localisation, arrangement (des parties de l’écu ou de la composition musicale) et maintenance en chaque partie de tout l’Art (héraldique ou musical).
Parturition dit à la fois « patéfaction », naissance et complétude du nouvel être.
On retrouve ici et là les deux grandes idées de Roger Caillois :
a) que la localisation fait la maintenance. « Tout se passe comme s’il existait un ordre du monde où toute chose doit arriver à sa place et en son temps… C’est le principe même de la conservation de l’univers »;
b) qu’une certaine cohérence cachée fait l’harmonie, la complétude de ce qui est : « une structure mathématique », dit Caillois, « une structure mathématique de l’univers régit aussi bien l’homme que le milieu ».
On appréciera d’autant mieux le caractère paradoxal de telles assertions si l’on se souvient de l’opinion scientiste, aujourd’hui généralisée, selon laquelle la complétude d’un ensemble est liée à la localisation de ses parties, et la maintenance, la conservation d’un être est liée à sa cohésion.
Au contraire de la localisation/partition (in), cette localisation/complétude est nécessairement extériorisation (off).
Au contraire de la cohérence/parturition (ex), cette cohésion/maintenance est nécessairement intériorisation (in).
La dialectique est devenue quadrilogie :
Yin (continu, dans la chose, in) et yang (discontinu, hors de la chose, off) la localisation,
animus (dissociatif, inconciliable) ou anima (associatif, conciliable) la cohésion plus ou moins grande de l’objet.
Mais, ici encore, j’aurai le choix entre dire : 1) que la localisation n’interdit pas la cohérence, ou que l’étude de la probabilité de position de l’objet n’interdit pas l’étude de sa quantité de mouvements, 2) que la précision dans l’étude de l’une interdit la même précision dans l’étude de l’autre, 3) que plus l’objet sera discernable, discontinu, moins il sera cohérent, continu, si bien qu’il ne peut être que l’un ou l’autre, le Même ou l’Autre, yin ou yang.
Comme la dialectique : accomplissement/inaccomplissement dédouble la dialectique première de la maintenance et de la complétude, ou comme la dialectique : conciliabilité/inconciliabilté dédouble la dialectique seconde du peuplement ( de 1 vers 2) et du dépeuplement (de 2 vers 1), c’est une dialectique d’inversion : précision/imprécision qui dédouble la dialectique troisième : localisation/cohérence. Mais, dans les trois cas, il est clair que le troisième terme de la trilogie (le 3è jugement) est nécessairement appelé par les deux autres.
Car les notions de maintenance et de complétude comportent celle d’accomplissement; ou les notions de partition et de parturition celle de sens; ou les notions de localisation et de cohérence celle de précision.
Cependant et non moins nécessairement, l’existence de la trilogie suffit à dédoubler la dialectique première (et réciproquement).
A l’accomplissement – et à son inverse – sont liées les inventions des deux parties : Dieu et le Diable;
aux deux sens de peuplement et de dépeuplement sont liées les distinctions du Dedans (in) et du Dehors (ex);
aux notions de précision – et d’imprécision – sont liées les notions de probabilité, dans la localisation, et de quantités de mouvements, dans la cohérence.
Si bien que j’aurai affaire maintenant à ces 4 :
la maintenance de Dieu, la complétude du Diable, la complétude de Dieu, la maintenance du Diable,
le partage conciliable ou sensé, le partage inconciliable ou insensé, le rassemblement inconciliable (le complexe), le rassemblement conciliable (l’ensemble ordonné),
les deux de la localisation (continu/discontinu) et les deux de la cohérence (animus/anima), dans un rapport tel que la précision des distances de localisation entraînera l’impression des instances de cohérence, et à l’inverse.
On ne se cachera pas qu’un tel jeu dialectique (trilogique dans un sens, quadrilogique dans l’autre) ne peut être qu’infini. Il correspond cependant, avec la plus grande rigueur, à ce que révèle l’étude de l’association d’idées (de figures, de nombres ou de vocables).
Si je nomme la première formulation : directe, la deuxième sera nécessairement ou inverse (noir pour blanc) ou complémentaire (remède pour la santé), la troisième sera l’inverse de la formulation directe si la deuxième a été de complément, ou le complément de la directe, si la deuxième a été d’inversion. La quatrième inversera ou la deuxième ou la troisième, en complétant l’autre s’il se peut. La cinquième ou reviendra à la première directe ou en donnera quelque analogie.
Il semble donc bien s’agir d’un processus universel, en ce qui concerne du moins l’humain.

Illustration Pierre-Jean Debenat
5 Les trois et les quatre
On dira que ces jeux de logique pure nous entraînent bien loin de notre métaphysique première. Mais quel que soit l’objet du jeu intellectuel, il est toujours la quête du jugement le plus complet et le plus constant possible. L’éphémère solution d’un problème fragmentaire n’intéresse personne ou, du moins, ni le métaphysicien ni le logicien.
Quand, donc, un Spinoza applique à la métaphysique la plus traditionnelle ( de la Kabbale) les règles les plus élémentaires de la logique « raisonnante », ou quand un Kant applique à la raison logique les principes métaphysiques les plus anciens, ils poursuivent cependant un même Objet : l’universelle éternité que serait, pour l’un Dieu accessible et, pour l’autre, une Raison inattaquable.
Non seulement l’Objet des deux quêtes n’est qu’un, mais les moyens utilisés par l’une et l’autre sont numériquement les mêmes, puisque ce sont les 4 et les 3.
Jouant des Modes et des Attributs de Dieu, Spinoza nomme les uns : la Pensée et l’Espace (invisible et visible), l’En Soi et le Tout du Monde les autres, au plan divin, mais au plan humain les 3 que sont l’Un, le Multiple et le jeu dialectique de l’Unité au Multiple et à l’inverse, ou le Divergent et le Convergent.
Dans La critique de la raison pure, Kant établit que l’objet de la quête rationnelle peut être connu, soit dans son Mode (en soi) soit dans ses Relations avec d’autres objets, puis que la Quête même peut être numérique ou non, quantitative dans le premier cas, qualitative dans l’autre.
Mais, en aucune des 4 catégories : la Modalité, la Relation, la Quantité, la Qualité, l’Objet ne peut être appréhendé par la pensée hors de cette pensée ou, pour mieux dire, hors de la croyance, hors du jugement du quêteur. Ces croyances, ces jugements sont au nombre de 3 :
catégorique, disjonctif ou hypothétique, si je traite des relations de l’Objet (par exemple comme associatif ou /et dissociatif), assertorique, problématique ou apodictique, si je traite des modalités de l’Objet (par exemple comme continu et/ou discontinu), affirmatif, négatif et ambigu (à la limite) si je traite de son aspect qualitatif,
général, particulier ou singulier si je traite de son aspect quantitatif.
Ce que Hegel, un peu plus tard, résumera par sa trilogie célèbre :
la thèse (affirmation, catégorie, assertion, généralité),
son inverse, l’antithèse (négation, disjonctivité, problématique, particularité),
la synthèse ou l’accord des deux premiers jugements, par un procédé quelconque (numérique ou non, relationnel, modal).
Ces « inventaires » de Spinoza et de Kant sont certainement parmi les plus complets, ou sensés, ou précis qui soient. Ils présentent toutefois le défaut d’imposer comme inconciliables soit les Modes et les Attributs, soit les Modes et les Relations, ne retenant comme conciliables (et même comme siège de toute conciliation) que la troisième approche de Dieu (la dialectique) dans le système de Spinoza, ou le 3è jugement dans le système de Kant. Car les choses ne sont pas si simples.
6 Eléments et Qualités
On résumera tout ce qui précède en avançant que le confectionneur d’inventaire, que d’aucuns nommeront un « inventeur de systèmes », doit faire partir son invention soit d’une certitude (A) soit d’une dialectique (AB). Néanmoins, sa certitude n’est jamais telle qu’elle ne suppose l’exception, ou bien l’esprit de contradiction jamais si fort qu’il n’exige la préférence (de A sur B ou à l’inverse).
Dès lors, le 3è jugement ne fera que relativiser les deux autres, par l’acceptation de l’exception ou l’exigence de la préférence. Ce ne sera plus : oui ou non, mais : peut-être. Non plus la catégorie ou la disjonction mais l’hypothèse. Par exemple que, dans tel cas, les probabilités de conciliabilité l’emportent (vers le catégorique) et/ou dans tel autre cas, les probabilités d’inconciliabilité (vers le disjonctif).
C’est ce qu’on voit dans les figures où Leibniz allie et oppose l’une des plus vieilles quadrilogies ésotériques de l’humanité, celle des Eléments, et la quadrilogie très rationnelle des Qualités d’Aristote (Ars Magna).
Sur un double cercle – tout hypothétique – le philosophe mathématicien localise les Eléments aux cardinaux, les Qualités en diagonale, révélant de la sorte leur conciliabilité d’une part, leur inconciliabilité de l’autre.
De fait, la quadrilogie des Eléments comporte 4 cas de disjonctivité :
ce qui est humide n’est pas sec,
ce qui est froid n’est pas chaud,
pour 4 cas de liaison catégorique :
l’objet peut être humide et froid,
chaud et sec,
froid et sec,
humide et chaud.
C’est d’ailleurs cette préférence donnée au jugement disjonctif dans les 4 Eléments qui les donne pour ésotériques, mythologiques, mythiques. C’est cette préférence donnée au jugement catégorique dans les 4 Qualités qui les donne pour rationalisées, scientistes : personne ne considère le système qu’inventorient Aristote et la Thermodynamique comme un inventaire religieux (bien qu’il soit également le fondement du Coran).
Car l’expérience la plus commune démontre qu’en effet :
le froid réduit le volume et le chaud l’accroît,
l’humide associe et le sec dissocie (des grains de sable).
Selon Kant, aux Qualités s’opposent les Quantités (plus ou moins grandes, plus ou moins associatives); aux Modalités (yin ou yang) de l’Objet s’opposent ses Relations (associations/dissociations). Mais je ne jugerai des unes ou des autres, des unes et des autres, des unes ou/et des autres que par l’un des 3 jugements, disjonctif, catégorique, hypothétique.
Une application de ce système sera que, si je considère les 4 comme surtout disjonctifs (les Eléments), les 3 seront essentiellement catégoriques, et/ou à l’inverse, pour qu’une complétude soit maintenue ou le maintien mené à sa perfection.

Illustration Pierre-Jean Debenat
7 Complétude, opacité, récurrence
Un certain ésotérisme – universel – dit et répète :
a) en tant qu’il complète, le dieu (panthéiste) est toujours l’un des 4 – localisés :
de Feu, si les trois autres sont de Terre, d’Eau et d’Air, ou l’un de ces trois autres,
du Risque, s’ils sont de Combat, de Vertige et de Mimecry, ou l’un de ces trois,
du domaine de la Musique (du Rythme), s’ils sont de la Topologie (comme Figure), de l’Arithmétique (comme Nombre), de l’Astrologie (comme Signe nominal), ou d’une autre des trois sciences,
plus simplement à l’Ouest, l’Est, au Nord, au Sud, si les trois autres occupent les trois autres cardinaux;
b) en tant qu’il maintient, le dieu (monothéiste) est à la fois les 3 – conciliés en cohérence,
comme les 3 dimensions dans le volume,
les trois arts ou techniques humains : grammaire ou je-moi, dialectique (je-toi), rhétorique (je-lui),
les trois personnes, par suite : le Père, le Fils, l’Esprit (ou Brahma, Vichnou et Civa),
les trois « natures » de Bolos et de l’hermétisme préchrétien (trismégiste comme il se doit),
les 3 facteurs de la durée : le devenir, l’instant et le devenu, etc.
Mais ce partage n’est démontrable que dans l’hypothèse où la localisation reconduit à la complétude, et la conciliation à la maintenance.
Il ne l’est plus dans la conception de Caillois. Or, cette conception est moins rare qu’il semble.
Ce seront alors les 3 jugements qui se feront inconciliables : je ne puis en même temps dire : oui, non et peut-être, ou juger catégoriquement, disjonctivement et hypothétiquement,
ou les 3 temps qui s’excluront l’un l’autre, comme le Passé est un autre temps que le Présent ou le Futur.
A cette localisation des 3, plus logistique qu’ésotérique, mais qu’appliquèrent cependant un Proclus, un Saint-Augustin, se marie et s’oppose à la fois la cohérence quadrilogique des Qualités, où le catégorique prime la disjonction, et sur laquelle se fonde de fait toute la quête du fanatisme systématique (ou religieux ou scientiste). S’y reconnaissent les 4 tempéraments d’Hippocrate (interactifs) ou les 4 comportements de Laborit (quand les 3 cerveaux sont distincts et localisés).
C’est que, pour résoudre de tels problèmes, scientifiques ou théologiques, logistiques ou métaphysiques, il ne suffit pas qu’une réponse soit possible ou cohérente, dans le mode d’être du dieu choisi (de telle croyance); il faut qu’aucune autre ne le soit, en cet ensemble défini. Les uns rejetteront toute solution hasardeuse, contingente, au profit de la seule « nécessaire », comme Kant. Les autres écarteront toutes les solutions que suggère le besoin, la nécessité, au profit de la seule qui s’inscrive dans l’ensemble complet, « contingenté ».
Mais si l’Ensemble est aisément dépouillé, ou éclairci, par l’épouillement, l’épellation de ses parties, la Fonction nécessaire, née du besoin, du manque, fait intervenir des facteurs obscurs, dans l’opacité du revêtement, de la révélation matérielle. Interviennent les notions de Jeu (dionysiaque) dans l’invention de l’ensemble contingenté et de Drame (prométhéen) dans l’appréciation du manque et du besoin, de la nécessité première, qui inverse, bien sûr, le conflit de Marsyas (la tragique contingence faunesque) et d’Apollon (le divin ordre nécessaire). Quand Apollon (l’unité même de l’univers) retombe en Prométhée (sa promesse), le faune Marsyas remonte à Dionysos.
Rappelons les légendes. Le dieu de la perfection et le satyre faunesque rivalisent au jeu de la flûte, où le dieu ne peut que vaincre. En châtiment Marsyas sera dépecé, dépouillé de sa peau et vidé de son sang. En ma jeunesse, je voyais dans ce conte le récit du conflit éternel entre le génie maladroit, romantique, torturé et le talent souverain de l’esthète, de l’homme des formes et des mots, du Joueur superbe. Toujours est-il qu’ici tout joue de l’Accomplissement (perfection et triomphe pour Apollon, supplice et mort pour Marsyas). Mille ans après Orphée (inventorieur du mythe), les deux héros de l’Accomplissement ne se combattent plus, aucune tradition ne les oppose l’un à l’autre, mais quand un tragique grec chante l’un, il se trouve qu’il ne chante pas l’autre : l’homme de la promesse, Prométhée, que les vautours dévorent sur son rocher, et le dieu de la métamorphose, Dionysos. Prisonnier le premier, de la nécessité, de la fatalité; libre, le second, de toute attache, véritable seigneur de la Contingence…
Non seulement ils ne se combattent pas, puisqu’ils s’ignorent, mais ils oeuvrent dans le même sens. Au terme des deux quêtes est le même Graal, dont le symbole apparaîtra vers l’an 500, mille ans après les mythes d’Eschyle et d’Euripide.
Le jeu ne sera plus entre la complétude et la maintenance, ni entre l’éternelle souffrance du Supplicié et la mue toujours neuve de l’ancien Bacchus, mais il se jouera encore entre un Contenant (le Vase lui-même) et son Contenu (le Sang). C’est à dire que les trois couples : Marsyas/Apollon, Dionysos/Prométhée, le Vase et le Sang, se fondent sur trois dialectiques bien distinctes, recréeront pourtant toujours la même, dont la clé pourrait être le verbe : récurer ou le mot : récurrence.
Littéralement, Marsyas est récuré, de même que Prométhée plus tard, tout comme le Vase vidé du sang c’est à dire le Graal cistercien. Parallèlement et inversement, c’est de la Forme Nue d’Apollon au Sang du Christ que procède l’autre évolution (comme de la mort du Roi à son renouveau), par les mutations, faussement tragiques, de l’éternel Nouveau, le dix fois né.
Apollon dépèce récurrence du supplice le Vase
Marsyas ——} mues de Dionysos ——-} le Sang
Le récurage du maladroit (tragique) fait la récurrence, l’éternel retour du lacérage prométhéen, jusqu’à ce que la Forme, le Vase soit entièrement récuré, vide. En un cheminement inverse à ce drame tout humain, le dieu Bacchus-Dionysos a reconduit de l’antique Apollon au nouveau Graal ou Verseau, du dieu de Feu au dieu d’Air, ou de la souveraine Forme de l’Arche au Sang de l’autre martyrisé : le Christ.
En même temps que joue le mot : récurrence (comme, naguère, le mot : accomplissement), dans l’homonymat, il ne serait pas impossible de jouer – en inverse synonyme – de récurage (qui vide) et de récupération (qui remplit), comme naguère de « partition », qui partage, et de « parturition », qui rassemble.
En ces notions intermédiaires, de « peuplement » (partition ou partage, découvert ou découvrement, vidange) revivent naturellement les 4 Qualités : le Chaud, qui augmente le volume, et le Sec, qui répartit, le Froid qui réduit le volume et l’Humide qui rassemble et peuple. Mais, surtout, se reforment les Figures dont se confectionne un Inventaire.
Le jeu est moins gratuit qu’il semble (le Jeu des dieux). Il exclut tout à la fois l’imposture du scientiste et celle du théologien. Car n’est-ce pas pourquoi les doctrines contraires de la récurrence et du progrès non seulement ne se concilient pas mais ne se joignent pas en un « ensemble fonctionnel » ? Le recouvrement qui les révèle (ou revoile) interdit leur épellation ou dépouillement. Leur mise à découvert, leur découvert comptable, interdit qu’on puisse les recouvrir d’une révélation commune.
Le scientiste fonde son progressisme sur « les mêmes expériences répétées dans les mêmes conditions », c’est à dire sur la Même Chose et sur l’éternelle récurrence.
L’utopiste théologien fonde son éternel retour du (dernier) dieu – aujourd’hui de Jésus, le Christ – sur un renouveau de toutes les valeurs dans l’Esprit, le Saint-Esprit, le Paraclet, sur la venue d’un Christ autrement, non plus victime mais vainqueur, etc.
Or, c’est à dire que par delà (ou « en deçà ») les dialectiques du Même et de l’Autre (du dieu ou du démon) ou du Progrès et du Retour, ni le précis éclaircissement du scientiste ne peut éclaircir toute l’opacité du réel, ni le mystérieux recouvrement du dogmatique religieux ne recouvre en effet le besoin d’éclaircissement de l’homme.
L’épellation logique échoue ici non moins que la révélation métaphysique. Apollon torture en vain Marsyas, et Prométhée aussi se laisse torturer en vain. Ni les nombres du scientifique ni les mots du spiritualiste, ni la Quantité ni la Qualité de Kant n’inventorient vraiment l’univers en question, en cause – le nôtre.

Illustration Pierre-Jean Debenat
La Figure
1 Pourquoi un inventaire ?
IL se peut, en effet, que Bergson ait raison et que l’homme ne soit qu’une machine à faire des dieux. Mais nous devons admettre qu’à l’inverse, ce sont ses croyances qui font l’homme. Ce qu’il crée, il lui faut prétendre le connaître, l’avoir appris et oublié : d’où, le recours aux mythologies, aux légendes, aux livres sacrés. On ne croit pas cela que personne d’autre n’a cru.
Ou ne puisse croire, par la vertu de l’observation, de l’expérience…
D’où, la puissance des grandes religions partagées par le plus grand nombre d’humains.
Mais, par delà le texte et le nombre, on croit d’abord en ce qu’on voit, comme le montre avec éclat le morceau de viande rouge.
Si étrange qu’en puisse être l’idée, ni le savant, ni le peintre ni le boucher n’ont considéré cet objet en soi. Le peintre l’a observé en tant que figure, soit en sa forme, éventuellement géométrique, dans le cas d’un peintre abstrait, soit en sa couleur sinon, plus subtile, les rapports qui se nouent entre lumière et forme, les « caustiques » que trace en celle-ci celle-là.
Le savant a calculé – d’instinct en quelque sorte – les constituants de l’objet en ce moment de sa durée. Eventuellement – s’il est médecin par exemple – il a déduit de ses calculs les effets probables ou possibles que le morceau de viande aura sur l’organisme humain, mais toujours au terme d’une certaine durée, en fonction de ses constituants, par le jeu statistiques d’autres nombres.
Le boucher l’a nombré de même (en termes de profit ou de perte) et de même il a considéré sa forme et sa couleur, même si, faute de la science et de l’art nécessaires, il utilise surtout des mots, qualitatifs et informels, pour en parler. Avant que d’en parler, il aura pensé en termes vocatifs : bavette ou steack, première fraîcheur ou pourriture.
Plutôt qu’ils n’ont appréhendé le morceau de viande rouge en sa structure, les uns et les autres n’ont fait que son procès : esthétique, scientiste ou utilitaire, en réduisant l’objet à l’un de ses aspects : par la figure, le nombre ou le vocable.
Le tableau, le système et le lexique, dit Oscar Wilde. Et Caillois : l’élémentaire, le chiffre et l’alphabet. On reconnaîtra aussi les 3 grands jeux de la Kabbale depuis Abraham Aboula fia : la ghémétrie, qui joue des nombres, le notarikon, qui joue des lettres, la temoura qui les dispose, nombres et lettres, en des figures plus ou moins simples ou compliquées. Mais que sont d’autre les mandalas, tant hindouistes que bouddhistes, sinon les jeux d’un certain nombre de figures, dotées nominalement de certaines « qualités » ?
La même démonstration, ainsi, que pour le morceau de viande rouge se pourrait faire, quel que soit l’objet en question : toute couleur a son nom, son nombre (sa longueur d’onde) et sa dimension : celle de la figure qu’elle occupe. Un autre nombre (la fréquence) définit une note de musique, que nomment le si ou le ré et que figure, entre autres, la » portée « , en cette clé ou cette autre.
Or, on pourra dire que la peinture ou la musique, l’ésotérisme des mandalas, celui des kabbales, l’art d’Oscar Wilde, la science de Caillois ne sont pas que des inventaires, non plus que les approches du peintre, du savant et du boucher quant au morceau de viande rouge.
Mais, en tant qu’ils seront inventaires, les uns ou les autres – c’est le point – n’auront joué que des figures. Et, de même, l’inventeur de dieux, qui d’abord les inventorie.
A première ou courte vue, un inventaire participe de « cette admirable volonté de ne rien séparer ni exclure » dont Albert Camus fait le souci privilégié de Prométhée. Il englobe caleçons et chemises, chaussettes et bas dans le plus vaste ensemble catégorique qui se puisse trouver (ou remplir d’étoiles et de planètes, de galaxies et de quasars, de comètes et de trous noirs, l’ensemble astronomique, etc.).
Mais aussi, contradictoirement, il n’accouche que cet ensemble-là : une boutique de sous-vêtements ou le cosmos. Il est alors d’abord, rupture, exclusion de ce qui n’est pas un sous-vêtement, un corps céleste (ou une chose rouge dans un ensemble de choses rouges, une figure géométrique dans un ensemble de telles figures), comme par l’effet du jugement disjonctif le plus rigoureux.
D’une certaine manière, si le Nombre accumule, le Vocable retranche. L’inventaire peut bien jouer d’autant de choses rouges qu’on voudra, mais seulement de choses rouges… Fondé sur les 4 Eléments, il ne se fondera pas sur les 4 Qualités, et c’est ici le troisième jugement, hypothétique, qui décidera du conciliable ou de l’inconciliable : puis-je inclure l’orange foncé dans les rouges, ou la cravate dans l’ensemble des sous-vêtements ?
Mais ce qu’ont peut dire avec assurance, c’est que l’exclusion concerne l’autre chose, la chose étrangère, dénommée différemment ; elle concerne aussi la chose même, la chose en soi, car il n’y a pas, en aucun ensemble, deux être identiques, deux brins d’herbe semblables. C’est-à-dire que l’inventaire ne recense que des mêmes choses, en nombre indéfini ; plus précisément, des choses de même aspect, de même apparence… de même figure.
L’INVENTAIRE utilise le vocable et le nombre. Il recensera 10 potiches, 30 plats, 200 assiettes. Mais il ne recueille que des figures, comme le mot lui-même le démontre.
2 La définition
Comme tout objet, un mot se dé-finit, se limite à son à son origine et ses fins. En tant qu’objet utilisable, il se borne aussi à son usage, au moyen de l’utiliser. Examinons, l’une après l’autre, ces trois limites.
a)
Originellement, inventum fut le super d’invenire, venir dans pour trouver. Quelque chose de ce sens primaire subsiste en de nombreuses expressions, généralement archaïques ou procédurières.
L’idée d’entrer (ou non) en possession de… se retrouve dans : « sous bénéfice d’inventaire ». En ressort aussi l’idée d’un trésor, « découvert » ou « recouvré » – l’héritage – qu’il est en question d’accepter, de recueillir, ou de refuser, d’exclure, comme en tout inventaire. Car on peut ne découvrir qu’un héritage de dettes, et entrer en faillite; on peut ne recouvrer qu’un habit de forçat, une peau de lépreux, le visage d’un condamné à mort, le recouvrement se fait recouverture, piège, prison, agonie.
b)
En sa finalité, ce sera donc connaissance, reconnaissance d’un gain (le recouvrement) ou d’une perte (le découvert), au terme d’un cycle donné : inventaire de fin de mois, de fin d’année. Le recouvrement se fait un chevauchement, non plus le gain mais la perte (de discernabilité); le découvert se fait une marge, non plus la perte mais le gain (la découverte).
Le petit comptable, le professeur d’université croit volontiers que le gain préférable est celui de la clarté, du dépouillement. « D’abord, dit-il, y voir clair ». Le grand homme d’affaires, comme l’inventeur, ressent – plutôt qu’il ne le sait – les vertus de l’opacité, qui recouvrent et où l’on recouvre le réel le mieux caché. A l’inventaire il préfère le bilan, le jeu de nombres, qui passe le jeu de figures d’aussi haut que la révélation passe l’épellation.
c)
Ce sera aussi, enfin, comme nous l’avons vu d’abord, le moyen de dénombrer, de disjoindre dans le rassemblement, les mêmes figures, et d’exclure, par ce jeu des semblables, ce qui ne ressemble pas, ce qui est autrement.
Jusqu’à cette définition dernière : l’état des lieux (avant d’entrer dans un nouveau domaine) ou des biens (avant de s’en dessaisir), avant l’emménagement ou la saisie.
Dans la quête, soit de l’aventure, de l’inattendu, du possible, de la découverte possible, soit de ce qui reste de l’aboli ou du maintenu, de l’éventuel recouvrement comptable. Par le choix – libre ou non – du détour ou du retour.
Mais toujours, alors, à certaine distance de ce qui fut quitté, à découvert, perdu, dans l’espoir, l’utopie d’une autre découverte; ou de ce qui sera retrouvé, regagné, recouvré, le même (la même chose).
Dans les trois acceptions, l’inventaire s’avoue d’un ordre topologique. Qu’il s’agisse de trouver (dehors) ou de venir dans, de tendre au discontinu, à une épellation, ou de tendre au continu, à une révélation, de découvrir au terme du détour ou de recouvrer par le retour, selon le sens choisi du Temps, ou le progrès ou la récurrence.
Hors des définitions ici, des limites et des seuils, de complétude ou d’achèvement, mais encore dans l’inachèvement de la maintenance et de l’Histoire…
3 Histoire des inventaires
Je ne m’attacherai pas à décrire toutes les Figures inventoriées par les confectionneurs depuis les dernières glaciations (laissant à nos paléontologues le soin de remonter plus haut), car elles sont certes innombrables. Elles recouvrent pourtant un nombre restreint de croyances.
Certaines créent de grands dieux, d’autres des dieux moindres, et cette distinction déjà fait inventaire, car les seconds se retrouvent contenus dans les premiers, comme de petits cercles dans un grand, ou comme le Carré contient quatre carrés au quart aussi bien que les quatre triangles égaux (la base de chaque triangle égale aux côtés du petit carré), d’où Pythagore tira son théorème.
Sur les 6000 ans qui inventorient les figures géométriques, je dirai le dieu étranger, phénoménal ou humain. Mais sur 12000 ans, depuis les dernières glaciations jusqu’aujourd’hui, le Dieu fut sans doute phénoménal, humain puis étranger (en tant que dieu étranger), puis étranger, phénoménal, humain (en tant que phénoménal), il est aujourd’hui pour les uns humain – le Christ ou le Bouddha – pour les autres étrange étranger (le Libre Esprit ou l’Esprit Saint), pour les autres encore, plus loin dans le Futur, de nouveau phénoménal, aérien ou terrestre mais toujours féminin, ou anima ou yin. Au moins ETRANGE HUMAIN pour tous.
Je dirai A,B,C en 1,
C,D,E en2,
E,F,G en 3,
N’inventoriant ainsi que 7 ensembles de figures sur bien d’autres possibles. Mais il n’est pas temps de parler des 7, que le simple inventaire ignore.
1- De la caverne à l’arche : le voyage
A)
Il y eut des temps où la Figure fut liée au lieu de séjour. Ce lieu-là : montagne ou grotte souterraine avec ses salles successives (le parcours à l’intérieur). Ou ces divers lieux : la grotte de la Vierge ou de la Fée, sans autre peinture que la tache de noir ou d’ocre au creux de l’anfractuosité symbole, et, loin de là, les salles de l’Aurochs ou du Lion, le parcours, extérieur, menant d’un lieu à l’autre.
B)
Du lieu sacré, orné pour être visité, à la diversité des lieux, situés et disposés pour une autre visite, nous passons aussi bien de la « pierre levée » aux grands parcours indiens d’Amérique ou des Bantous d’Afrique : du lieu de rencontre à la Roche du Mariage, de celle-ci au lieu d’arrivée, à travers les 7, 8 ou 9 étapes, de longueurs inégales, que signalent des Roches ornées différemment.
C)
Mais c’est également du lieu et du voyage que jouent les grandes quêtes qui traitent d’un déluge et d’une arche (du livre sumérien de Gilgamesh à l’aventure du Noé biblique). Ici et là, le voyage est seulement nombré (en nombres de jours et de nuits), la figure du lieu, l’arche, est à la fois nombrée, c’est-à-dire mesurée, et ornée – par les animaux logés aux divers étages et dans la longueur, de la poupe à la proue.
Parfois, comme dans le Livre de Gilgamesh, d’autres voyages du roi précéderont la description de l’arche, et la suivront, jusqu’aux enfers. En ce cas, l’ensemble du voyage constituera lui-même une autre Figure, cardinale : du sud et de l’est vers l’ouest et le nord, en la quête du primitif Noë.
2- De la croix cardinale aux deux cercles : l’Ambivalence
Une même symbolique d’errance hantera les sages de Babylone (on pense à Outoul-Enlil vers -2000), puis les sages grecs, mille ans plus tard. Enlil ici, ou bien Eole dans l’Odyssée, rappelleront les dieux du Vent de l’épopée sumérienne. Ils seront les Elohim ou la voix d’El, le père de Iahvé, pour Abraham d’abord, puis pour Moïse. Une autre arche se retrouve, terrestre, au cœur des entretiens divins, une autre Figure, ou bien la même, non moins précise en son ordonnancement.
Les cardinaux ont fait le lien des quêtes ouraniennes à l’Arche. Ils ont partagé en figures égales les 4 voyages d’Abraham ou en une pareille partition les « ordres de marche » des Tribus, établis par Moïse lui-même.
Plus tard, ce seront encore les cardinaux qui régiront le périple d’Ulysse, de l’est à l’ouest, et du sud au nord, de la mer Egée à l’Océan Atlantique nord, puis des îles fleuries de l’Atlantique sud à l’Ithaque retrouvée (plein est). Ils ordonneront le partage de la Terre Promise entre les 12 Tribus avant que de figurer, Pour Ezéchiel, les portes de la Jérusalem nouvelle.
D)
Mais, déjà, dans ces quinze siècles qui se prennent de Tab Outoul à Ezéchiel, une autre figure que cardinale a formulé le Grand Inventaire, d’autres dieux que le Souffle et l’Archer(ou l’Arc) l’ont régi.
La Vierge ou l’Ea Première (chèvre à queue de poisson) ou Rhéa ou Ghéa, l’ancienne divinité de nouveau honorée, est déesse et terrienne. En Chine, dans l’Inde, plus tard en Egypte et en Grèce voient le jour des ensembles topologiques qui tendent à recouvrir le monde connu, la Ville en étant le centre ou le moyeu autour de laquelle s’irradient, comme des rayons, d’autres villes-parages (généralement 12) ou, au contraire, comme dans les anciennes Babels, la Ville étant l’enceinte à l’abri de laquelle s’accumulent les trésors.
Plus tard, d’autres figures symboliseront le vide et le trop plein : la colonne ionienne, avant la corinthienne mais après la dorienne, depuis la nudité jusqu’à l’ornemental, la fleur et la volute. Mais la symbolique des deux Villes n’abandonne pas les confectionneurs. D’Ezéchiel en son Livre jusqu’à l’Apocalypse de Jean, la Babel, Babylone, « encombrée de marchandises et de marchands, mangeuse de viandes » s’oppose à la Jérusalem Nouvelle, que traversent les Quatre Fleuves et que recouvrent les seules ramures de l’Arbre aux 12 fruits. Quinze siècles après Ezéchiel, ce seront l’Enfer et le Paradis de nos Mystères médiévaux (aujourd’hui seulement la Cour et le Jardin de nos théâtres bourgeois).
Mais, tandis que s’amenuisent les figures citadines, d’autres figures ont vu le jour et connu d’autres mues.
Primitivement, peut-être, les Cercles furent chinois : ils président au premier Yi King, sous les noms de « ciel antérieur » et de « ciel postérieur », car l’une des roues tourne en sens inverse de l’autre. Chacune porte les 8 trigrammes, et les rencontres des deux cercles élèvent ce nombre à 64 hexagrammes (8×8).
A l’époque où, selon la Tradition, Confucius procède à la dernière refonte du Livre des Mutations, Pythagore complète mathématiquement une nouvelle approche de l’univers, par l’invention du nombre d’Or, et s’opposent les deux prophètes, Héraclite et Parménide, dont Platon, un siècle plus tard, tentera de concilier les vues.
Ce sera par les deux cercles encore : celui du Même (le yin chinois, le continu de Parménide) et celui de l’Autre (le yang, le discontinu héraclitien). Comme les orientaux, axés en sens inverse et plus moins sécants, selon des degrés de pénétration que tente de décrire le Timée.
Mille ans plus tard, le Même sera devenu l’humide, puis le Mercure, puis la Substance, l’Autre sera devenu le sec, puis le Soufre, puis la Forme, par l’évolution des Teintures (des étoffes, des métaux) à la magistrale alchimie.
3- De la Kabbale à Yeats : le Dépassement
E)
Aucune des duades précédentes n’a exclu la quête d’une trilogie. Aux deux cavernes ou aux deux villes s’adjoint le parcours de l’une à l’autre; de même pour les deux villes. A la Demeure de Dieu et au Parvis s’adjoint le Temple même, que figurent les branches du Chandelier. Ezéchiel n’a pas opposé l’antique Babel à la Jérusalem nouvelle sans suggérer les parcours – des plus complexes – qui mènent de l’une à l’autre. Ce sont aussi les chemins de la Semblance entre les Visages, bestiaux et païens, et les Roues des anges, en sa vision.
Par le Sepher Yetsira, la première Kabbale recueille l’héritage de Moïse et d’Ezéchiel : sa Figure reproduit celle du Temple de toile; ses Lettres-mères, Aleph, Shin et Mêm (A, U, M chez les Brahmanes) symbolisent la Roue, le Cœur et les Visages du Dragon. En alquimique science ce sera le Mixte, plus tard le Sel, entre le Mercure/roue et la sulfureuse figure.
Or, c’est ce 3ème élément ou facteur, toujours, qui prime sur les deux premiers, relance le mouvement et change la figure : Voyage, quête, flèche de l’Archer, Semblance d’Ezéchiel ou Sécante de Platon.
Quand, au 16ème siècle, Basile Valentin ou Paracelse inventorient le Sel, ils transforment l’alchimie en chimie; ils remplacent la roue et le visage par la « droite libérée ».

Illustration Pierre-Jean Debenat d’après une gravure de Paracelse
F)
C’est en 1536 que, selon Paracelse, le Serpent, le Sator/soter, quitte les roues que ses reptations faisaient mouvoir (selon la 1ère figure de la Prognostication). Ce sera, de fait, dix ans plus tard, lors de l’ouverture du concile de Trente. En la soixantaine d’années qui suivent, vingt prophètes de première grandeur, de Thomas More à Campanella ou d’Erasme à Kepler (tous les Rose-Croix) auront forgé la nouvelle République, la nouvelle Utopie, conçu toutes ses machines et mécaniques, comme Scève, décrit sa quête rectiligne, négatrice de l’éternel retour, annoncé ses merveilles : l’ambitieuse médecine, les pas de l’homme sur la lune, ses redoutables armements…
Mais, d’une autre manière, cette terrible utopie, que fonde l’Observation de Campanella, ou cet « Eloge de la Folie », que, trois siècles plus tard, confirmera l’entropie de Clausius, elles n’arrachent pas l’Inventaire aux figures. Simplement, celles-ci ont changé, une fois de plus.
A la Queste forestière de Merlin le Fou ou de Gauvin ou de Perceval, les vains quêteurs du Graal, a succédé la chasse du prince, du fils de Roi, Galaad. Le Vase s’est révélé, vide et tel que son contenu devra gréer à chacun, non plus seulement empli d’on ne sait quel Sang Réal (réel, du Christ, ou royal, qui sauvera le Roi).
A l’inventaire soigneux mais fixé une fois pour toutes, de l’alchimie et de la quête chrétienne, succède un dépassement tout différent, dans le sens « insensé » que Dieu propose, impose à l’homme, selon le Coran. Non plus le Pélican qui verse, renverse son eau sur le grain/matière première pour en faire une salamandre, mutante en ses mille couleurs, mais le Phénix, en son envol imprévisible, selon Nuysement, poète rose-croix.
Cette espérance met un terme non seulement à l’alchimie mais à toutes les figures marines, de même fondées sur l’eau.
G)
Très souvent, la Figure s’impose en ses débuts, la formulation de l’Inventaire, puis en sa fin, son accomplissement, à le veille de disparaître. Tels furent les Cavernes, les Arches, les Cités, les Cercles. Telles furent les figures de l’Eau, dont l’origine, toute légendaire, remonte au Poisson/dauphin de Delphes, à la Baleine de Jonas, au Poisson de Tobie, au Né de l’Eau (Narayana) des Upanishad indiens (vers 700 avant J.-C.). Elles ont survécu, bien sûr, pendant toute l’ère du Bouddha ou du Christ, de Tonapa, l’homme au radeau de couleuvres, en Amérique du sud : pêche miraculeuse, multiplication des poissons, marche sur l’eau domptée… Ce sont ces figures marines que Jésus traçait dans le sable avant de sauver la femme adultère, puisque c’est au bord de la fontaine qu’il délivre la Samaritaine et que le lavement des pieds est son dernier message dans l’évangile de Jean. Comme c’est la rivière ou le fleuve merveilleux (le Gange) que fait sourcer la flèche du Bouddha. Le premier Mérovée naît de l’eau.
Quand Christophe Colomb navigue vers l’ouest pour atteindre l’est, il sait et dit que le Soleil se lève à l’Est et que là-bas s’élève le seul Paradis, mais que le réel est circulaire et que, pour atteindre cet Eden, c’est vers l’Ouest qu’il faut aller.
Or, à l’Ouest n’est que l’accomplissement des figures marines. En la fin du symbole vont surgir cent ouvrages qui diront la fin monstrueuse du Léviathan (Hobbes), du Grand Poisson (Hemingway) mais aussi de la Baleine Blanche (Melville). Vingt siècles de voyages maritimes s’abolissent dans le Temps qui sépare le Bateau Ivre du Bateau Lit. Rimbaud-Jarry : les trente dernières années du 19ème siècle.
Un autre cycle s’ouvre en cette fin, comme de l’Arche-bateau à l’Arche-temple, ou comme de la Teinture des métaux à l’Alquimie (par les ésotérismes de l’Assyrie, puis de Rome). Mais avant que d’en décrire les nouvelles Figures (célibataires, selon Carrouges), il convient de prendre un peu de recul, pour en dire l’inanité.
4 Le Motif et le Joint : l’Inversion
L’inventaire est figure, mais comment en parler, si ce n’est avec des mots?
J’ai longtemps recherché le terme exact, celui qui limite aussi rigoureusement qu’il signifie. On ne recense pas un inventaire avant de l’avoir confectionné; on dit rarement : confectionner un inventaire, on dit : le dresser, et dans ce but déterminé : recouvrir, englober un exercice (généralement, le cycle d’une année).
Pourtant les vocables : dresser, exercice, ne sont pas moins polysèmes que « relief » : ce qui reste, ce qui s’érige, ou « parade » : ce qui défend, protège (le parage) et qui expose les ornements, les parures.
a) En un sens, le dressage et l’exercice sont des actes similaires. Ils signifient tous deux : enseignement, instruction, apprentissage. On dresse ou on exerce un cheval, un élève.
C’est à peine si « dressage » tourne plus vers l’élévation ou l’élevage, car « dresser » c’est toujours « élever », et, par suite : corriger, remettre droit, tirer un trait (dresser un plan); par extension encore : arranger, aplanir, construire, mettre en place;
et si « exercice » indique plus précisément de certains mouvements, une certaine conduite, soit une application concrète (l’exercice d’un métier), soit un progrès moral, abstrait, comme l’exercice spirituel de Loyola et de ses jésuites, car l’exercice demeure lié au processus même du cycle : instructif, il ne peut être qu’un ensemble de mots, de gestes, un rituel.
b) Au contraire, s’ils ne sont synonymes, les deux mots n’ont rien en commun. Le dressement est de l’espace, l’exercice du temps. Le premier tend à surmonter, à surplomber : il est une érection. Le second tend à conserver, à maintenir, tout le temps du cycle, sinon d’un cycle à l’autre.
Or un mot exprime à la fois ce qui s’érige et surplombe, ce qu’on admire de loin, le relief et la parure. C’est le mot : Motif (au sens de « figure », car ce peut être « motivation »).
Et un mot exprime l’idée de continuité – d’une durée – et de continuation d’un rituel : le mot : Joint, jointure dans le monde physique, jonction dans l’abstrait.
Si toute Complétude n’est que le Contingent des Motifs, toute Maintenance se fonde sur la nécessite du Joint. Dressage (ou Dressement) est la première quête, depuis le besoin/motivation, et la « nécessité » encore. Exercice est la deuxième quête, depuis la contingence des axiomes jusqu’à cette nécessité/foi.
On sait que le motif (et la motivation) se fonde sur le semblable, l’analogie, la « même chose ». Pour quoi les motifs sont pour le moins doubles, dans une architecture ou des deux côtés de la cheminée. Le motif a pour mobile de se répéter, serait-ce le motif musical. Au contraire, le joint unit des objets différents ou des « choses autrement », ceux en qui la similitude n’a pas créé déjà une connivence.
C’est dire qu’il existera deux façons d’inventaire : l’une qui se fonde sur les mêmes choses, les « équivalences », comme si, entre diverses croyances, je rechercherais la similitude qui les recueille toutes en un seul dieu : l’inventaire monothéiste. L’autre, qui se fonde sur les différences – entre des figures successives, nécessairement, mais disposées dans un tel « ordre » que cet ordonnancement leur est une jonction suffisante (les jours de la semaine, les mois de l’année, les signes de l’ère).
Or, si je considère les figures ou comparées ou ordonnées par l’homme depuis la dernière glaciation, je dois constater que :
A) le processus d’enroulement qui associe – toujours paradoxalement – deux divinités en une interdit toute précision dans le calcul de leurs probabilités de position, en tant que motifs, sinon de seulement les discerner. Ainsi de l’Ouranien et de l’Archer en Iahvé, ou de la Voix et de la Lumière, puis de la Vierge et de la Déesse Mère à Delphes, à Eleusis, puis du Voyage et des Cités, de la Forme et de la Substance, du Sang Réal et du Graal, etc.
Quand le polythéisme tend à réintégrer l’antique Monothéisme, n’est-ce pas ce chevauchement des Figures qui interdit d’atteindre à la reconnaissance, ou à la création ou à la science de l’Equivalence universelle, par quoi se définirait le Grand Ensemble, la plénitude/dieu?
B) la maintenance d’un Ordre défini n’est pas moins introuvable en une succession de figures qui nous propose simultanément les deux sens contraires :
1) Eau (1ère Arche) – Feu (2ème Arche) – Terre Première – Air (les deux zodiaques ou les deux Cercles) – Eau (les Voyages maritimes) – Feu (le Prince quêteur et la Forge),
2) Eau (du Déluge) – Air (le Souffle, la Voix) – Terre (virginale) – Feu (les métaux et l’alchimie) – Eau (la fin de l’alchimie ou la fin des voyages) – Air et Verseau (le Cosmos).
Et n’est-ce pas – comme le montrent les quêtes hallucinées de la fin des Moyen Age – à cet étrange hiatus entre les sens (le direct et le précessionnel) que doit s’attribuer la difficulté du passage, tous les deux mille ans renouvelé, du monothéisme au polythéisme, l’estimation inestimable de la nouvelle cohérence, d’un nouvel ordre?
Cependant, si toute complétude n’est jamais qu’un contingent, elle n’est qu’une Forme sans autre contenu que soi-même (l’horloge, le cycle). Si toute maintenance s’achève au terme de sa vie, de sa durée, elle s’achève aussi en la fin du cycle, qui la contient toute, à l’exclusion de tout reste. Cette nécessité/loi qu’on nomme l’entropie est la motivation même (nécessité/besoin) qui fait la relance du cycle, un jour après le jour. En sa disjonction la maintenance abolie ne peut reconduire qu’au nouveau motif. Et le lieu de ce manque (destin/besoin) n’est autre que la Forme Vide où le cycle se recommence, à l’inverse du chevauchement du contingentement et de la contingence, en l’Etre Même.
5 Les dernières figures
Les périodes où les dieux peuvent être dits défunts, comme du calendrier hellénistique (-312) au renouveau des panthéons, deux siècles plus tard, ou comme du calendrier républicain (1789) à notre époque, se trouvent naturellement à l’opposé des Royaumes de Dieu, Eden ou Terre Promise, Temps de Tous les Saints, vers -1350 ou +800. Yeats, que je citerai beaucoup en ce livre, donne les dates, plus traditionnelles mais moins précises : 0 et 1050. En poursuivant : 2100.
Peu importe ici. L’essentiel est que ces périodes regorgent d’inventaires figurés, et que leurs inventeurs particulièrement s’attachent non pas au chevauchement de l’Un, qu’ils ne vivent pas, mais aux contours, reliefs, dressements de la Forme Vide, de la Figure en soi.
Je négligerai les innombrables figures hermétiques du 2ème siècle avant J.-C., comme de Bolos à Varon, par Ennius, Carnéade, Lucrèce, etc., pour ne m’attacher qu’à celles de notre époque, assez nombreuses pour que leur étude occupe une vie d’homme.
De leur ébauche – inachevée – jusqu’à leur fin, toute provisoire, elles couvrent les deux siècles, en leur systématique la plus concrète le siècle, en leur divagation la plus, ou la mieux, créatrice, les cinquante ans. Selon le schème :
C) un grand cycle extérieur, qui embrasse les deux siècles, du Märchen de Goethe et de la Critique de la raison pure aux innombrables figures de ce temps, de la macrobiologie (Watson), de la neurobiologie (Laborit), de la psychanalyse jungienne (Solié), etc., sans oublier la figure que décrit cet inventaire;
D) le petit cycle de cinquante ans, comme de Rimbaud à Jarry, qui embrasse les machines proprement « célibataires », de Villiers de l’Isle Adam, Kafka, Jarry, Roussel, Duchamp, mais aussi le rêve de Mallarmé : le Livre et la Quête d’Alice au pays des merveilles.
D’ailleurs, toutes ces « machines » ne décrivent qu’une quête à travers les quatre mondes, c’est-à-dire la partie centrale de la Figure : voyages à travers un jardin (Locus solus) ou l’Egypte (Nouvelles impressions d’Afrique), d’un bord à l’autre de l’Atlantique (L’Eve future), au monde souterrain, féérique (Alice), de la vie à la mort et de la mort à la vie (Faustroll).
Carrouges et moi avons longuement décrit les quatre mondes que suffisent à dénommer les cardinaux :
nord-ouest nord-est
sud-ouest sud-est
mais que j’ai définis plus précisément comme le parcours même de la lumière :
longueur d’onde et couleurs ionisation de
les apparences de l’étendue l’Espace
————————————————–
fréquences : la masse/ la forme
énergie en sa durée du temps
E) intermédiaire entre le plus grand et le plus petit, un cycle d’un siècle plus ou moins (1840/1936) achève la description ou l’inventaire de la Figure, dont je m’occuperai précisément ici. Car, des machines qui jalonnent la période, cent ésotéristes ont joué sans vergogne et, parfois, sans les citer, d’Eliphas Lévi à Ossendowski, par Papus et Guénon, tandis qu’autant de poètes leur devaient quelques vers, une quelconque illumination.
Ces machines sont au nombre de 3, les trois branches du E :
– avant 1850, le prognoscope de Wronski (1778-1853)
– de 1896 à 1909, l’archéomètre de Saint-Yves d’Alveydre
– de 1917 à 1923, avec reprises et commentaires jusqu’en 1936 : la vision du poète anglais W.B. Yeats.
De ce que ces œuvres furent inconnues du grand public, on ne déduire que leurs auteurs s’ignorèrent l’un l’autre. Une étrange continuité les relie, dont le fil pourrait être constitué des Lytton, père et fils.
En France, la quête de Wronski, parent de Mme de Balzac, passionnait l’écrivain, comme on le voit par le personnage de Lambert et par La Quête de l’Absolu. Balzac doit à l’ésotérisme, du moins, la grande idée qui animera toute son œuvre et que définit déjà un roman de jeunesse : Sténie, en 1818. La recherche des lois du hasard, considérée comme « l’incidence forcée des accidents partiels ».
La même famille polonaise sera celle de l’épouse de Sain-Yves d’Alveydre, et ce sera le fantôme de cette épouse qui, après 1896, communiquera au mage les éléments de l’Archéomètre.
Quant au fil des Lytton, le père, Lord Butler, célèbre auteur des « Derniers jours de Pompéi », avait été l’ami de Wronski et de Lévi, héritier du Prognomètre; le fils, ami de Saint-Yves et de Papus, lui-même élève de Lévi, politicien et poète, ne sera pas inconnu de Guénon et de ses sociétés secrètes. L’un des créateurs du Golden Dawn, le second lord Lytton y connut sûrement Yeats et Hardy, sinon, par eux, le colonel Lawrence…
Car le cycle E est lui-même contenu dans le B, qui engloberait toute la période rationaliste, depuis les Rose-Croix de 1600 jusqu’à l’Ermite à naître au XXIe siècle, selon Mahomet et Paracelse. Il n’est pas indifférent que l’adolescence de Wronski dût être nourrie des œuvres de Kant et de Goethe, que celle de Saint-Yves fut, à Jersey, la période des « tables parlantes » de Hugo et que le fantastique moderne d’une part, un pré-nazisme de l’autre eurent certainement leurs germes dans le Golden Dawn. En B, les Trois Machines joignent le rêve de Swedenborg et des Illuminés de Bavière à celui de Lawrence ou celui d’Artaud. S’y reconnaissent l’achèvement du Transcendantalisme de Kant, de Poe, d’Emerson, et le germe des structuralismes de notre siècle finissant. Au cœur, naturellement, le Hugo de Dieu et de La fin de Satan, mais aussi les grands adversaires : Darwin/Lamarck, Marx/Proudhon, Freud/Jung…
Les Figures, pourtant, ne se répètent pas l’une l’autre, puisque Wronski construit deux sphères là où Saint-Yves parle de deux cercles, Yeats de deux cônes.
Wronski se fonde sur 96 structures : 32 « portes » où s’inscrivent 3 « sciences », à l’image des 32 Voies kabbalistiques et des 3 Lettres-mères du Yetsira. Saint-Yves joue des 22 lettres de la Kabbale en même temps que des 12 zodiacaux, et Yeats des 12 en même temps que des 28 phases lunaires (14×2).
Cependant, il s’agit toujours de répondre à la question que l’humanité se pose depuis les grottes glaciaires : comment l’Etre-objet – quel que soit cet être – passe-t-il d’une figure à l’autre, de l’ouest vers l’est ou à l’inverse, d’une sphère, d’un cercle, d’un cône à l’autre? Il s’agit toujours d’une Machine circulaire, dont toutes les sciences (ou autres structures choisies) sont les degrés, ou « dont les connaissances associées sont les rayons » selon l’expression de Wronski. Il s’agit toujours de savoir comment peuvent opérer de compagnie, dans un cycle quelconque, les Nombres, les Figures et les Vocables qui constituent les seuls Aspects concevables de l’Etre-objet.
Et il s’agit toujours, par suite, de confectionner un inventaire aussi complet que possible, d’une part, et de l’autre aussi durable que possible, en dépit de l’imperfection de l’inventeur et de l’entropie qui achève toute chose.
6 La caverne et l’autel
Ces points communs : les deux figures, les deux sens, les deux positionnements (à l’est et à l’ouest) sont plus essentiels que les divergences entre Wronski, Saint-Yves et Yeats. Ils soulignent ces autres analogies qui se découvrent, sur dix mille ans et plus, en toutes figures créées, inventoriées, en tout inventaire.
S’y ajoute la notion que seul le poète anglais formule : une dialectique permanente entre le Vide et le Plein, le manque et le chevauchement.
Pour les navigateurs de Sumer et de la Bible, la grotte vide et les cavernes peintes sont devenues le désert liquide et la « complète » population de l’Arche. Ici, la Complétude sauve du défaut de Maintenance (le déluge). Mais, pour Moïse de même, l’Autel, la Demeure de Dieu, contient le Dieu de Feu en ses trois personnes : formellement, l’Arche même, le Chandelier et les Offrandes, matériellement : l’or, la toison de bélier et l’acacia en l’Arche, etc. A l’autre extrémité, il n’est que le parvis, vide si ce n’est de la foule, négligeable. Dieu est dans l’autel, lui-même trinitaire (l’EN Sof), la justice commune en troisième position, pour les 12 tribus. En deuxième position, le temple même, en la dialectique des deux sens, de l’assemblée vers l’Etre ou de l’Etre vers l’assemblée, par la justice/foi d’une part, la Justice/Dieu de l’autre, c’est-à-dire en l’Alliance.
Ce seront aussi les basiliques de la chrétienté, où Pistis/Basis, le dieu-verbe, tiendra la place du dieu-archer dans le temple[1][1], et les kabbales, qui joueront des Lettres comme d’autres figures.
Diversement, semblablement, c’est le Même en soi, plein de sa matière/énergie, et l’Autre, vide, car on ne connaît d’autrui que l’extérieur; c’est de la Substance et de la Forme que jouent les figures de Platon et d’Augustin : les deux Cercles ou les deux Cités. Plus tard, en la corruption de la chair-dieu, dans le refus du miracle, l’apparence (extérieure), la matière (intérieure), ou bien la longueur d’onde et la fréquence, en la Figure dénombrée, défigurée. L’Objet et le Sujet de Kant.
Mais ce sont surtout les œuvres qui achèvent les temps sans dieu dont on peut dire qu’elles se consacrent entièrement à ce problème, se constituent sur cette dualité.
Pour le nomade Tabi-Outoul-Enlil, en la décadence d’Akkad, la quête ésotérique traverse les 12 portes. L’une se ferme sur l’enroulement Abondance/surabondance, au départ de et au retour en la Ville originelle. L’autre, à l’inverse, survient au terme, en la fin des souffrances, des faux jugements, des malédictions, des crimes.
Deux mille ans plus tard, dès -200, Lie-Tseu oppose l’Unité (pleine de dieux) au Vide où prennent germe les Dix Mille êtres. La Kosmopoiia oppose à l’indicible (les 3/4 ou 4/3) les 3 ou 4 anges premiers et les 7 Rires, successifs, de Dieu. Mais c’est aussi de ces formes vides : échos et reflets que nait – ou renait – Iosos, le seul Régénérateur, grâce à ses mues, (en Dionysos). A la Sympathie, ses concordes, ses « jugements catégoriques », s’oppose, pour Bolos, l’Antipathie, ses discordes, ses « jugements disjonctifs ». Il y applique tous les rapports possibles, imaginables, entre les espèces minérales, végétales, animales, connues à l’époque : le Serpent et le Chêne (solaire) se haïssent, comme le Serpent et le Lion, mille ans plus tard dans les romans médiévaux.
Deux mille ans plus tard, ce sont les figures taoïstes ou hermétiques que répètent les « Machines célibataires », et ce sont les sympathies et antipathie de Bolos que renouvellent les deux cônes de Yeats : « concorde » à l’ouest, « discorde » à l’est, en leur première nomination.
Puis, cherchant à mieux définir l’élasticité des figures, élargissement/amincissement, le poète évoquera deux pays vivants, plus ou moins visibles ou invisibles, ainsi que l’hiver et l’été. Il ne rappellera pas ses devanciers : Wronski et Saint-Yves, mais l’obsession de Flaubert : la Spirale, ébauchée ou rêvée au long de vingt-cinq ans, jamais écrite. C’aurait été l’histoire d’un homme qui rêve à l’encontre de sa vie : plus le temps du songe s’embellit plus la vie s’enlaidit et à l’inverse. Mais Yeats ne cite pas l’autre figure, de Wilde, très analogue : Le portrait de Dorian Gray, où la peinture tient la place du rêve.
Non plus entre Noël et la Saint-Jean mais entre le crépuscule et l’aube, une autre figure – de Saint-Yves – a porté la même alternance, que René Guénon reprend et illustre par l’opposition des deux lettres Nûn (arabe) et Na (sanskrite) : Nûn, moitié inférieure du cercle, se situant à l’ouest, Na, moitié supérieure du cercle, à l’est
Car, dit Guénon dans Le roi du monde, c’est en orient, terre du Na, que le soleil se lève dans le ciel au début du jour, c’est en occident, terre du Nûn, qu’il s’enfonce au soir dans les eaux.
Quant à Yeats, il s’est contenté de remonter, au-delà de Flaubert, aux genèses romantiques, de Coleridge, de Shelley, de Blake. Mais il ne craint pas d’imaginer toute une histoire de l’humanité où, au flot culturel, éternel, de l’homme vers Dieu et de l’est vers l’ouest, s’opposerait un flot civilisateur, scolastique, raisonneur, progressiste, de l’ouest vers l’est. Depuis la barbarie, le vide de la caverne le premier, depuis l’autel reconstitué, peuplé, le second.
L’histoire des religions, prise en – ou de – chaque religion, n’y contredit pas, en effet. C’est bien, toujours, comme d’un autel (en ruines), la fin des Royaumes de Dieu, que l’humanité se remet en marche vers l’orient, ainsi que le soleil lui-même pendant la nuit. Et c’est bien du désert ou de la caverne vide qui achèvent les temps de l’Homme que l’humanité se remet en marche vers l’occident, où devra s’élever le nouveau temple, d’un dieu à l’autre, comme le soleil traverse le jour. A la voie de l’athéisme délirant, éperdu, né des soudaines incomplétudes, succède toujours la voie des mages que, depuis leur désert (la fin de la maintenance), attire vers l’ouest l’étoile de l’aube.
D’une manière plus surprenante – plus hasardeuse, plus contingente – n’y contredit pas l’inventaire des figures que suggère ou impose l’ésotérisme de notre époque, sous le couvert de la science-fiction. On dira celle-ci parallèle aux cycles que nous venons de survoler, puisque elle commence aux romantiques : Marie Shelley, Georges Sand (Casanova un peu plus tôt), rencontre l’Edgar Poe des Machines célibataires, le Lytton-lien, englobe tous les voyages ou marins ou cosmiques, pour rejoindre les auteurs du Golden Dawn, Merritt, Hodgson, Lovecraft au-delà.
Or, il s’agit toujours d’une quête – sans cesse recommencée – entre les pôles : l’ouverture vers le monde interne, l’envers du monde d’une part, peuplé de dieux, de grands anciens, des rêves et des symboles de Lewis Carroll, Babylone inversée où le peuple pré-nazi de Lytton attend son heure; le Massif ténébreux, l’Ile mystérieuse, la Montagne hallucinée d’autre part.
Certes, on dira que c’est là le contraire de la partition médiévale, où la Caverne, à l’est, se dresse dans le désert (la hutte de l’ermite) mais où les monstres, les dragons, les géants et les démons hantent le même bocage défriché, « essarté », et où l’Autel, le château d’Arthur, lieu du détour et du retour, à l’ouest, est aussi le lieu où l’on habille, que l’on peuple – essentiellement d’atours, au jour des noces.
L’important est qu’à l’ouest, paradis ou enfer, est le monde peuplé, de dieux ou de démons; à l’est, essart ou désert, est le monde déserté, la Forme Vide qui, par là même, n’est rien que figure. On ne recense pas les enfers ou les cieux, le premier inventaire ne serait que supplice, comme on le voit par Dante ou Sade, le second ineffable, inénarrable, hors de la fable ou du récit. Mais on décrit, raconte, inventorie la Forme Vide, le bosquet essarté, le jardin à l’anglaise, la partition de l’écu, ou le carré, le triangle, le cercle, le cône : la figure nue.
Aboutissement du jugement catégorique de Kant, de l’Autel de Yeats, que le poète préfère nommer « primaire », car il tient tout en l’Un, ou du jugement disjonctif, de la Discorde et de l’Essart, de la Caverne de Yeats, que le poète nomme « antithétique », car il ne s’agit jamais que de l’opposition aux contraires du renaissant cardinal de Cues…
Illogiques, absurdes mais évidentes, ces analogies rassemblent en une seule figure inventoriée toutes les machines célibataires, puis les trois de Wronski, de Saint-Yves et de Yeats, puis les romans et les contes qui recouvrent les deux derniers siècles, puis les quêtes de l’Islam, de l’Inde et de la chrétienté depuis l’an Mil, puis toutes les figures –alchimiques, eucharistiques, apostoliques – de l’Ere d’Amour, puis les figures connues d’au moins six ères, la moitié de la Grande Année, etc.
C’est une figure cardinale.
A l’ouest est l’autel ou l’atour, ainsi que la Babylone : la complétude de l’Etre-Unité ou le peuplement des dieux, puis des démons, qui somme toute commence à l’ornementation, à la parade, simple accumulation des distinctions et des motifs, qu’à la limite l’Inventaire ne peut plus dire, à cause de l’usure du crayon et de l’insuffisance de la marge. Ce peuplement aussi se fait en profondeur, dans l’intérieur de la Terre ou de l’humus, là où expire l’enroulement de la première spire, renaissante, respirante en la seconde, qui est encore l’Unité (comme cause et non plus comme totalité, comme premier terme et non comme dernier, le premier démon et non le dernier ange).
A l’est est le désert, ou l’essart absolu, la Forme Vide, en une autre Jérusalem, que peuplent seulement l’Arbre et les Quatre Fleuves (ou les Quatre Coupes du Voyage céleste de Mahomet). Cette Forme est surélevée, à la limite : dans le ciel, au-dessus, en quelque sur-face, à l’inverse de la pile, du pile purgatif ou infernal, là où s’achèvent les peuplements et où renait, dans le récurage des reliefs, la récurrence du seul relief qui peut survivre : la forme même (la même figure plutôt que ce qui fut) de la Figure Vide, horloge, temps éternel du renoncement, du repentir absolu.
L’essart, l’écart. La Sur-face, le suffrage.
7 Le suffrage et l’écart
A la question : pourquoi un inventaire? nous avons dû répondre : pour tenter de concilier pendant un certain temps (l’exercice ou le cycle) le maintien, la maintenance (c’est aussi le dressement) de cette complétude-là.
A la question qui doit suivre : comment? nous voyons que l’humanité ne cesse de répondre : par l’acceptation de certains objets et le refus d’autres. ET, plus précisément peut-être : par la révélation, le recouvrement de ce qui fut caché, le rejet, l’exclusion de la chose détériorée, cassée.
Or, ici, ce n’est plus seulement quelques machines célibataires, quelques figures ésotériques qui peuvent illustrer le propos. Il n’est guère de période où quelque grand conflit n’a opposé les deux méthodes – sur des décennies ou des siècles.
Un tel conflit a partagé le siècle dernier, entre l’évolutionnisme de Darwin et la palingénésie ou « théorie des catastrophes », que répète aujourd’hui, partiellement, la cryptozoologie d’Heuvelmans. Un autre conflit partage le XXe siècle, entre la psychanalyse freudienne et la psychanalyse jungienne. Mais c’est aussi, dans l’un et l’autre cas, entre un rationalisme athée et le réalisme irrationnel qu’on dit volontiers « fantastique » lorsque ce n’est pas « rétrograde ». En dépit de contraires apparences, ils se fondent, le premier sur la casse, le rejet, le manque, le second sur la cache, l’acceptation, le chevauchement.
Une clé commune aux deux parties ou adversaires pourrait être l’invention de Conan Doyle : Le monde perdu, dans les deux que, précisément, on donne au mot. Monde cassé, disparu, révolu dans l’optique des darwinistes et des freudiens, car il n’y a plus de diplodocus, de serpent de mer, d’homme du Cro-Magnon en notre époque et, de même, c’est au premier âge, la prime enfance, sinon au moment de la naissance que s’est effectuée la casse du placenta, puis du parfait rapport oral (l’allaitement), puis le monde anal du bébé, etc. Monde caché, recouvert mais toujours présent, dans l’optique des palingenèses, de la cryptozoologie, de la psychanalyse jungienne, car les dieux cachés ou les archétypes fondamentaux habitent l’inconscient de l’adulte aussi bien que l’inconscient de l’enfant, et notre époque est de nouveau pleine de Serpents de mer (ou des Tempêtes qu’ils symbolisent), d’hommes des neiges, de Yéti (ou des violences invétérées en l’homme que figure le monstre de Marie Shelley).
Plus paradoxalement encore, il suit que l’évolutionnisme joue nécessairement du « manque » ou de la « marge » : le Chaînon Manquant, rationnellement introuvable, puisque le système est rationnel, irréaliste et irréalisable. Car le progressisme, commun à Darwin et à Freud, est une croyance dans le discontinu, le yang, que la Résonance raisonnante ordonne seulement, par jointure de ses parties (selon le mot de Caillois : la localisation fait la maintenance). Mieux : la quête du Chaînon Manquant est le moteur, non du progressisme, toujours improuvé (à cause du Chaînon Manquant) mais de l’illusion rationnelle, en son progrès même, évident.
A l’inverse, l’acceptation – incontrôlée – de toutes les fables récurrentes, de tous les mythes, de tous les rêves, ne peut qu’ajouter au chevauchement, à l’enchevêtrement de l’irrationalité, car, sans doute, le Serpent de mer de notre époque, ni serpent peut-être mais poulpe, ni vraiment « de mer », anaconda venu des fleuves aux rivages, ou notre Yéti, que mesure seulement son pied, ne présentent que peu de traits communs avec leurs ancêtres illusoires.
Un jeu très analogue rend ridicules autant les dites psychanalyses. Si le freudien a raison, comment peut-il parler du monde de l’enfant, auquel par évidence, l’adulte n’entend rien? Si le jungien est dans le réel, comment va-t-il cerner, circonscrire celui-ci, dans le flot même de l’indiscernable, illimitée croyance?
Le yang, qu’il prétend dominer, contraint le freudien à cent systèmes, cent mille nominations, chacun ou chacune exclusive des autres. Le yin, qu’il prétend épouser, contraint le jungien à un accueil illimité de tous les possibles.
Si l’évolution joue nécessairement d’une marge, le Chaînon Manquant, et le freudien de même : le réel cassé, toute psychanalyse jungienne, comme toute cryptozoologie, joue d’un perpétuel chevauchement. Car où finit le Grand Frère, le Sagittaire, où commence la Mère ou la Terre Première? Où finit le Singe, différemment, où commence l’Homme? Comme les archétypes dans l’inconscient, les Espèces ne sont plus des arbres successifs mais les branches d’un seul arbre, dont l’une continue de croître (celle de l’homme) quand l’autre se dessèche (celle du singe), mais celle qui se dessèche la première n’est pas nécessairement celle qui a commencé de croître en premier.
Au contraire : il est bien probable que le singe descende de l’homme puisque un des fœtus du singe ressemble à celui de l’homme, mais qu’aucun fœtus de l’homme (reptilien ou avien, porcin, etc.) ne ressemble à celui du singe.
Dans le Tao, dit Lie-tseu, quel est le premier, du yin ou du yang? Dans le cercle ou l’horloge, disent les Occidentaux, de Platon à Einstein, quel est le point originel? De Pigobert ou de Baptiste, quel fut le premier, le second? Quel, l’ancêtre?
Dans le Tao, l’horloge, le cycle, tout sera donc inventorié : la casse avec la cache, l’écart et le suffrage différemment.
Je choisis ces mots parce que, en effet, ils formulent, figurent le double paradoxe.
Ecart signifie : 1) exclusion, rejet, détour (et refus du retour, de la récurrence), c’est la voie, tout à la fois, de l’évolutionnisme et du freudisme. Mais c’est aussi, bien sûr, le dépeuplement par abolitions ou casses successives, de nos ancêtres à l’homme contemporain ou de l’enfant à l’adulte;
2) la partition de l’écu en quatre parties cardinales, ou bien la jointure de deux pièces de charpente. Car, à chaque casse, évolutionniste ou freudienne, se crée bien sûr un nouveau système quadripartite, comme des 4 Tempéraments aux 4 Conditionnements, ou des 4 Facteurs de l’électron aux 4 Forces, ou bien des deux types de névroses et des deux types de psychoses aux 4 structures aliénantes, etc.
Suffrage ne signifie plus aujourd’hui que le vote positif, approbatif, acceptant; mais, en des sens primitifs, (médiévaux, théologiques) il signifia : apport, accord, aide. On l’utilisait notamment pour dire l’un quelconque des moyens qui libère l’âme du purgatoire et la fait admettre dans le Paradis : prière, messe, indulgences. En ce double sens, on le sait, il n’est pas une survivance de la cryptozoologie, ni un archétype jungien, qui ne soit un suffrage, un vote plus ou moins contingent (né du besoin), une prière pour qu’il en soit ainsi, une messe rituelle, un appel à toutes les indulgences.
Du jugement disjonctif (cela n’est pas) au progressisme évolutif, l’Ecart fait bien toute la marge du Chaînon Manquant, en même temps que la Forme Vide de l’essart, de l’écu, de la succession calendérique des circonstances et des formulations, des jours dans le mois, des mois dans l’année, des années dans le cycle oriental des mythes ou dans le cycle occidental de l’activité solaire. Ou bien des ordres, des espèces, des familles de nos sciences dites « naturelles ». Ou bien des cassures freudiennes, ainsi que nous l’avons vu.
Du jugement catégorique (cela est en même temps que ceci) aux thèses de l’éternel retour, le Suffrage est bien comme un amoncellement, un chevauchement d’intercessions ou de mérites cachés (dans la prière, la messe), sinon présents encore – et non moins recouverts – comme les monstres d’Heuvelmans, les Grands Anciens de Lovecraft, les archétypes jungiens.
Mais, dans une autre vue, rationnelle, l’Ecart est le processus qui mène, par jonctions et partages (analyses), depuis un chevauchement primitif, l’ignorance ou l’aveuglement, aux éclaircissements de la science, au défrichement final. Le Suffrage est le procédé archaïque, rétrograde, qui ne ramenait pas du purgatoire au Paradis mais de la distanciation rationnelle, où tout est clair, à l’opacité, à l’obscurantisme des légendes, des superstitions.
En bref, qu’est-ce donc qui se tient à l’ouest? Est-ce le château d’Arthur ou le Paradis, la Présence du Roi ou de Dieu? Ou n’est-ce pas, tout au contraire, la part maudite, opaque, encombrée de l’inconscient?
Et qu’est-ce qui se tient à l’est? Le jardin essarté, ordonné de la Raison? Le désert où, loin de Dieu et de toute Présence, l’âme désenchantée se meurt de solitude?
Ayant nommé « discorde » le cône de l’est et « concorde » le cône de l’ouest, à l’imitation d’Empédocle, Yeats a trouvé le cône « primaire » pour dire l’Autel occidental et le cône « antithétique » pour dire, à l’opposé, la Caverne orientale. En même temps, logiquement, il lui dédoubler les deux mouvements de l’ouest vers l’est et à l’inverse.
Il définit non 2 mais 4 « facultés ». L’Esprit créateur et le Corps du destin sont comme des spirales qui tournent dans le sens des aiguilles d’une montre, ainsi que le Cercle de l’Autre, de Confucius et de Platon. La Volonté et le Masque sont comme des spirales qui tournent en sens inverse, ainsi que le cercle du Même jadis.
Du double jeu de pénétration et d’arrachement vers l’occident ou vers l’orient, le poète formule enfin les 4 figures que peuvent engendrer les deux cônes :
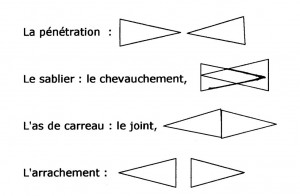
Mais, enseigné par des esprits (les Visiteurs) dont Mme Yeats prend les messages en écriture automatique comme en sténo, et n’en recevant aucune explication des figures, le poète ne dit jamais comment, des jugements, disjonctif (la discorde) et catégorique (la concorde), il est passé aux notions neuves de chevauchement, de recouvrement, de découvert, de cache et de casse. Ou comment les Jugements reconduisent aux Lois.
Les lois
1
Leur trilogie
Il n’est pas de procès sans jugement, ni de jugement sans loi. Si le jugement tend à décider de la conciliation (catégorique) ou de l’inconciliation (disjonctif) des parties, les lois permettent la décision. Elles constituent un recueil de recettes pour juger : au premier chef, l’inventaire des codifications possibles, ou ce qu’on appelle un code.
Comme il en est de tout inventaire, nous devons donc considérer que les Lois concerneront d’abord – ou ne concerneront que – des figures. Ou, mieux, qu’elles peuvent être déduites de ces figures dialectiques que nous avons vu se succéder depuis la dernière glaciation :
a) l’intérieur et l’extérieur,
b) le passage et l’impasse,
c) le continu et le discontinu,
de nouveau a : le contenant et le contenu,
de nouveau b : la terre et la mer, le désert/la forêt,
de nouveau c : le yin et le yang,
etc.
A première vue, ces trois ordres dialectiques semblent renvoyer à la trilogie la plus claire : des jugements,
Comme des lois de polarité (c) au jugement disjonctif : cela est continu ou discontinu, yin ou yang, le même ou l’autre,
Des lois de contenance ou de peuplement (a) au jugement catégorique : cela est contenu en … et contenant de …,
Des lois de passage (b) au jugement hypothétique : cela passe si …
Mais, possible, le rapprochement demeure aléatoire, le parallélisme incertain.
Car, de fait, les Lois révèlent en chaque dialectique une quadrilogie cachée. Exemple : le Même est la chose même en soi, mais il peut être la même chose dans l’Autre. L’Autre n’est pas seulement l’autre chose, mais aussi la chose autrement dans le Même (l’adolescence après l’enfance, l’adulte après l’adolescent).
Si l’une des dialectiques, alors, se présente comme disjonctive : le Même ou l’Autre, l’autre se présentera comme catégorique : l’autre chose et la même chose; la chose même, autrement.
C’est qu’en effet les 3 jugements demeurent liés à notre dialectique de base : la complétude et la maintenance, soit que le disjonctif tende à maintenir A (Dieu) contre B (le diable) ou l’inverse, soit que le catégorique tende à compléter A par B ou l’inverse.
Quant à l’accomplissement, qu’une même systématique rapproche du troisième jugement, nous l’avons montré dédoublé aussi, en terme de la maintenance (achevée) et en plus haut point de la complétude, une acception excluant l’autre.
Une fois encore, la dualité s’est faite quadrilogique :
La complétude,
Son inverse : l’incomplétude, l’inaccomplissement,
La maintenance,
Sa fin : l’accomplissement,
Bien incapable, ce lexique, de se plier aux 3 jugements.
A quoi allons-nous référer nos trois lois, indéfiniment répétées?
Si la raison ne peut répondre à cette question, il se peut que la réalité, toute irrationnelle qu’elle soit, y réponde – par le jeu (même et autre) de ses figures.
Nous avons vu qu’une figure étant donnée, je pourrai en exclure certains objets, dissemblables, par l’écart, et y accueillir d’autres, catégoriques ou motivants, par le suffrage. C’est-à-dire, dépeupler ou peupler le cercle, le cône, le cube, la sphère.
Je pourrai donc en sortir moi-même ou y entrer, dans un passage incessant du dedans au dehors ou à l’inverse. A moins que, pris dans la figure comme en une prison, je ne puisse en sortir, hors de la figure, je ne puisse y entrer. Ce sera le cas de l’exercice cyclique dont nul phénomène ne peut s’arracher s’il s’y trouve; où nul ne peut pénétrer, s’il ne s’y trouve pas.
Mais, au départ, existe la figure même, continue ou discontinue et, comme continue, selon Yeats, as de carreau ou sablier, comme discontinue ou associante ou dissociante. En un langage plus psychanalytique :
– yin ou yang, la chose même ou l’autre chose,
– animus ou anima, la chose autrement ou la même chose.
C’est dire que, tendant à la complétude (qui exige le catégorique : ceci et cela) alors que son jugement préférentiel est disjonctif : l’ensemble « rouge » ne contient que des choses rouges, l’Inventaire ne peut localiser que des figures – jointes ou semblables – dans un arrangement qui permettra de se soustraire au paradoxe. Je nomme Dispositions ou Lois ces arrangements qui, seuls, peuvent résoudre le problème.
Il s’en induit immédiatement, par référence à la constatation ci-dessus, que :
– l’objet de l’inventaire sera continu (le Même) ou discontinu (l’Autre), substantiel ou formel dans le langage médiéval,
– en tant que discontinu, plus ou moins distant, dans l’éloignement, le détour, ou dans l’approche, le retour, selon la distance et l’instance,
– en tant que continu, soit contenant de l’autre (la chose autrement) soit contenu en l’autre (l’autre chose), ou exclu du contenant, à découvert, ou vidé de son contenu, ne recouvrant plus rien.
Contenant ou vide, l’objet sera plus ou moins peuplé.
Recouvert ou découvert, il sera plus ou moins grand.
– évoluant sans cesse, bien sûr :
de la chose même à l’autrement,
de l’autre au semblable,
de l’éloignement à l’approche,
de l’approche à l’éloignement,
dans le détour ou le retour,
du + (peuplement ou grandeur) au – (dépeuplement ou petitesse),
du – au +.
Or, ce sont précisément ces 4 modes et les 7 évolutions/involutions (processus) que doivent énoncer les Lois. Nous en dirons diversement les 4 procédés, dédoublés des dualités kantiennes de base, mais nous n’évoquerons que superficiellement, sans nous y référer, les 7 processus, qui jouent des nombres et des vocables autant que des figures inventoriées.
2
Les lois de polarité
Au minimum un inventaire se fond sur le 2. Si son objet est l’Unité, il lui faudra la partager pour en recenser les parties.
Ces 2, il ne peut ni les nombrer ni les nommer d’une manière définitive : on n’inventorie que des figures.
Soit les deux nominations les plus simples : A et B, ou l’un, l’autre. Elles formulent un sens, de A vers B ou de l’un (le premier) vers l’autre (le second), qui n’est plus seulement d’un ordre inventorial.
Je puis, certes, dresser l’inventaire de deux objets sans commune mesure, tels que le Même et l’Autre : le premier cohérent, continu, yin, le second distinct, discontinu, yang.
Mais l’expérience montre qu’alors, je serai tenu de considérer chacun des deux comme unité, c’est-à-dire de le partager en deux sens ou acceptions : la chose même dans le Même et la même chose dans l’Autre, l’autre chose dans l’autre, la chose autrement dans le Même.
Ne pouvant être complet, faute d’atteindre au Un, le confectionneur d’inventaire voudra du moins tendre à quelque maintien, constance. Ce sera presque toujours une constance de rapport entre des dialectiques diverses,
comme entre la Forme et l’Espace, la Matière et le Temps,
ou entre le Même et le continu, dans le yin,
l’Autre et le discontinu, dans le yang,
ou entre la Matière, le Même, le continu, le yin dans le Temps,
la Forme, l’Autre, le discontinu, le yang dans l’Espace, etc.
Dans l’espoir que l’accumulation des dialectiques similaires, par jonctions rationnelles, reconduira l’inventeur à la Jonction Universelle, but – avoué ou non – de toutes les sciences : le faux et le vrai.
En réalité, au contraire, les rapprochements dialectiques ne font apparaître qu’un nombre croissant de différences, c’est-à-dire de spécialisations. Une science ne peut que partager les êtres en inertes et vivants, puis les vivants entre animaux et végétaux, les animaux entre unicellulaires et pluricellulaires, ces derniers entre les reptiles, les oiseaux, les mammifères, ceux-ci entre herbivores, carnivores, etc.
Longtemps seulement théorique, une loi se révélait ainsi : du yin, du Même ne peut surgir que la dissociation, l’écart (la chose autrement) dans un mouvement qu’on dit aujourd’hui animus ou dissociation; du yang, de l’autre chose ne peut naître que le rassemblement ou la ressemblance (la même chose), dans un mouvement qu’on dit aujourd’hui anima, faute d’un nom plus approprié.
Or, c’est dire seulement que tout objet est le Même et l’Autre, fait de discontinuités ou d’animus si je le dis continu, yin ou femelle, tendant à une continuité ou l’anima si je le dis yang, discontinu, mâle. Dès Thalès, il y a plus de vingt-cinq siècles, la découverte de l’électra, l’ambre, avait montré qu’en effet, certains corps ne contiennent pas un des pôles sans contenir l’autre. Ou, comme le dit Bolos, quatre siècles après Thalès, que tout objet est doué de sympathie pour certains objets, d’antipathie pour d’autres.
Les Arabes savaient que, si je partage un objet « magnétisé », chaque nouveau morceau de cet objet sera positif à une extrémité, négatif à l’autre. Puis, le XVIe siècle a connu les premières sociétés « scientifiques » qui, recouvrant les découvertes du 3ème siècle avant J.-C., établissaient que les mêmes se repoussent, créant le discontinu, les pôles différents s’attirent, recréant la continuité. Il est curieux qu’alors, doublement démontré par les nouvelles sciences, Bolos ait été aussi oublié.
Méprisée cependant, sa dialectique s’instaure. Elle prolifère en d’innombrables applications. A la fin du 17ème siècle, Newton fait de l’Attraction des contraires une loi de l’univers. Peu après, Leibniz, Boscovitch et d’autres mathématiciens dotent leurs « monades » et leurs « points » des deux forces contraires. L’électricité s’invente, elle est formulée, nombrée, tout au long du 19ème siècle.
A l’inverse, une doctrine du 15ème siècle, « l’opposition aux extrêmes » du cardinal de Cues ou de Cuse, exploite le processus de répulsion, qui aboutira, vers 1900 et depuis lors, à l’opposition de la longueur d’onde et de la fréquence, de la probabilité de position et de la quantité de mouvements, de l’éloignement de la particule depuis le noyau et de son rapprochement (dans la résonance), c’est-à-dire à toute la physique nucléaire.
Sans doute, aux pôles « naïfs » de l’électra se juxtaposent alors un autre positif et un autre négatif, plus comparables aux « primaire » et « antithétique » de Yeats, cependant que les sens, de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, donnent naissance aux « spins » électroniques. Ce sont deux facteurs sur les quatre qui définissent la particule, les deux autres étant son positionnement et sa quantité de mouvements (sa charge).
Mais, ici de même, la dialectique indéfiniment partagée reconduit à une loi constante : réduite à cet ensemble, elle s’amenuise sans fin. C’est ainsi que la particule, définie par ses 4 facteurs, se positionne sur une orbite définie (selon la loi, dite « d’exclusion » de Pauli). Mais la loi ne se vérifie que pour les particules de spin ½ (fermions), c’est-à-dire pour une partie des particules possibles ou imaginables.
Les lois de Bolos n’étaient pas seulement ésotériques, comme, pendant quinze siècles on l’a cru : elles étaient une approche certaine de la réalité la plus concrète. A l’inverse, les lois de la physique nucléaire ne sont que prétendument physiques : elles formulent seulement, épisodiquement dans la chronologie universelle et éternelle, les lois ésotériques.
C’est ainsi que le positionnement orbital de la particule subatomique de Pauli ne se vérifie en somme que pour la moitié des particules, celles qui tournent dans le cercle de l’Autre platonicien ou dans le cône antithétique de Yeats. Mais, dans le cercle ou le cône inverse, les particules de spin 1 ou 2 (bosons) n’obéissent pas au même positionnement. Or, ce n’est plus alors la fréquence et la constante de Planck « h » qui mesurent la probabilité de position de la particule (en tant que matière/énergie); c’est la longueur d’onde, la vitesse qui limite celle de la lumière, qui mesurent la quantité de mouvements du « boson ». La constante n’est plus « h », mais « C »; la longueur d’onde, commune mesure des couleurs, inverse la fréquence, commune mesure des sons.
La formule fonctionnelle n’est plus : e (l’énergie) = h.f (fréquence) comme dans le cheminement de l’Ecart, de la jointure à la disjonction, à l’ionisation de l’électron.
Elle joue du rapport de la longueur de l’onde et du temps ou de la fonction de Mandeleieff : 2n2, selon laquelle l’orbite n=1 ne porte pas moins de 2 atomes : 2×1 au carré = 2. Véritable « suffrage » mathématique auquel on comprend que Caillois se réfère sans cesse pour démontrer que la « maintenance » n’est affaire que de « localisation ».
Or, si, au terme du processus fondé sur le principe d’exclusion de Pauli et sur l’équation de Planck, est l’exclusion, en effet, l’ionisation absolue de l’électron dans l’Espace, c’est l’Unité, la nouvelle molécule, d’hydrogène sur la plus petite orbite, qui accomplit le cycle de Mandeleieff. Ici encore la même chose, la similitude des facteurs ne conduit qu’au grand écart : la destruction. Les différences, ruptures, motivations distinctes reconduisent au grand ensemble.
3
Les lois de finalité
Les semblables font l’éloignement, ou les mêmes choses la discontinuité (le yang). Les différences font l’approche, ou les choses autrement la continuité (le yin). Mais l’éloignement, l’approche de quoi?
Il faut bien répondre :
a) on ne s’éloigne que d’un départ.
L’aventure, le détour procède sur une route inconnue. D’une certaine manière, il n’y est que des délais. Je remets chaque jour à demain l’arrivée, le terme du voyage, le jour et le lieu étrangers. L’espoir incertain de la découverte ne va pas sans une certaine crainte, que fonde l’ignorance. On ne mesure pas une distance depuis l’inconnu,
b) on ne se rapproche que d’une arrivée.
Le retour procède sur une route connue. On ne s’y conduit d’un relais à l’autre (les cailloux blancs du Petit Poucet), car les étapes en sont jalonnées de longtemps, depuis le voyage d’aller. Mais on veut toujours hâter le retour, car l’espoir du recouvrement ne va pas sans une certaine crainte : celle de ne pas retrouver les choses en l’état. Ainsi mesure-t-on la distance d’approche sur le terme du voyage de retour.
Telle, cette deuxième loi contredit la première :
Les Mêmes font l’éloignement, qui mène à l’Autre, dans le détour.
Les Altérités font l’approche, qui ramène au Même, dans le retour.
Pour admettre le paradoxe, il ne suffit pas de dédoubler le Même, en même chose et chose même, et l’Autre, en autre chose et chose autrement. Un second dédoublement s’impose : celui des fins.
La découverte n’est pas seulement la fin heureuse qu’espère l’homme du détour (le progressiste). C’est aussi le découvert comptable, le chaînon manquant d’abord, le manque absolu, la casse, qu’il trouve tout au long, puis au terme de sa route.
Le recouvrement n’est pas seulement la récupération qu’espère l’homme du retour. C’est aussi le fait de recouvrir, d’englober, la cache où trop souvent s’abîme l’ésotériste (occultiste), non moins que le cryptozoologue et le jungien.
Mais encore ces nouvelles identifications, du découvert et du dépeuplement, du recouvrement et du peuplement, ne simplifient pas le problème. Elles le compliquent.
On sait qu’en effet, algébriquement, le peuplement retarde le retour, que le dépeuplement autorise.
L’ensemble ABCD ne redeviendra tel qu’après les 3 groupements : BCDA, CDAB, DABC. Mais l’ensemble ABC redeviendra tel après les 2 phases : BCA et CAB.
C’est, entre autres conséquences, pourquoi la notion de progrès, qui nie le retour, exige la production, l’accroissement et la consommation : on s’accroît ou l’on s’enrichit pour ne pas revenir. Mais le dépouillement, l’appauvrissement, le dénuement (« la catastrophe ») fondent la palingénésie, relancent la récurrence, imposent en effet le feed-back.
Si le détour fait la découverte, c’est le recouvrement/peuplement qui fait le détour. Si le retour fait le recouvrement, c’est le découvert/dépeuplement qui fait le retour.
Du paradoxe qu’impose la quadrilogie du Même et de l’Autre à celui qu’impose la quadrilogie des Fins, un joint nous manque – ou un motif, dont l’Inventaire ne rend pas entièrement compte, car, précisément, cela n’est pas de l’ordre des Inscriptions (le même/l’autre) ni des Fins.
Peut-être cela n’est-il pas de l’ordre de l’Objet mais seulement subjectif. Me le fait croire le fait que la loi s’applique seulement, qu’elle est surtout connue, aux temps (bibliques ou brahmaniques) et aux époques (la fin du 13ème siècle, par exemple) où domine ou renaît la religion du JE, la notion de « personne », toute subjectivité.
Plutôt que sur les Fins ou sur les Inscriptions, cette loi – si l’on peut lui garder ce nom – semble jouer des « moyens » : la distance et l’instance. Elle peut se formuler ainsi :
L’éloignement réduit les lieux d’où je m’éloigne, c’est-à-dire qu’il les peuple, ou qu’il peuple le champ de vision que j’en ai : il situe la forêt là où n’était qu’un arbre.
L’approche accroît le lieu dont je m’approche, c’est-à-dire qu’elle le dépeuple ou qu’elle dépeuple la vision que j’en ai : elle situe l’arbre là où se tenait la forêt.
Si, néanmoins, je pouvais imaginer un éloignement de mon point de départ dans le retour (la nostalgie du progressiste confronté à la catastrophe), cet éloignement serait conçu comme un dépeuplement, une casse.
Si je pouvais imaginer une approche de mon point d’arrivée dans le détour (l’utopie du faux-prophète, du mythomane), cette approche serait toujours conçue comme un accroissement, un enrichissement, un gain, nécessairement caché : « les voies du Seigneur sont impénétrables » ou les formules connues de Hegel, puis de Marx : les erreurs de la science, les déviations de l’Histoire, la victoire de la « mauvaise part » sur la bonne sont les meilleurs garants de la science comme progressiste, de l’Histoire comme dialectique, du déterminisme rationnel.
Contre cette double vision se sont élevés Abraham, Moïse, tous les prophètes de la Bible, depuis Elie jusqu’à Daniel, mais aussi le Jésus des Evangiles et tous les prophètes de l’après-chrétienté, des 15èmme et 16ème siècles.
Ce qu’ils disent?
« Seul le Même (l’attachement à soi-même) fait le discontinu, la plus grande distance, l’éloignement. Puis, l’éloignement ne peut que peupler, subjectivement, et le peuplement même interdit le retour, le recouvrement du Même ».
« La chose différente, autrement (l’arrachement à soi-même) fait le continu, la moindre distance, l’approche. L’approche ne peut que dépeupler, subjectivement, et le dépeuplement rapproche le retour, aux lieux déjà connus, que le temps a fait différents, dans l’incomparable découverte qu’est le recouvrement véritable ».
Ainsi n’est-il plus aucun paradoxe, ni en l’étude quadrilogique des Inscriptions ni en celle des Fins. Il y a suffi de l’étude soigneuse des Moyens : l’éloignement, l’approche, le détour et le retour.
Mais on voit qu’ici, tout n’est plus question que de positionnement, de localisation, du mobile ou de l’observation, à une quelconque distance de l’arrivée, dans le retour, ou du départ, dans le détour.
Comment donc se disposent les trois points : le départ, le terme du parcours et le mobile? C’est ce que formule la troisième loi.
4
La loi de localisation
C’est en optique que, tout récemment, a été trouvée – ou réinventée – la troisième loi, qui lie les notions de passage et d’impasse à la réalité d’une localisation.
Une source de lumière étant placée en O et un écran de réception en O’, l’observateur dispose de 3 écrans polarisants pour intercepter le rayon lumineux : le premier constitué de bandes horizontales, A, le deuxième constitué de bandes verticales, C, le troisième constitué de bandes diagonales, B.
Si je dispose les trois polarisateurs comme en (1) ou en (2), le rayon de ne passe pas :
O______A______C. . . . .B O’ (1)
O______B______A. . . . .C O’ (2)
Il passe entièrement si je les dispose comme en (3) :
O______A______B______C____O’ (3)
J’écris que cette loi est retrouvée aujourd’hui. Il ne fait pas doute, en effet, que la répartition soigneuse des Tribus aux 4 cardinaux, dans le livre des Nombres et le livre d’Ezéchiel notamment, tend à respecter une telle loi.
Plus : l’obéissance du Peuple Elu, dont dépend étroitement le maintien de l’Alliance entre le Peuple et Dieu (c’est-à-dire le passage de la Lumière, puisqu’il s’agit d’un dieu de Feu), n’est autre qu’une obéissance aveugle aux localisations de Moïse, puis des Juges, puis des Prophètes, localisations spatiales des « ordres de marche » ou de l’emplacement des tribus en Terre Promise, ou localisations temporelles des Jours de la semaine, des Mois et des Années… Ici surtout se vérifie pleinement l’assertion de Caillois, que « la localisation fait la maintenance ».
Dix signes, et notamment l’inversion mathématique, plusieurs livres, et notamment le Livre de l’homme qui a vu, mais surtout la constante alliance de la Vierge, Innina ou Neith ou Nisiba, déesse de la Préservation, du Maintien, avec les divinités du Nombre et de la Localisation Sensée (Anzeti, Nin, Horus), dans l’ancienne Egypte ainsi qu’à Ourouk, Warka, Ur ou Sumer, attestent que cette loi troisième ne dut pas y être moins essentielle que la deuxième, de finalité, dans les traditions brahmaniques ou bibliques, ou la première, de polarité, de Thalès jusqu’à notre époque.
Car le christianisme et le bouddhisme ne sont que d’extrêmes extrapolations des lois qui fondent le Même et l’Autre. Les religions de Justice, de Brahma ou d’Abraham, ne sont que d’extrêmes finalités des lois que fondent le peuplement et le dépeuplement, ou d’Alliance dedans, de Malédiction hors. Les religions antérieures, d’où survivent les Taureaux, de Rudra ou de Mardouk, Apis ou Kamoutef, se fondèrent en effet sur le rapport inconcevable entre les deux Dispositions (localisation et tendance), qui sont aussi les deux Moyens : distances/instances.
En sa forme la plus générale, la loi semble être telle : les Trois étant donnés, A, B, C, le passage exige cet ordre, ou son inverse : C,B,A, c’est-à-dire qu’il exige la localisation de B entre A et C ou C et A. Toute autre succession interdit le passage.
Je peux aller du Père à l’Esprit par le Fils, ou de l’Esprit au Père, par le même canal. Ou de l’Unité au Vide, ou à l’inverse, par la dualité polarisante (de l’Autel à la Caverne ou à l’inverse par l’une ou l’autre des spirales de Yeats). Ou, par le jeu de l’Ecart, du joint à l’exclusion, par le jeu du Suffrage dans le sens inverse : de l’absence purgative à la présence paradisiaque, de la parade/protection au paradis. Etc.
Mais une localisation autre m’est interdite. Comme celle qui prétendrait permettre le passage de l’Unité à la Forme Vide, ou à l’inverse, sans passer par le polarisateur B; le passage du Père à l’Esprit ou de l’Esprit au Père sans passer par le Fils.
Nous avons vu comment la 1ère loi se figure : par le continu et le discontinu, et comment la 2ème : par le contenant et le contenu. Comment figurer la 3ème?
Ce peut être par une Forme Vide, qui exclut tout contenu, séparée de ce contenu même (l’En soi, le Père, l’Unité), si bien que je ne puis passer directement de l’Un à l’Autre, ni de l’Autre à l’Un. Cette Forme, pourtant, comporte une Entrée : l’écart, et une Sortie : le suffrage, dans les acceptions définies.
Jusqu’à ces derniers mois, un mot me manquait pour dénommer cette étrange figure. Un texte me le donne, qui date évidemment de Wronski et de Baudelaire, traducteur de Poe, de 1854. Il s’agit du premier conte fantastique de Verne, dont le Voyage au Centre de la Terre demeure au cœur de la quête du monde perdu (caché) et dont le dernier texte : L’éternel Adam, en 1905, renouera avec l’éternelle récurrence.
Dans ce conte : Maître Zacharius se trouve en clair posé le double problème du Vide (et de l’écart) comme absence et comme récurrence, en même temps que le dilemme théologique de la perte ou du salut de l’âme, par la pitié, l’amour, la prière, le suffrage rédempteur. Le mot est celui qu’on utilise surtout en horlogerie, mais il présente tout son sens – double – en mécanique, en charpenterie, en musique : l’Echappement.
Il s’agit toujours de l’éviction, du rejet d’un rouage (en horlogerie) ou d’une note (en musique) qui relance le mouvement en sens inverse, l’éternisant par ce retour.
On notera même que l’architecture, qui ne connaît pas cette notion de retour, science uniquement statique, nomme « échappement » la distance qui sépare un escalier de la voûte qui la surplombe. Or, c’est bien cet « écart », cet écartement, qui permet que l’escalier soit descendu ou monté dans les deux sens.
Ainsi, quand une tribu ne prenait pas sa place dans l’ordonnancement des structures (ou quand on la rejetait de son rôle, comme la tribu de Benjamin, le Loup/Archer, exclue de la garde de l’Arche), il était nécessaire de l’exclure des tribus, comme on saute la dent du rouage, en horlogerie, pour relancer le mouvement, laisser passer à nouveau.
Dans nos justices encore, le coupable, celui qu’on peut couper de l’ensemble, n’est rejeté du cercle, de cette société-là, que parce qu’il combattait l’échange social, interdisait la libre communication des idées ou des « biens ».
Mais que font le poète, le peintre, quand ils excluent de leur œuvre ce mot, cette couleur? N’en tirent-ils pas, celui-ci ou celui-là, la seule relance – et, par delà, la seule maintenance, survie – possible?

Illustration Pierre-Jean Debenat
5
Thermodynamique et information
La fin du 20ème siècle se caractérise, entre autres merveilles, par un rapprochement, cru impossible hier, des quêtes irrationnelles d’une part, rationnelles de l’autre. C’est tantôt le mythologue Roger Caillois qui, gardant son vocabulaire poétique, se déclare séduit et convaincu par les figures orbitales de Mendeleieff. Et tantôt l’éminent chercheur fondamental Henri Laborit qui, conservant son vocabulaire scientifique, en vient à créer une figure (la nouvelle Grille), peu différente des deux spirales de Yeats.
Ce que j’ai nommé le passage (de A vers C par B ou à l’inverse) y porte le nom de « système ouvert », les deux seuils de C en étant l’entrée et la sortie.
Ce que j’ai nommé la voie de l’Ecart est dit par Laborit l’aboutissement de la chaîne thermodynamique, c’est-à-dire l’Entropie à quoi aboutit cette chaîne, avec son relief (« déchets », ici, de l’énergie/matière). De cette voie, Yeats écrivait dans Vision : « Lorsque l’ancien primaire devient le nouvel antithétique, l’ancienne prise de conscience d’une loi morale objective se trouve changée en un instinct subconscient et désordonné », lorsque l’écart/joint devient l’éloignement, le détour et la catastrophe pour finir.
Ce que j’ai nommé la voie du Suffrage est dit par Laborit la sortie de C en information (irrationnelle, archétypale en son départ). De cette voie, Yeats écrivait, il y a soixante-quatre ans : « Lorsque l’ancien antithétique devient le nouveau primaire, le sentiment moral se trouve changé en un système organisé d’expérience qui doit à son tour rechercher une unité, la totalité de l’expérience ». C’est ici le relief dressé, le dressage, qui constitue l’essentiel du phénomène.
Aussi précisément que possible, faisant de la matière/énergie le fondement de la voie rationnelle, thermodynamique, et des croyances de l’époque les substrats de la voie irrationnelle, informatique, Laborit nie que tout irrationnel soit à rejeter, toute rationalité considérée comme bénéfique : si l’utopie, souvent, dénature le premier, l’entropie, à coup sûr, achève la seconde.
Cependant, et d’autres chercheurs, comme Charon, le suivent en cela, Laborit ne pense pas que l’entropie soit le terme « définitif » de la voie thermodynamique. C’est ainsi qu’il charge des organites intracellulaires, les mitochondries, de récupérer les « déchets » ou vestiges de l’ionisation électronique pour les inclure, par utilisation de l’oxygène comme « accepteur d’électrons », dans la chaîne biocatalytique similaire à l’information. Cette « chose » utilise la chaleur même pour établir la récurrence, le feed-back impossible, de l’électron de matière au photon de lumière, de l’énergie usée à la nouvelle forme.
Cette forme, provisoirement vide de toute énergie/matière, est porteuse, en sa structure même, d’une information rédemptrice, néguentropique, comme de l’entrée en C de la forme restante (l’espace) que laisse béante la néantisation de la matière et comme de la sortie de C de la vitesse formelle brute du photon (la vitesse/limite de la lumière). Comme Jules Verne parlant de l’échappement, Laborit emploie le mot : régulateur, pour dire à la fois le vide laissé par l’entropie matérielle (la dent, la note ou le rouage sautés) et la récurrence, la rétroaction, le feed-back qui relance le mouvement à l’inverse, de ABC à CBA.
Dans les deux figures de Laborit et de Yeats, mais plus précisément en la première, il suit que le Régulateur/échappement, ouvert par cette entrée et cette sortie, se présente cependant comme un système fermé, une impasse, si je prétends sauter de C à A ou de A à C sans passer par B, à l’aller ou au retour. Car c’est B seul qui porte l’Ecart, donc l’entropie, le manque dans un sens (thermodynamique, matériel, rationnel), et le Suffrage, la « considération » mythique, le dressage, la récurrence dans l’autre (irrationnel, informatique). Comme le péché mène les catholiques au purgatoire (ou à l’enfer, s’il est mortel, sans repentir, sans déchet pour remonter la pente) et comme quelque croyance les en rachète, quelque élection, suffrage, les en sauve.
A quel point ces croyances ou ces suffrages demeurent hypothétiques, aléatoires, contingentes, nous en prenons quelque conscience en remontant au temps où la notion de Purgatoire s’instaure mais où, encore, bien d’autres topologies formulent lieu régulateur, la forme vide et récurrente : le désert, la forêt sauvage (vaste l’un, gaste l’autre, toujours vides, écartés). Le Quêteur perdu comme le Monde plus tard et bien près, aussi, d’être cassé, affronte nécessairement deux croyances éventuelles, dont il doit élire l’une. Tel, le chevalier Yvain, le Serpent et le Lion, savoir et hiérarchie, sagesse et pouvoir, mais aussi le dieu d’Eau, l’Oint, le nouvel Hermès, et le Christ ressuscité, royal et noble. Et, encore plus précisément, le dieu de Vérité des juifs, IAHVE, et le dieu à venir, le second Christ, le Paraclet de Jean, le fils de Roi ou le Prince que sera l’Esprit. Car, selon qu’il choisit une croyance ou l’autre, le premier animal ou le second, Yvain se sauve ou se perd.
Une cinquantaine d’années plus tard, les Cisterciens offriront le même choix à leur quêteur, Galahad : entre la voie de droite et la voie de gauche, à l’orée de la forêt, il lui faudra choisir.
Qui ne voit que ce choix, cette élection d’Yvain ou de Galahad, puis des suffrages purgatifs, cent ans plus tard, sont du même ordre, mieux : de la même figure, que les cercles de Platon et les sphères de Wronski, les volutes contraires de Saint-Yves et de Guénon (Nûn et Na), les cônes de Yeats, la science de la matière/énergie, serpentiforme, et l’information créative, royale de Laborit?
Mais qui ne voit que tous ces lieux : désert vaste, gaste forêt, purgatoire, antithétique de Yeats, échappement de Jules Verne, régulateur de Laborit sont uniquement des Formes Vides, et comme telles, opposées à la Ville, au Château, à la Présence de l’Etre (ou Dieu ou Lucifer), au primaire, au peuplement presque indiscernable de l’Un, dont aucune de ces légendes, aucune de ces sciences ne parle, sinon comme de l’Entité originelle, cassée (le Boum originel ou l’Age d’Or primitif, l’affect freudien) ou comme de l’Entité à recouvrer, au terme de l’information, cachée encore ( le Christ-Oméga de Teilhard de Chardin, le Paraclet de Jean, la Vérité peut-être accordée aux ultimes mutants des temps à venir)?
Ce purgatoire, ce régulateur, cette Forme Vide est le lieu par excellence, le seul en fin de compte, qu’inventorie un inventaire quelconque, théologique ou scientifique, de Thomas d’Aquin ou de Laborit. Mais comment peut-on recenser une forme vide? Est-ce que le néant s’inventorie?
A peine peut-on dire qu’il s’invente.
6
Une génération inventive
L’ouvrage de Laborit n’est pas unique. Par la date de son écriture (1974), il se situe entre l’article d’Alfred Korzybski : « le rôle du langage dans les processus préceptuels » (publié en 1951, traduit en français en 1966) et le gros livre de Douglas Hofstadter, Gödel Escher Bach, publié en 1977, traduit et publié en français en 1985. Nil’ un ni l’autre ne traitent de « l’information/structure » que Laborit situe entre la voie de l’entropie (thermodynamique) et la voie de la néguentropie informative, mais Korzybski en quelque sorte la suggère et Hofstadter en montre le caractère universel par l’invention de ses multiples applications : mathématique et scientifique d’une part, littéraire, picturale et musicale de l’autre.
Korzybski décrit longuement le niveau où, entre l’indicible et non-verbal subatomique comme entrée et le verbal imaginaire comme sortie, se situent l’apport physico-chimique du ion et la réaction électro-colloïdale (sentiment/pensée). Ce Lieu n’est pas encore nommé (neurone, forme vide, information/structure), mais il est défini comme circulaire et récurrent, ainsi que l’échappement de Verne. Pour ne laisser aucun doute sur la nature de ce niveau/pivot entre l’être/matière/énergie et la croyance/nom/structure, l’auteur achève son étude par une citation de S. Eddington, dont le livre : Space time and gravitation est paru en 1920 : « En ce qui concerne la nature des choses, cette connaissance n’est qu’une coquille vide – une forme de symboles… L’esprit ne retrouve dans la nature que ce que l’esprit y a mis ».
On notera qu’il ne peut l’y avoir mis que par récurrence ou feed-back, comme on ne connaît le cycle à venir qu’une fois le cycle achevé. Cette révélation de S. Eddington recule de trente ans l’invention scientiste de la Forme Vide, de 1950 à 1920. A l’inverse, bien d’autres découvertes prolongent d’autant d’années l’invention de Korzybski… jusqu’à notre époque. Je citerai le spécialiste des « caissons de rêve » et l’éducateur de dauphins, John C. Lilly qui, dans son livre : « Les simulacres de Dieu », ne craint pas d’écrire : « Tout semble se passer comme si, par le jeu infini de la dialectique, le tout de l’intégrale se trouve être toujours ZERO ». En 1982, plus rien de ce mystère n’est obscur, et Lilly peut préciser que le Zéro est figure, forme, mais une forme vide, qu’il nombre N, initiale de néguentropie et de neurone, entre la destruction de tout relief et le relief/renaissance du feed-back, entre l’éclat (ement) et le suffrage régénérateur. Si l’accomplissement de la maintenance, son éclatement, achève la voie de l’entropie causale, c’est l’accomplissement de la complétude, connu d’avance, dans le sens de la finalité non-causale, qui ouvre la voie inverse.
Aucun doute sur la croyance profonde de tous ces découvreurs : elle se fonde sur la 3ème Loi, car le feed-back est absolu : il renvoie ABC (le détour) au retour symétrique, motivant, CBA, mais jamais de ABC à CAB par exemple. Et ils savent tous que, si le peuplement a fait le joint et la disjonction de l’entropie scientiste, c’est le dépeuplement, jusqu’au Zéro, qui fait le retour, selon la 2ème Loi. Etrangement, ils ne semblent pas, ni l’un ni l’autre, avoir gardé mémoire de la 1ère Loi, de polarité. A l’exception de Hofstadter, qui n’omet pas de citer Georges Steiner : « l’hypothétique, l’imaginaire, le conditionnel, la syntaxe de l’antifait et de la contingence sont peut-être les centres producteurs du langage… Il est peu probable que l’homme, tel qu’il est aujourd’hui, aurait survécu (sans eux) et sans le pouvoir sémantique, engendré et tenu à disposition dans les zones superflues du cortex, d’imaginer et d’organiser des possibles qui échappent au cercle de la décomposition et de la mort » (Après Babel, Steiner, Albin Michel, 1978).
Or, comment Steiner nomme-t-il ce lieu de renversement, ce neurone, cette forme vide, cette information-structure? L’altérité. C’est l’Autre qui ouvre, fait le continu de l’antifait et qui, par la marge de l’imaginaire (le cycle en soi), ouvre la voie de la récurrence. C’est l’Autre qui recrée dans le Retour, quand les mêmes pôles n’ont pu que dissocier, distendre, écarteler dans la voie (électromagnétique) de l’entropie.
Ces Trois Lois, qu’il nomme autrement, Hofstadter les retrouve appliquées par le musicien Bach ou ses propres dialogues, le peintre Escher et les figures qu’il réinvente, le mathématicien Gödel et ses propres séries. Et peu importe qu’au vocable : Forme Vide, il préfère « Boucle Etrange », une expression sur laquelle il faudra revenir. L’important est que cette boucle aussi – la bande de Moebius, connue de l’auteur du Timée – peut se refermer ou se reformer en cercle, comme les inventions de S. Eddington, de Korzybski, de Laborit, de Steiner, etc. En ces noms ou figures ou nombres divers, que formulent les vocables : Forme Vide, le Zéro ou le nombre N et dont il ne se peut pas que, dans la période 1920/1950, des poètes, des écrivains n’aient point parlé, puisque la science ne fait jamais qu’expliciter l’Art créateur…

Illustration Pierre-Jean Debenat
(à suivre)
| [1][1] Dans la crypte, sous l’autel. |
|
|